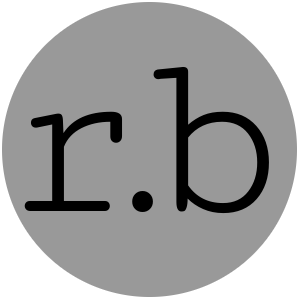Tout le monde repère la bizarrerie du dernier cours de Barthes au Collège de France où, pour parler du roman, il parle du haïku. Rien a priori de plus étrangères, culturellement et formellement que ces deux pratiques. Et les modèles romanesques qui sont ceux que Barthes se donne avant de commencer, Guerre et Paix, À la recherche du temps perdu, sont des œuvres copieuses et apparemment opposées à la brièveté du haïku. Il faut donc comprendre d’une part que l’antinomie est recherchée, voulue par Barthes (« deux pivots – apparemment absolument disparates et formant une articulation excentrique […] le Haïku et Proust[1] » ; il y revient dans la suite du cours : « Proust et le haïku se croisent : la forme la plus brève et la forme la plus longue » (PR, 135), pour finalement l’expliquer par l’hyperperception proustienne qui lui fait faire l’expérience du ténu, de la division indéfinie du réel (PR, 206). Aussi n’est-ce une antinomie qu’au départ ou en apparence. Il faut comprendre d’autre part que ce n’est pas le roman qui est rapproché du haïku, mais la préparation du roman ou le fantasme du roman à faire, où les noms « Haïku » (avec une majuscule) et « Proust » renvoient chacun à leur manière à des modes d’individuation et à des modes de passage de la vie à l’œuvre. Ils sont pour ainsi dire des « détours » (un détour qui va durer tout un semestre de cours, quand même, pour le haïku), pour approcher quelque chose du roman[2].
Au départ, donc, une fiction théorique : je veux écrire un roman. C’est bien comme fiction théorique que le programme s’énonce, comme simulation, « comme si », même si, du point de vue de la biographie, on sait que Barthes s’était bel et bien attelé à l’écriture d’un roman depuis qu’il a eu la révélation de sa nécessité le 15 avril 1978, lors de sa « conversion » littéraire qui a eu lieu à Casablanca. Le cours, lui, dans le but de donner congé à toute forme de métalangage, prend une forme mimétique de son objet en plaçant la fiction à son commencement et en ouvrant le scénario d’un récit. Ce récit, pourtant, n’est pas le même que celui qu’il conduit dans la préparation de son propre roman, qui était celui de la pitié, de l’amour maternel, et dont il donne quelques éléments à la toute fin de la première année de cours. Revenons quelques instants sur cette décision du 15 avril 1978, qui est celle d’écrire « une grande œuvre d’Amour pour rejoindre les grands modèles littéraires (Guerre et paix) », pour voir l’avantage qu’il tire du haïku dans son cheminement – sachant que le haïku est un pivot pour le cours, mais n’en est pas un dans le projet Vita Nova alors que Proust l’est pour les deux. Si Proust est bien à sa place, dans la fiction réelle et dans la fiction de fiction, le haïku n’apparaît que dans la fiction de fiction (le cours). Il s’agit donc de réfléchir à la place de quoi il apparaît, de quoi il est l’ « alibi », pour reprendre le terme que Barthes emploie, de quoi il est l’ailleurs.
Le roman
Le roman, dit Barthes au début du cours, n’a de sens qu’à « dire ceux qu’on aime », qu’à rendre justice à ceux qu’on a connus et aimés, témoigner pour eux, les immortaliser. Ou encore, comme il l’énonce dans la conférence du 19 octobre sur Proust : « J’espère du Roman une sorte de transcendance de l’égotisme, dans la mesure où dire ceux qu’on aime, c’est témoigner qu’ils n’ont pas vécu (et bien souvent souffert) “pour rien”[3]. » La dimension du témoignage est essentielle. Elle explique cette sorte de mystique du roman à laquelle Barthes adhère à ce moment-là et qui surprend aussi bien son entourage que les auditeurs du cours. « Ce qui changea chez Barthes avec la mort de sa mère, écrit Éric Marty, c’est l’étrange pression, l’étrange impératif qu’il ressentit d’écrire un roman[4]. » Les proches sont mal à l’aise, pensent qu’il restera toujours au stade de la préparation : « On ne comprenait pas ce qu’il voulait faire[5]. » Aujourd’hui encore, des critiques ou d’anciens amis doutent de l’engagement de Barthes dans la forme romanesque. Antoine Compagnon y voit plutôt un investissement tardif dans la poésie, mise jusque-là à distance et retrouvée par la présence captive dans le haïku[6]. Certains préfèrent y voir un pur objet de spéculation ; d’autres encore lisent son goût pour le romanesque, manifeste dans ses écrits les plus personnels, comme la seule part acceptable arrachée au roman. Pourtant, la lecture attentive de l’ensemble des documents relatifs au projet « Vita Nova » permet, c’est ce que j’ai essayé de montrer dans le dernier chapitre de ma biographie, d’affirmer le contraire. Certes le roman géant, le roman pas comme les autres dont il rêve, relève du fantasme. Et s’il choisit ces deux œuvres, À la recherche du temps perdu et Guerre et paix, ce n’est pas pour égaler leur forme ou leur grandeur, mais parce qu’ils sont les seuls romans à avoir inscrit l’incandescence de cet amour spirituel qui s’exprime au moment de la mort et qui constitue la vérité de son sujet. Chez Tolstoï, ce sont les derniers mots qu’André Bolkonski adresse à sa fille Marie avant de disparaître : il évoque l’amour absolu qu’il lui porte comme le seul bien capable de lutter contre la mort. Chez Proust, c’est la mort de la grand-mère, et surtout le chagrin, la vénération et la piété que sa fille (la mère du narrateur) manifeste dans les moments qui précèdent, qui retiennent l’attention de Barthes : « l’humilité de qui se sent indigne de toucher ce qu’il connaît de plus précieux », l’inclinaison de son visage sur celui de sa mère, ses dernières paroles (« Non, ma petite maman, nous ne te laisserons pas mourir comme ça, on va trouver quelque chose, prends patience une seconde[7] »), tout cela reconduit Barthes à son propre deuil tout en étant la promesse d’une transfiguration. Le rapprochement de ces deux scènes précise avec force le projet, qui concerne précisément la « pitié » comme réponse à l’amour le plus plein. « En retrouver avec précision le frémissement “topique” : c’est Guerre et paix, et plus précisément la “pitié” tolstoïenne. Or il y a aussi une pitié proustienne. Donc ne pas la perdre[8]. »
La force de « Vita Nova » tient dans ce consentement radical au pathos, au moment pathétique, qui permet de comprendre l’inclusion dans le livre de tout un matériau divers : les amis, les vaines soirées, les amours clandestines, les difficultés à faire, le ressassement, la « sensation de honte, de “posture”, de guignol », la « vadrouille » (« cinémas, rues à gigolos, repérages de saunas, avec sans doute pour horizon la possibilité d’un plaisir sexuel – mais avec aussi une assez intense activité d’observation et de paresse »), les incidents, l’enfant marocain manifestant l’essence même de la charité[9]… Le roman moderne, s’il peut encore avoir une vérité et une fonction, doit reprendre ce principe tragique de la compassion. Barthes reconnaît la vérité du pathos comme force de lecture et comme nécessité absolue de la littérature : « Il faut accepter que l’œuvre à faire […] représente activement, sans le dire, un sentiment dont j’étais sûr, mais que j’ai bien du mal à nommer, car je ne puis sortir d’un cercle de mots usés, douteux à force d’avoir été employés sans rigueur. Ce que je puis dire, ce que je ne peux faire autrement que de dire, c’est que ce sentiment qui doit animer l’œuvre est du côté de l’amour : quoi ? La bonté ? La générosité ? La charité ? Peut-être tout simplement parce que Rousseau lui a donné la dignité d’un “philosophème” : la pitié (ou la compassion)[10]. » L’évidence lui en est vraiment venue des derniers mots de sa mère. Il le note à nouveau le 26 août 1979, en rattachant l’événement à la révélation de la signification du mot rosebud dans le film d’Orson Welles : « À la fin, découverte, surgissement du secret enfoui – comme le traîneau d’enfant de Citizen Kane : Mam. me disant “Mon R, mon R”[11]. »
Ce consentement est une forme d’accueil simple, direct, non évaluatif du monde. Toutes choses égales ou égalisées dans la forme. D’où le caractère non arrogant du roman : « jamais un roman ne m’intimide ; jamais un roman ne produit sur moi une intimidation de langage. » (PR, 43) Si tout le problème est de passer de la notation à la note, de la nota à la notula, du discontinu au continu ou du fragment au roman, la préparation du roman est d’abord ce qui est désiré, car elle définit les conditions de cet accueil. Cela revient régulièrement dans les notes pour Vita Nova : inclure les fiches, les notes prises au jour le jour, les petits événements ou impressions du quotidien (en particulier toutes les notes prises depuis la mort de sa mère et qui seront publiées comme un tout, de façon posthume, sous le titre Journal de deuil). Le Haïku va alors devenir le nom de tout ce matériau, de ce qui, dans la propre vie de Barthes, prend la forme de « notes-journal » ou de fiches, de tout ce qui n’a pas encore coupé le lien, le cordon ombilical avec la vie pour devenir œuvre. Ce que la préparation du roman doit permettre de penser, c’est ce passage, en même temps que le lien du roman avec la vie : le haïku est le nom donné à ce qui maintient ce lien. Cela implique une forme de performativité : « “Je te baptise haïku”. » (PR, 59) Ce qui veut dire non seulement qu’il consent à ce que sa perspective sur le haïku comme forme poétique culturellement située, inscrite dans une langue, soit déformée, mais aussi qu’il ait le pouvoir solennel, sacramentel pourrait-on dire, de donner son nom à autre chose.
Le haïku
Toute cette partie du cours pourrait d’ailleurs s’intituler, sur le modèle d’une expression bien connue, « l’alliance de la carpe et du haïku ». Barthes cite en effet à l’appui de son « serment », de sa parole performative, un passage des Trois mousquetaires où Aramis rebaptise un plat de viande servi un vendredi du nom d’un poisson. Il fait remarquer qu’il s’agit peut-être là d’un faux souvenir, ou d’un souvenir erroné de lecture, mais ce « je te baptise carpe » lance la réflexion[12]. Que le mot « carpe » intervienne ici dans le discours de Barthes place sans doute le propos sous le signe de la mésalliance. Le Haïku, le roman, comment les apparier ? Comment démontrer leur appariement ?
Loin d’être un attrait tardif pour la poésie, l’intérêt que Barthes porte au haïku est donc délibérément romanesque, quitte à ce qu’il trahisse la forme telle qu’elle est pensée dans sa culture et dans sa langue. Il la reconnaît d’ailleurs comme forme brève et non comme forme métrique que la traduction, explique-t-il de façon assez catégorique, est incapable de restituer (PR, 65). Même si le cours contient çà et là de beaux passages sur la poésie (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Valéry et l’anthologie du vers unique de Georges Schéhadé sur laquelle je reviendrai, car elle met en scène un lieu limite du poème), une forte défense de la poésie comme art de la nuance, comme site de la vérité et comme « pratique de la subtilité dans un monde barbare » (PR, 109), ce n’est pas la forme poème qui retient Barthes avec le haïku. Non, ce qui le retient, c’est sa brièveté, capable d’enclore un monde. Comme le roman, elle est une forme hospitalière, une forme entièrement accueillante.
Si elle peut l’être, c’est d’abord parce qu’elle recueille le modeste. Le propos est construit à partir des synonymes de la simplicité ou de la modestie, matérielle et immatérielle : « ténuité », « humilité », « aération », « petit bloc », « futilité », « immédiateté », « microscopie », « discrétion », « contingence », « infime quotidien »… Certains des termes possèdent des connotations morales, mais il faut presque tout le temps leur donner plutôt une valeur phénoménologique ou simplement descriptive. Cette capacité d’accueil est politique car elle inclut ce qui est habituellement exclu de la littérature, à la fois les gestes modestes et les gestes oubliés : ainsi – et ce n’est pas un hasard si à un moment Barthes rapproche le haïku d’Un cœur simple de Flaubert –, il en fait une écriture ménagère (« le haïku, d’ailleurs, qui est une écriture ménagère, l’écriture du ménage du quotidien » – PR, 57) parce qu’elle parvient à capter les bruits de la maison, de la cuisine. Tout un vocabulaire renvoie métaphoriquement le haïku aux gestes ordinaires, en particulier lors de la séance du 3 février 1979 qui porte sur les tangibilia, les objets concrets ou les objets sensuels, pupitre, petite porte, verveine blanche, assiette, papier, charrette…, présence en puissance ou puissance de présence de ce dont on a été séparé, monde qui n’est plus soudain redonné. Le deuil se nourrit d’ailleurs de ces détails concrets, susceptibles de rappeler à soi un corps. Ainsi le 17 novembre 1977, Barthes note ceci : « (Crise de chagrin) (Parce que V. m’écrit qu’elle revoit mam. à Rueil, habillée de gris)[13]. » Dans des formules saisissantes, Barthes présente ainsi le haïku comme un « art d’écrémer la réalité » (PR, 183) ou comme une manière de « rafler » des « copeaux de présent », comme avec un rabot (PR, 197). Art de la nuance infinie, de l’individuation comprise comme moire des intensités et des différences, comme individuation des saisons, des moments et des heures, il étend les limites de l’accueil par l’écriture. Il permet à chacun d’inventer sa participation, déjouer son sentiment d’exclusion – dont Barthes ne cesse de présenter des situations, dans l’enfance dans un trou ou il tombe, à l’âge adulte en présence de couples notamment[14].
L’accueil
Il y a des formes accueillantes et des formes qui ne le sont pas. Des formes excluantes, arrogantes, intimidantes. À un moment du cours, Barthes prend même en charge la capacité d’accueil de la pratique sociale et culturelle du haïku au Japon. C’est un des rares moments où il le rattache à son lieu, précisément pour traiter de l’accueil. Avec le haïku, le lecteur désire devenir producteur. « Désirer faire ce qu’on aime, c’est probablement une preuve décisive (d’amour). » (PR, 77). Cet art n’est pas réservé à l’élite et il occupe une place importante dans la vie quotidienne au Japon. Cette observation lui permet de soulever par contraste un problème de la France actuelle : « il semble que le désir de production des œuvres pré-existe mais soit tout à fait marginal. En tout cas, le nombre d’amateurs qui ont envie d’écrire des chansons ou des poésies, existe incontestablement, mais est très réduit statistiquement par la masse énorme des consommateurs : je veux dire que (car ce n’est pas une question de bonne volonté individuelle) il n’y a pas en France actuellement de formes (poétiques pour en reste à la poésie) suffisamment populaire pour accueillir le désir de production. » (PR, 78) À ce désir, répond Barthes, les Japonais offrent une structure hospitalière.
Au-delà de cette question de l’accueil social – que sont venus réparer en partie, récemment, la multiplication des ateliers d’écriture ou l’insertion de la création littéraire dans l’enseignement universitaire –, il y a celle, déjà évoquée, de l’accueil de l’œuvre. Comment se détermine-t-il ? Depuis S/Z, mais Mythologies les évoque déjà, les œuvres accueillantes sont celles qui permettent l’inversion des positions, la transformation du lecteur en auteur. Elles s’opposent aux œuvres qui excluent, en ne permettant pas à leurs lecteurs ou spectateurs d’inventer leur regard et de produire en retour. Ainsi les « Photos-chocs » présentées à la galerie d’Orsay et dont Barthes rend compte dans une mythologie n’éveillent aucun sentiment politique : leur problème formel vient de ce qu’elles excluent celles et ceux qui les regardent, qui ne ressentent rien en les voyant, qui n’éveillent en eux aucun pathos. L’accueil a ainsi à voir avec deux éléments reliés : la vérité et le pathos. D’où l’importante définition du haïku (et de certains passages du roman proustien) comme « moment de vérité ». « Le moment de vérité implique une solidarité, une compacité, une fermeté de l’affect et de l’écriture, comme un bloc intraitable. Le moment de vérité n’est pas dévoilement, ce n’est pas la minute de vérité, ce n’est pas du tout ça, c’est au contraire le surgissement de l’ininterprétable, c’est-à-dire du dernier degré du sens, de l’après quoi plus rien à dire. » (PR, 229). C’est la conjonction d’une émotion qui submerge, parfois jusqu’aux larmes (le pathos) et d’une évidence de la représentation (le « tilt », le « c’est ça ») ; ce qui m’arrive « à moi ».
Ainsi, le problème formel de l’accueil n’est pas de pouvoir tout contenir. C’est au contraire un arrachement, un moment bref. L’hospitalité de la forme n’a pas à voir, comme on pourrait le croire, avec des questions de quantité ou de totalité, mais avec cette puissance de surgissement et de déflagration où une vérité de la condition humaine est donnée tout d’un coup à voir avec éclat ; et que cet éclat nous point et nous émeut. C’est la même chose pour le roman (et d’ailleurs le passage du cours sur le « moment de vérité » intervient dans une séance sur Joyce et Proust). La taille n’est pas en soi un problème formel. Ce qui l’est en revanche, c’est la capacité d’une œuvre à faire varier les tailles, au sein du très long, d’inscrire des moments qui en ruinent la longueur. Proust, selon Barthes, parvient à le faire et en certains endroits de son œuvre, sa technique se rapproche de celle des épiphanies joyciennes, elles aussi comparées au haïku. Outre le rapport de Proust aux tangibilia, aux entours, c’est sa capacité à percevoir le ténu et l’infime, le petit voire le futile qui nous fait une place. Le motif égalisateur de Saint-André des Champs, qui résonne tout au long de la Recherche, donne le programme politique de cet accueil et rejoint la mission hospitalière que Barthe repère dans le haïku : ainsi, parfois, « la capture du ténu n’est pas obligatoirement liée à la forme brève », parfois « il faut beaucoup de langage pour rendre compte d’une force de division, et de divisibilité » (PR, 206).
Il y a, à l’horizon de la division, la prolifération de la notation. Si Barthes place le haïku dans une relation d’équivalence avec la notation, c’est moins pour égaliser les formes que pour indiquer que le petit poème japonais (en traduction) est l’équivalent forme d’un informe[15]. La notation et le haïku sont porteurs du même rapport entre littérature et vie, non coupées, non séparées. Dans l’expression d’un pur particulier, qu’on ne peut pas reconduire à une généralité, qu’on ne peut pas réduire, donc, le haïku invite à donner une forme à la vie. Il se présente ainsi doublement comme une chance : pour la littérature, qui cesse d’être cette forme bourgeoise ayant perdu le contact immédiat avec le réel ; et pour la notation, qui devient une puissance. Au moment de la préparation du cours sur le roman, Barthes est dans une activité intense de notateur. Pendant cette période, il éloigne d’autres pratiques d’écriture pour se centrer presque exclusivement sur la notation et ses archives contiennent autant de fiches pour les années 1977-1980 que pour le reste de l’existence. Parallèlement, il s’interroge sur le devenir-œuvre de toutes ces notes. Le haïku semble leur offrir un horizon formel qui soit aussi un horizon éthique en accueillant le réel et la vie, d’une part, et en faisant poindre le pathétique de l’existence, d’autre part : point de liaison de l’amour et de la mort, point où chaque moment de plénitude exprime en même temps son caractère éphémère.
Le pathos, la pitié, par leur puissance d’ébranlement, contribuent à la ruine, et donc à la vie de l’œuvre. Ce que Barthes appelle une critique pathétique, qui est celle qui met au jour l’accueil de l’œuvre, est donc celle qui accepte « de déprécier l’œuvre, de ne pas en respecter le Tout, d’abolir des parts de cette œuvre, de la ruiner – pour la faire vivre. » (PR, 232) Ainsi on peut découper un livre entier en lexies, saisir le haïku hors de sa langue et de son contexte, ne se rappeler que quelques scènes d’un roman, quelques citations ou quelques détails, repérer tous les moments où la littérature lutte contre le sens, transmettre non la communication d’une signification mais l’émotion éprouvée au contact avec le réel. Barthes a trouvé une confirmation de cette idée dans la préface de Valéry au recueil de haïku de Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises où, s’adressant à « Mademoiselle Chrysantème », il évoque la ruine ou le délabrement dans la mémoire des longs poèmes : « Les civilisations qui se raffinent, écrit-il en 1924, en arrivent à des formes poétiques très brèves. Elles ont appris que les longs poèmes se brisent et se résolvent spontanément en leurs fragments les plus précieux[16]. » Recueil de ces ruines, l’album est ainsi l’avenir du livre. Cette fragmentation offre toute liberté au lecteur et Barthes en use joyeusement dans le cours. L’anthologie du vers unique de Georges Schéhadé, composé des vers uniques que le poète se rappelle par cœur, est un exemple de cette lecture-écriture, libre et irrévérente. Les vers privés de leur contexte en reçoivent une nouvelle étrangeté. De ces monostiches, Barthes fait à son tour librement des haïkus rétrospectifs, adoptant la forme du tercet qui n’est pas spécialement japonaise[17]. D’un vers de Milosz tiré du poème « Les terrains vagues », remémoré par Schéhadé, « Toi, triste, triste bruit de la pluie sur la pluie » et ainsi « haïkisé » en trois vers :
Toi triste
Triste bruit de la pluie
Sur la pluie (PR, 70)[18]
Il décerne des brevets de « haïkité » à certains écrivains ou poètes, en particulier à Valéry (beaucoup cité tout au long du cours) auquel il reconnaît d’avoir produit le seul véritable haïku français, dans « Le cimetière marin » :
L’insecte net
Gratte
La sécheresse (PR, p. 134)
Ces opérations ont pour but de sortir le poème de la poésie. Barthes, citant « Le cimetière marin » observe que le texte est produit par un auteur « qui a une réputation d’être très peu poétique, qui ne fait pas partie de l’horizon actuel de la poésie ». De même, réduire comme le fait Georges Schéhadé, les poèmes canoniques à un seul vers, sans contexte, sans entour et sans auteur, est une façon de les déposséder de leur forme et même d’en finir avec le poème si l’on convient avec Agamben que celui-ci se définit par l’enjambement[19]. Dès lors, le vers unique, comme le dernier vers du poème, abolit en quelque sorte le poème ou en signale la fin. L’opération n’a pas forcément pour but de reconduire la poésie au roman, mais d’émanciper l’ensemble des formes de la littérature.
L’affranchissement est la raison des formes accueillantes que sont le haïku et le roman. Avec elles, on s’émancipe des lois logiques, de la grammaire, de la mémoire (en consentant à l’incomplet), de l’émotion comme catégorie psychologique (à laquelle Barthes oppose l’émoi ou l’ému, très éloignés du sentiment romantique[20]). Leur hospitalité procède d’une teneur de vérité qui n’a pas atteint la généralité. Le haïku, la notation, les « moments de vérité » dans le roman, les épiphanies sont ces zones libres où l’écriture n’est pas encore devenue littérature.
notes
- Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France 1978-79 et 1979-80, Éric Marty (dir.), Seuil, 2015, p. 51. Désormais PR suivi du numéro de page. ↑
- Depuis L’Empire des signes, l’intérêt de Barthes pour le haïku a été relancé par la publication simultanée, en 1978, l’année du commencement du cours, de deux anthologies de haïku, l’une par Roger Munier (qui passe par le relais de l’anglais), chez Fayard, et l’autre de Maurice Coyaud. Roger Munier, Haïku. Textes choisis, traduits de la version anglaise et présentés par Roger Munier, préface d’Yves Bonnefoy, Paris, Fayard, 1978. Maurice Coyaud, Fourmis sans ombre, le livre du haïku, Paris, Phébus, 1978. Lors de la séance du 6 janvier 1979, il mentionne entre autres références bibliographiques l’anthologie de Blyth (Horace Reginald Blyth, A History of Haïku, Tokyo, Hokuseido Press, 1963, 4 vol., ainsi que Le livre de Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, lettre-préface de Paul Valéry, Paris, Le Divan, 1924, ouvrage qu’il dit avoir depuis longtemps dans sa bibliothèque et qui lui venait de sa grand-mère Noémie Révelin. Voir l’article d’Emmanuel Lozerand, « D’où viennent les haïkus de L’Empire des signes ? » dans la présente livraison de la revue Roland Barthes. ↑
- « Longtemps je me suis couché de bonne heure », Œuvres complètes, Éric Marty (éd.), t. V, Seuil, 2002, p. 469. (Désormais OC). ↑
- Éric Marty, Barthes, Le Métier d’écrire, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2006, p. 65. ↑
- Ibid., p. 66. ↑
- Antoine Compagnon, Les Antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005, p. 436-440. ↑
- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, t. II : Le Côté de Guermantes, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1988, p. 619. ↑
- BnF, NAF 28630, « Grand fichier », 14 juillet 1978. ↑
- Incidents, OC V, p. 971. ↑
- « Longtemps je me suis couché de bonne heure », OC V, p. 468. ↑
- BnF, NAF 28630, « Grand fichier », 26 août 1978. Fiche non reprise dans Journal de deuil. Mais on trouve dans le volume, écrit dans le temps de la préparation du cours et de sa présentation, des notations comparables : Journal de deuil, Seuil, « Fiction & Cie », 2009, p. 50, 131, 251. Et en particulier celle-ci où il rapproche son prénom et le roman : « J’écris mon cours et en viens à écrire Mon Roman. Je pense alors avec déchirement à l’un des derniers mots de mam. : Mon Roland ! Mon Roland ! », 15 décembre 1978, p. 227. ↑
- C’est en effet un faux souvenir du chapitre XXVI du livre de Dumas (« La thèse d’Aramis »), dans lequel Aramis commence par proposer à d’Artagnan des tétragones et des fruits. On lit alors ce dialogue qui peut sans doute expliquer la confusion mémorielle de Barthes : « – Qu’entendez-vous par tétragones demanda d’Artagnan avec inquiétude. – J’entends des épinards, reprit Aramis ; mais pour vous j’ajouterai des œufs, et c’est une grave infraction à la règle, car les œufs sont viande, puisqu’ils engendrent le poulet. » À la fin du chapitre, lorsque son serviteur entre avec ces deux mets, Aramis réclame cette fois « un lièvre piqué, un chapon gras, un gigot à l’ail et quatre bouteilles de vieux bourgogne ». Alexandre Dumas, Les Trois mousquetaires, Paris, J.-B. Fellens et L.-P. Dufour éditeurs, 1849, p. 219 et 223. ↑
- Journal de deuil, op. cit., 17 novembre [1977], p. 64. ↑
- Voir par exemple Roland Barthes par Roland Barthes, OC IV, p. 697, p. 662 ; et Journal de deuil, op. cit., p. 93. Francesca Mambelli a travaillé sur cet dialectique exclusion/ accueil dans « Lutter contre l’exclusion avec la littérature », Colloque « Barthes et la critique littéraire au présent », Philippe Daros et Vincent Message (dir.), Paris 3 et Paris 8, Maison de la Poésie, novembre 2015. ↑
- Il serait intéressant de réfléchir à la part de la traduction dans cette identification paradoxale de la forme et de l’informe. ↑
- Paul Valéry, « lettre-préface » à Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Paris, Le Divan, 1924, p. 6. Il reprend une idée développée dans une lettre de 1909 à Jeannie Valéry : « C’est étrange comme la suite des temps transforme toute œuvre – donc tout homme – en fragments. Rien d’entier ne survit – exactement comme dans le souvenir qui toujours n’est que débris et ne se précise que par des faux. » Paul Valéry, lettre à Jeannie Valéry, juillet 1909, Œuvres, Gallimard, « Pléiade », t. I, 1957, p. 33-34. Cité par Roland Barthes dans La Préparation du roman, p. 352. ↑
- Inversement, dans certaines langues, les haïkus sont traduits sous la forme de monostiches, comme l’indique Muriel Détrie dans le même volume, en évoquant les traductions de Lafcadio Hearn notamment. ↑
- Georges Schéhadé, Anthologie du vers unique, Paris, Ramsay, 1977, p. 48. ↑
- Voir à ce sujet Giorgio Agamben, La Fin du poème, traduit de l’italien par Carole Walter, Circé, 2002. ↑
-
Il cite encore Valéry ici : « Les poètes de l’Extrême-Orient [il pensait précisément au haïku] semblent passés maîtres dans l’art de réduire à son essence le plaisir infini d’être ému. » Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, op.cit, p. 7, cité par Barthes (PR, 139) ↑