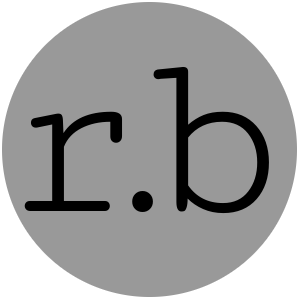Il faudrait faire un jour l’histoire de notre propre obscurité, manifester la compacité de notre narcissisme […].
Roland Barthes, L’Empire des signes
Les découpages académiques, disciplinaires, institutionnels, maintiennent trop souvent séparés des lecteurs qui gagneraient pourtant à se fréquenter. Les barthésiens lisent généralement L’Empire des signes (1970) comme un moment dans l’itinéraire de l’auteur de Mythologies, S/Z ou Fragments d’un discours amoureux, à l’aune de ses conceptions du langage et de la littérature ; les imagologues, spécialistes des discours sur l’Autre, resituent logiquement l’ouvrage dans l’histoire des représentations du Japon ; alors que les japonologues, parfois, ne le feuillettent même pas, ou alors seulement pour se gausser des erreurs qu’il contient. N’y a-t-il pas là autant d’ornières et d’angles morts ? Comment savoir si Barthes est passé complètement à côté du Japon, ou s’il en a eu au contraire une perception subtile et intuitive ? Si son regard sur ce pays est novateur, ou informé par des schèmes de perception anciens ? Comment repérer ses « contresens » même, et leur éventuelle « beauté » ?
L’Empire des signes est pourtant bien le lieu et le produit d’une rencontre – à un certain moment et dans une certaine histoire de l’imaginaire français (et occidental) du Japon – entre un écrivain engagé dans ses logiques propres et un pays bien réel, avec l’ensemble de sa culture et de son histoire. La prise en compte conjointe de ces trois dimensions serait seule susceptible de donner à comprendre les caractéristiques exactes du « Japon de Roland Barthes ». En décrivant précisément les traits du « réel japonais » prélevés et élaborés dans L’Empire des signes, en élucidant mieux les plis de perception produits par l’histoire des fantasmes suscités par l’archipel, en identifiant plus finement les inflexions propres à la sensibilité barthésienne, on devrait pouvoir accéder à une lecture plus « nuancée » (n’était-ce pas une valeur suprême pour Roland Barthes ?) d’un ouvrage qui occupe une place singulière, et éminente, dans l’œuvre de son auteur comme dans l’histoire des représentations du Japon. Chacun n’aurait-il pas à y gagner ?
Pour organiser un tel croisement des discours et des points de vue, le Centre d’études japonaises (CEJ) de l’Inalco (les « Langues O’ ») – intégré depuis janvier 2019 à l’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (Ifrae) – a organisé pendant trois ans, de 2015 à 2017, un séminaire intitulé « L’Empire des signes. Un objet une époque », où il a tenté de faire se côtoyer, se parler, s’écouter, barthésiens, comparatistes et japonologues, en espérant que se noue entre eux un dialogue inédit.
Il était inconcevable, dans une telle perspective, de ne pas accorder une place éminente au haïku, objet aussi fascinant que difficile à appréhender. Genre important de l’histoire littéraire japonaise, ayant connu de nombreuses transformations, toujours bien vivant aujourd’hui, il a connu en Occident, depuis sa présentation par Basil H. Chamberlain en 1902, une réception particulièrement complexe et productive. Or si le haïku occupe une place centrale dans L’Empire des signes – qu’il s’agisse du nombre des pages et des fragments qui lui sont consacrés, ou du rôle-pivot qui lui est assigné dans l’économie du livre –, si le Haïku a joué en outre un rôle majeur dans l’itinéraire de Barthes[1] : on sait que sa réflexion sur le genre connut un nouveau départ, et une inflexion majeure, dans ses cours au Collège de France en 1978-1979 et 1979-1980[2], ces épisodes sont des moments de cette longue histoire, dont ils sont étroitement dépendants, mais qu’ils vont aussi largement contribuer à modeler, car la vision barthésienne du haïku a puissamment informé la perception ultérieure du genre[3], ainsi que sa pratique[4].
Voilà pourquoi j’ai initié une journée d’étude, « Roland Barthes : Empire des signes, empire du haïku », qui s’est tenue le 8 juin 2017 dans les salons de l’Inalco, au 2 rue de Lille, 75007 Paris. La présente livraison de la revue Roland Barthes en est issue. Tous nos remerciements vont à celles et à ceux qui ont bien voulu participer au séminaire, à cette rencontre et à ce numéro, et toute notre reconnaissance à l’équipe de la revue pour nous avoir si généreusement accueillis, donnant ainsi à nos tâtonnements un prolongement que nous espérons fécond !
La place du haïku dans L’Empire des signes
L’Empire des signes n’est pas toujours lu dans son entière complexité. Son organisation par exemple est particulièrement élaborée. L’ouvrage est ainsi composé de vingt-six textes, qui se succèdent dans un agencement minutieusement concerté. Certains font l’objet de regroupements : en particulier, et dans l’ordre d’apparition, ceux sur la nourriture, l’espace, le théâtre, le haïku, les corps, ces cinq blocs étant séparés ou reliés les uns les autres par des fragments isolés, comme de transition, ceux sur le pachinko, les paquets, les courbettes, la papeterie.
Si le haïku est absent de l’avant-texte comme du fragment inaugural « Là-bas », qui introduisent pourtant les thèmes de l’écriture et du satori, il fait vite son apparition dans l’ouvrage, à propos de la nourriture, puisque un verset sur le « concombre coupé » intervient dans le développement de « Baguettes », consacré au petit et au coupé (ES, 26[5]). Un autre haïku, calligraphie accompagnant un dessin de champignons à l’encre de Chine, est inséré dans le fragment « La nourriture décentrée » (ES, 32), accompagnée d’une longue explication dans la table des illustrations (ES, 153). C’est enfin la comparaison, tirée d’un haïku, avec « un oignon blanc qui vient d’être lavé » (ES, 68) qui sert à caractériser le visage du maître marionnettiste dans le fragment consacré aux « Trois écritures » du bunraku[6].
Ces haïkus servent ici, dans une première partie du livre, à introduire certains traits de la culture japonaise, mais c’est seulement à partir de la dix-septième section de l’ouvrage que quatre textes centrés sur ce genre poétique – « L’effraction du sens », « L’exemption du sens », « L’incident », « Tel » – viennent former un des principaux points de condensation de l’ouvrage. Ces textes sont riches en formules scintillantes, souvent citées, mais ils se succèdent selon une logique globale qu’il convient de saisir pour elle-même.
La première section consacrée au haïku[7], « L’effraction du sens » (ES, 91-95) occupe une place particulière[8] dans l’ensemble de l’œuvre puisque Barthes y explique ce que n’est pas le haïku. Dans la veine des Mythologies, il y critique une certaine vision du genre, qui offrirait au lecteur occidental une écriture « pleine » à bon marché. Concis, le haïku aurait les vertus d’un art classique ; improvisé, celles d’un art romantique, et il serait ainsi attiré dans l’empire du sens par la logique du symbole ou par celle du raisonnement (syllogistique ou tautologique). Barthes cite dans cette section les traductions de six haïkus et il insiste sur la manière dont d’anciens commentateurs (maintenus dans l’anonymat) ont voulu en percer le sens, par une véritable « effraction » dont lui-même se démarque explicitement.
Barthes met ici en péril, au moins partiellement, le pacte de non réalité par lequel il démarrait son ouvrage (« Sans prétendre représenter ou analyser la moindre réalité »). À le suivre, il y aurait donc bien une vérité du haïku japonais que les uns « manqueraient » quand d’autres – lui en l’occurrence – sauraient la saisir. Il semble ainsi vouloir se démarquer des « langages connus » qui ont par le passé tenté d’« acclimater notre inconnaissance de l’Asie » (ES, 10)
Loin des « voies d’interprétation » erronées qu’il condamne, Barthes commence à dessiner en creux sa propre thèse sur un genre qu’il faut lire sans « provoquer le langage », mais au contraire en essayant de le « suspendre », entreprise périlleuse qu’il dit vouloir conduire dans l’esprit même de Bashô.
La deuxième section consacrée au haïku, « L’exemption du sens » (ES, 97-101), est elle aussi unique dans l’économie de l’ouvrage. Barthes, adoptant un discours professoral, y délivre sur un ton doctoral une manière de petite leçon sur un « Zen » qu’il définit par la guerre que ce courant serait censé mener contre la « prévarication du sens ». Enrôlé dans cette « immense pratique destinée à arrêter le langage », le haïku, « branche littéraire » du Zen, se voit caractérisé comme recherche d’un « langage plat », d’une « fin du langage ». Aucun exemple n’est ici donné à l’appui.
La section se poursuit par une manière d’excursus qui manifeste une surprenante inflexion du raisonnement[9]. Le haïku est à présent approché comme travail de « limitation du langage » (et non plus d’arrêt, ou de fin), comme recherche d’une « mesure », d’une « adéquation du signifiant et du signifié », alors même qu’en d’autres passages, les plus nombreux, Barthes parle d’un pays où « le signe s’abolit avant que n’importe quel signifié ait eu le temps de “prendre” » (ES, 148), d’un empire des signes « vides » (ibid.), où le « signifié fuit », où « les signifiants règnent sans contrepartie » (4e de couverture). C’est une véritable tension, quasiment une contradiction, qui s’esquissent ainsi au cœur du discours barthésien sur le Japon, sur le haïku, et sur le signe, mais qui ne connaîtront pas de développement dans la suite de l’ouvrage.
Quoi qu’il en soit, en associant étroitement « Zen » et « Haïku », cette section vient renforcer l’équation « Zen = Japon » présente dès les premières lignes de L’Empire des signes. Elle l’inscrit ainsi pleinement au cœur de la doxa esquissée dans les années 1930 par Suzuki Daisetsu, puis popularisée après la deuxième guerre mondiale, du zen comme déterminant essentiel de culture japonaise[10].
Dans le prolongement de la deuxième section, la troisième, « L’incident » (ES, 102-109) se déploie de part et d’autre d’une double page reproduisant la photographie d’un « Jardin Zen » (ou supposé tel[11]). Elle précise la vision barthésienne du haïku comme art « contre-descriptif ». Débutant par le commentaire de deux poèmes, elle fait du genre un art de « l’événement », du « réveil devant le fait » (ES, 103), une manière de pincer « d’un pli léger », « d’un coup preste, la page de la vie, la soie du langage » (ES, 103).
Barthes voit alors dans deux caractéristiques du haïku, le nombre et la dispersion d’une part, la brièveté et la clôture de l’autre, des moyens de « constituer un espace de purs fragments, une poussière d’événements que rien […] ne peut ni ne doit coaguler, construire, diriger, terminer » (ES, 103), avant d’ajouter, comme corollaire, que le « temps du haïku est sans sujet », que « le haïku nous fait souvenir de ce qui n’est jamais arrivé », qu’il est « répétition sans origine », « événement sans cause », « mémoire sans personne », « parole sans amarres » (ES, 106).
La quatrième et dernière section consacrée au haïku, « Tel » (ES, 110-114), ne fait que prolonger la précédente. Partant de quatre exemples, Barthes revient sur le « travail » du haïku comme « exemption du sens », « à travers un discours parfaitement lisible » mais défiant pourtant toute possibilité de commentaire. Il poursuit ainsi une caractérisation négative d’un genre qui fait disparaître « deux fonctions fondamentales de notre écriture classique », la description et la définition, pour « s’amincir » en une « pure et seule désignation » : « Tel ! » Touche, flash, griffure de lumière, photo sans pellicule, geste désignateur du petit enfant [12] : les métaphores se succèdent pour désigner ce geste minimal qu’est finalement, aux yeux de Barthes (du moins dans L’Empire des signes), le haïku.
Ces quatre sections constituent donc le cœur du discours de Barthes sur le haïku dans L’Empire des signes. Elles forment un tout structuré : réfutation d’une vision erronée du haïku, insertion du genre dans le cadre général du Zen, définition en deux temps du genre comme art de l’événement, puis comme geste minimal.
Cet ensemble de sections consacrées au haïku trouve place dans l’économie générale du livre entre celles qui concernent le théâtre (ES, 68-84) – l’écriture des corps – et celles qui concernent les corps japonais (ES, 120-143 – les corps comme écriture –, auxquelles elles sont reliées via les fragments « Courbettes » (ES, 85-90) – « La Forme est Vide » – et « Papeterie » (ES, 115-119) – « s’introduire dans l’espace des signes ».
Elles viennent ainsi proposer, dans ce qui est comme une seconde partie de l’ouvrage, un fondement théorique d’ensemble, car en réalité, pour Barthes, au Japon tout est haïku. À la fin du fragment « Incident », il expliquait ainsi : « Ce que je dis ici du haïku, je pourrais le dire aussi de tout ce qui advient lorsque l’on voyage dans ce pays que l’on appelle ici le Japon. »
« Là-bas », explique Barthes, « il advient toujours quelque chose ». Et de ces « aventures infimes », sans pittoresque ni romanesque, naît « une ivresse érotique ». Tous les « menus comportements » de la vie japonaise sont perçus comme de « simples façons de passer, de tracer quelque inattendu dans la rue », renvoient à « un mode graphique d’exister », à une « écriture alla prima », comme dit Barthes, en reprenant une image récurrente dans L’Empire des signes[13]. Le Japon tout entier est ainsi fait d’une accumulation de « gestes », « traits », « incidents », qui sont « la matière même du haïku ».
Barthes approfondit encore sa réflexion à propos « Des millions de corps » (ES, 127-133) japonais organisés « selon une dialectique nouvelle […] de la série et de l’individu » en un système qui « vaut par ses points de fuite ». Qu’il s’agisse de corps, d’objets (mouchoirs par exemple), haïkus ou signes idéographiques, tous ces individus ne sont jamais les mêmes, mais leur individualité n’est pas hystérie, « clôture, théâtre, surpassement, victoire », « elle est simplement différence, réfractée, sans privilège, de corps en corps » (ES, 133) : « Combien de haïku dans l’histoire du Japon ? Ils disent tous la même chose : la saison, la végétation, la mer, le village, la silhouette, et cependant chacun est à sa manière un événement irréductible. »
Les équations « Zen = Japon » et « haïku = Zen » sont ainsi définitivement associées en un « Japon = Zen = haïku ».
Haïku barthésien, haiku japonais, réception occidentale du haïkaï
L’utilisation par Roland Barthes de quelques citations de haïku (seize en tout), donnés en traduction, sans source, sans aucune référence (parfois un nom d’auteur ou une date approximative), le discours essentialiste et péremptoire qu’il tient sur le genre, sans aucun souci d’historicité ni de contextualisation, viennent heurter de front le savoir japonologique[14].
Pour ne signaler que quelques points cruciaux, le haïku par exemple n’est qu’une dimension particulière et locale de la culture japonaise, à certains égards secondaire. Si une forme poétique brève occupe une place centrale à l’intérieur de celle-ci, c’est bien plutôt le waka, auquel l’ouvrage fait à peine allusion.
Le haïku d’autre part a fonctionné, pendant la plus grande partie de son histoire, et plutôt sous le nom de haikai, comme un art de l’intertextualité, dont le sens ne peut être perçu hors d’un rapport étroit à la culture littéraire, et singulièrement à ce genre du waka auquel il ne cesse de se référer pour mieux s’en démarquer. Comme l’écrit Haruo Shirane, dans son ouvrage de référence, « l’imagination haikai » implique une certaine attitude à l’égard du langage, de la littérature, de la tradition, qui naît de l’interaction entre une nouvelle culture essentiellement urbaine, centrée sur les guerriers et les gens du commun, et la culture aristocratique ancienne, résiduelle, que le haikai parodie, transforme et traduit en une forme contemporaine. Ce mode spécifique d’imagination prend donc un plaisir ludique à la juxtaposition incongrue et à la collision humoristique de mondes et de langages jusque alors séparés ; elle inverse et reconfigure les associations établies par la culture. Elle prend plaisir à dé-familiariser et à re-contextualiser[15].
Le haikai/haiku a par ailleurs connu dans son histoire japonaise plusieurs évolutions fortes dont la plus importante est sans conteste celle apportée par les réformes de Masaoka Shiki[16] (1867-1902) – que Barthes cite sur le même plan que Bashô au xviie ou Buson au xviiie) – à l’ère Meiji, à la fin du xixe, qui en ont fait un art proprement… descriptif, à partir d’une réflexion aiguë sur les pouvoirs du langage[17].
Et si Barthes a raison de considérer le « nombre » comme une caractéristique du genre, il a tort d’y voir un principe de « dispersion ». Le haikai/haiku est en effet inséparable, au Japon, d’un travail de rassemblement, mise en série, en anthologie ou en recueil.
De même pour la « brièveté » du genre, bien réelle, qui n’est cependant pas « clôture », mais au contraire ouverture sur un intertexte d’autant plus nécessaire que le texte est bref, car, comme le dit très justement Jacqueline Pigeot à propos du waka (mais cela vaut a fortiori pour le haikai/haiku), « si les “unités” formelles de la littérature japonaise (comme le waka) sont brèves, ce n’est pas en raison de quelque goût pour la miniature, mais parce que ces unités n’ont pas l’indépendance de celles de la littérature occidentale (ballade, sonnet, etc.) ; elles sont interdépendantes et se définissent par leur relation avec d’autres éléments : autres poèmes, ou prose[18] ». La condensation du texte n’est possible que par des effets complexes de montage, interne et externe.
Le haikai/haiku par ailleurs n’a cessé de susciter des gloses[19], celles du zen, tardives, n’étant pas les moins intéressantes. C’est seulement au xviiie siècle par exemple, cent ans après la mort de Bashô, que le poème de la grenouille a été rapporté pour la première fois au satori, et c’est seulement dans les années 1860 qu’un dialogue zen prétend rendre compte de sa composition. Il est assez cocasse, de ce point de vue, de voir les commentaires de Barthes sur une pratique censée défier le commentaire venir ajouter une couche supplémentaire, sur le mode du déni, à l’immense millefeuille suscité depuis ses origines par ce genre supposé destiné mettre fin aux bavardages herméneutiques.
Quant aux rapports entre zen et haikai/haiku, même s’il est exagéré de nier toute connexion entre eux[20], le lecteur occidental doit cependant savoir que la plupart des ouvrages japonais ou japonologiques sur le haïku me mentionnent quasiment jamais cette branche du bouddhisme (absente par exemple de l’index très complet du livre de Haruo Shirane), et que c’est fondamentalement à partir des ouvrages de Blyth que cette association s’est imposée dans le discours des amateurs occidentaux de haïku[21], tout en demeurant rejetée, ou tenue à distance, par les pratiquants ou commentateurs japonais du genre, tout comme par les spécialistes de littérature japonaise (rappelons-nous la guerre menée par René Sieffert contre les zennistes[22], ou par Étiemble[23] et son « zut au zaine[24] »).
On pourrait ainsi se demander si Barthes ne passe pas complètement à côté de la réalité historique du haikai/haiku japonais, si même il ne procède pas, comme le cuisinier de tenpura avec l’anguille vivante, à une véritable mise à mort du réel japonais, pour en faire « de la dentelle », « un petit bloc de vide », une « collection de jours », un « objet purement intersticiel » (ES, 35). Mais est-ce complètement vrai ? Le haïku ne résiste-t-il pas au traitement que lui inflige l’auteur, à cette mise à mort annoncée ? Barthes n’est-il pas aussi parvenu, dans son effort pour saisir le genre en multipliant formules et intuitions, à quelques fulgurances qui, au-delà des erreurs et malgré les contresens – grâce à ces contresens ? –, ont aussi leur part de beauté, et même parfois, paradoxalement, de vérité ?
Le rapport de Barthes au haïku interroge aussi fortement les spécialistes de la réception du haïku en Occident. L’écart important qui se fait jour entre la réalité japonaise du genre et le discours qu’il tient à son sujet lui est-il propre ? Ces idées étranges, les a-t-il inventées ou reprises ? Et à qui ? Comment s’est forgée la vision barthésienne du haïku ? de quelles lectures, de quelles analyses, est-elle tributaire ? À quels moments de la réception occidentale du genre s’articule-t-elle ?
Le discours de Barthes semble vouloir s’opposer à celui du japonisme de la première vague, incarné en France par Paul-Louis Couchoud qui, dès 1906, dans un article de la revue Les Lettres, « Les Haï-Kaï. Les épigrammes poétiques du Japon », le définisssait comme « un simple tableau en trois coups de brosse, une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche, une impression ». Il semble au contraire être largement tributaire d’une deuxième vague de discours, venue des États-Unis après la deuxième guerre mondiale, portée par les ouvrages de Suzuki Daisetsu, Alan Watts, Reginald H. Blyth ou Jack Kerouac, associant étroitement ce genre au courant zen du bouddhisme japonais. Mais ne faut-il pas nuancer ? Barthes, ne l’oublions pas, est né en 1915, et sa formation est celle d’un jeune d’homme d’avant-guerre. N’est-il pas plus tributaire qu’on ne pourrait le penser de la première vague japoniste ? Et participe-t-il vraiment sans réserve de la seconde ? Ne la réinterprète-t-il pas à sa manière ?
Mettre au jour l’intertexte de L’Empire des signes, particulièrement important dans ce domaine[25], permettrait de se débarrasser une fois pour toute du mythe de « la naïveté du premier regard » d’un voyageur se fiant à ses seules impressions[26].
« Roland Barthes : Empire des signes, empire du haïku »
Pour commencer à répondre à l’ensemble de ces questions, les auteurs ici rassemblés ont poursuivi plusieurs pistes.
Forte de son incomparable connaissance de la réception occidentale du haïku, Muriel Détrie situe historiquement la vision barthésienne de L’Empire des signes, montrant de manière lumineuse comment celle-ci est beaucoup plus tributaire qu’on ne pourrait l’imaginer de la vision d’avant-guerre, mais aussi ce que son interprétation « Zen » du genre a d’idiosyncrasique. Evelyne Lesigne-Audoly apporte une pièce importante au dossier en présentant de manière méthodique, pour la première fois en langue française, la vision – elle aussi « zen » – du haïku de Reginald H. Blyth, vision dont Barthes s’est à la fois inspiré et détaché. Je contribue pour ma part à ces questionnements en partant à la recherche des sources des haïku cités par Barthes : sources occidentales (français, anglaises et allemandes), qui permettent de comprendre comment Barthes se situe à la croisée des deux réceptions du genre, du japonisme d’avant-guerre et du néo-japonisme d’après-guerre ; sources japonaises aussi, qui permettent de revenir aux textes originaux et de mesurer à quel point Barthes est tributaire des traductions qu’il utilise.
Grandes connaisseuses de poésie japonaise, Makiko Andro-Ueda et Terada Sumie, approfondissent les sentiments ambivalents que suscitent en elles L’Empire des signes pour la première, La Préparation du roman pour la seconde. Riches d’erreurs et de contresens, ces deux œuvres touchent parfois juste dans la compréhension du haïku, comme malgré elles, sans doute à cause de l’acuité de la réflexion barthésienne sur les pouvoirs de la littérature et du langage.
Tiphaine Samoyault, qu’il n’est pas besoin de présenter aux barthésiens, revient elle aussi sur le dernier cours de Barthes au Collège de France pour mieux mettre en valeur, à partir des affinités entre ces deux formes accueillantes, le rôle du Haïku dans la préparation au roman.
Nous bénéficions enfin de l’aimable érudition de notre collègue Michel Vieillard-Baron, qui nous éclaire savamment sur les maigres références de Roland Barthes au waka, la forme brève majeure de l’histoire de la poésie japonaise, qui n’apparaît qu’incidemment dans L’Empire des signes.
Formulons le vœu que ce travail commun entre barthésiens, imagologues et spécialistes du Japon autour du haïku dans L’Empire des signes se poursuive et s’étende à l’ensemble de l’ouvrage, dans toutes ses dimensions ! Plus largement, c’est vers une étude croisée des différents japonismes, ou néo-japonismes, et au-delà de l’ensemble des transferts culturels, qu’il faudrait de concert se diriger.
notes
- Barthes tente des essais de haïku dans Fragments d’un discours amoureux en 1977 (« Inexprimable amour »). ↑
- Il existe deux éditions de ce cours, celle des notes préparatoires en 2003, celle de la version prononcée en 2015 : Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Seuil / IMEC, coll. « Traces écrites », 2003 ; Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger et Éric Marty, Paris, Seuil, 2015. Sur le haïku dans le cours, voir le bel article de Philippe Forest, « Haïku et épiphanie : avec Barthes, du poème au roman », Ebisu, n°35, 2006. p. 159-165. www.persee.fr/doc/ebisu_1340-3656_2006_num_35_1_1443 ↑
- Comme le signale justement Mutiel Détrie dans le présent numéro, les formules de Barthes ont été très souvent reprises. Récemment, par exemple, Chantal Jaquet, professeur de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consacre au haïku quelques pages de sa Philosophie du kôdô. L’esthétique japonaise des fragrances (Vrin, 2018, p. 204-206). Elle s’y appuie explicitement sur la vision barthésienne du genre qu’elle définit comme « prompt à saisir les choses au bond ». « Simple poésie de l’événement », le haïku se caractériserait par la « rareté des liaisons » et « l’absence de copule », qui contribuent l’une et l’autre à « disloque[r] le sens ». « Libérés de la logique du sens et de la discursivité du concept », les mots restituent alors « l’immédiateté de la présence », ils impliquent « une forme d’adhésion aux choses ». ↑
- Rappelons l’extraordinaire vitalité contemporaine du genre, en Occident comme au Japon, bien que dans des esprits très différents. ↑
- Nous citons L’Empire des signes d’après le fac-similé de l’édition originale de 1970 (Skira), paru aux éditions du Seuil en 2015, sous la forme ES, puis un numéro de page. ↑
- Une autre allusion est faite à ce haïku, à propos du visage du général Nogi, « comme sorti de l’eau, lavé de sens » (ES, 126). ↑
- Une image, bizarrement suggestive, d’un concombre et de deux aubergines, est insérée au cœur de cette section (ES, 95). ↑
- Dans L’Empire des signes, l’écriture, l’argumentation, le rapport au réel, à l’expérience, les sources, sont très fluctuants. ↑
- Sous l’impression de nappé que donne le discours barthésien, il existe des tensions entre plusieurs thèmes, des ruptures, voire des incohérences. Le haïku est-il vide de signifié, ou propose-t-il une adéquation du signifiant et du signifié ? Le Japon est-il le pays du kôan « insensé » ou du haïku « insignifiant » (Maurice Pinguet, Le Texte-Japon, Seuil, 2009, p. 43) ? ↑
- Voir Emmanuel Lozerand, « Les contrebandiers du zen. Sur le rôle des passeurs dans un processus de cosmopolitisation », in G. Bridet, X. Garnier, S. Moussa et L. Zecchini (dir.), Littérature et cosmopolitisme, « Écritures », Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2019. ↑
- Si le temple Tôfuku-ji a bien été fondé en 1236, comme le dit la « Table des illustrations », le jardin – moderniste – a été conçu en 1939 par Shigemori Mirei… La photo est accompagnée d’une sorte de poème court : « Nulle fleur ; nul pas ; / Où est l’homme ? / dans le transport des rochers / dans la trace du râteau / dans le travail de l’écriture. » (ES, 105). ↑
- Il y a du retour en enfance dans L’Empire des signes. Pensons à la baguette « maternelle » et au « riz en flot de lait » (ES, 29). ↑
- A propos du Pachinko (ES, 42), du tracé des caractères chinois (Papeterie, ES 116), et de la « Paupière » (ES, 134). ↑
- Le haiku a suscité un nombre impressionnant de malentendus et de contresens. Pour des exemples nord-américains, voir le remarquable article de Haruo Shirane, « Beyond the Haiku Moment:Basho, Buson and Modern Haiku myths », in Modern Haiku, XXXI:1 (winter-spring 2000).http://www.haikupoet.com/definitions/beyond_the_haiku_moment.html ↑
- Haruo Shirane, Traces of Dreams. Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Basho, Standford University Press, 1998, p. 2 et 8. ↑
- Voir Masaoka Shiki, Un lit de malade six pieds de long, tr. par Emmanuel Lozerand, Les Belles Lettres, 2016. ↑
- Voir à ce sujet, Ôe Kenzaburô, « La thématique de Shiki », tr. par Emmanuel Lozerand, Critique, no 839, « Et le Japon devint moderne… », éditions de Minuit, avril 2017, p. 276-289. ↑
- Jacqueline Pigeot, Questions de poétique japonaise, Paris, PUF, 1997, p. 7. ↑
- Voir par exemple Ueda Makoto, Bashō and His Interpreters: Selected Hokku With Commentary, Stanford University Press, 1992. ↑
- Voir l’article d’Evelyne Lesigne-Audoly dans la présente livraison de la revue Roland Barthes. ↑
- Chez Chamberlain, c’est Bashô qui est décrit en moine zen, mais pas le haïku en branche du bouddhisme. ↑
- René Sieffert écrit dans Le Haïkaï selon Bashô (P.O.F, 1989, p. X) : « Reste le haïkaï, qui constitue l’un des derniers bastions de la mystification japonolâtre. Pour parler du nô, il fallait plus que de l’aplomb, car un minimum de connaissances était requis. Il n’en va pas de même pour le haïkaï, dont l’apparente facilité semble avoir excité la verve de certains déchiffreurs de signes ou de quelques poètes plus ou moins japoniaisants. C’est ainsi qu’on a vu fleurir en Occident, et en France entre autres, des anthologies, certaines traduites, ce qui est un comble pour un art que l’on dit « subtil », de versions anglaises à tendance zenniste (ce qui est un comble encore, mais du contresens cette fois). Et d’insister sur la spontanéité de l’inspiration, sur la liberté de l’improvisation, la métrique, par contre, étant considérée comme chose sans importance. » Il ajoute : « […] le haïkaï n’a rien à voir avec les théories fumeuses des zennistes […] il se situe en fait aux antipodes exactement de ces élucubrations. » ↑
- Etiemble, dans Du Haïku (éd. Kwok On, 1995, p. 55), évoque le « numéro classique de zen au rabais » de Reginald H. Blyth, le spécialiste anglo-saxon du haïku, son « laïus pseudo métaphysique » et la « spiritualité gluante » qui l’imprègne… ↑
- René Etiemble, « Zut au Zaine ! Vive le Zen ! », Les Lettres nouvelles, n°9, 29 avril 1959, p.10-16. ↑
- Maurice Pinguet se trompe, au moins partiellement quand il écrit : « Il se garda bien de rassembler les connaissances de seconde main qui épaississent tant les livres des voyageurs » (Maurice Pinguet, Le Texte-Japon, Seuil, 2009, p. 31). ↑
-
Maurice Pinguet , ibid. ↑