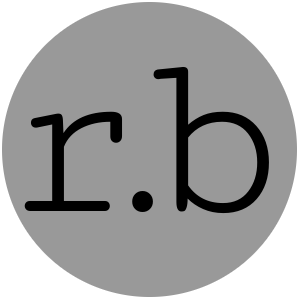Dans les études concernant la réception du haïku en France, il est habituel de diviser celle-ci en deux périodes : une première qui commence au début du xxe siècle avec l’introduction du haïku par Paul-Louis Couchoud et qui crée dans les années 1920 une véritable vogue, et une seconde qui, après une relative désaffection à l’égard du haïku, le ramène sur le devant de la scène littéraire dans les années 1960-1970 sous l’effet de l’influence américaine et se poursuit jusqu’à aujourd’hui[1]. Par rapport à la première phase de réception qui manifesterait surtout un intérêt pour le haïku en tant que forme poétique nouvelle, la seconde serait caractérisée par une interprétation du haïku à la lumière du zen.
L’Empire des signes, qui paraît pour la première fois en 1970 et dont plusieurs chapitres traitent du haïku, semble constituer un jalon important de cette deuxième phase. En effet, la plupart des anthologies ou manuels consacrés au haïku et destinés à un grand public qui paraissent régulièrement depuis les années 1970, se réclament plus ou moins de Barthes, soit en plaçant en épigraphe une citation de L’Empire des signes, soit en le citant pour expliquer ce qu’est le haïku, soit en le faisant figurer dans leur bibliographie, comme si l’écrivain faisait autorité en la matière[2]. En revanche, les auteurs qui ont contribué à populariser le haïku durant la première moitié du xxe siècle sont généralement oubliés. Est-ce à dire que Barthes a marqué un tournant dans la réception du haïku en proposant de celui-ci une vision qui est en rupture avec la réception antérieure et qui préfigure la réception ultérieure ? En replaçant Barthes dans l’histoire de la réception du haïku en France, et en situant sa vision du haïku par rapport à celle de ses possibles sources, nous verrons qu’en fait, sur un certain nombre de points, L’Empire des signes prolonge une vision du haïku que ses premiers introducteurs avaient déjà esquissée, et par ailleurs que son interprétation des liens entre zen et haïku est sensiblement différente de celle qu’on trouve chez ses informateurs ou chez ceux qui se réclament de lui aujourd’hui.
Petite histoire de la réception du haiku en France
Au moment où Barthes écrit L’Empire des signes, le haïku a déjà été introduit en France depuis soixante ans, et il n’a jamais vraiment disparu de la scène littéraire. Paul-Louis Couchoud, qui a visité le Japon en 1903-1904 en bénéficiant d’une bourse de la fondation Albert Kahn, a été le premier à l’évoquer pour le grand public dans un important article, « Les Haï-Kaï. Les épigrammes poétiques du Japon », paru en 1906 dans la revue Les Lettres. L’auteur, comme il le reconnaît lui-même, tire l’essentiel de son information de deux publications antérieures de japonologues dont la diffusion était restée confidentielle : « Bashô and the Japanese Poetical Epigram » de Basil Hall Chamberlain, publié en 1902 dans les Transactions of the Asiatic Society of Japan, et surtout le compte rendu que Claude-Eugène Maître, avec qui il a entretenu des relations amicales au Japon, a fait de l’article de Chamberlain dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient en 1903. Dix ans plus tard, Couchoud a repris son article, sous le nouveau titre « Les épigrammes lyriques du Japon », dans un volume, Sages et poètes d’Asie, préfacé par Anatole France, où il a regroupé tous les écrits que lui avait inspirés son voyage en Asie, et il l’a complété par des exemples de « haïkaïs français » suscités par son article même, comme les « haïkaïs de guerre » de Julien Vocance parus en 1916[3], qui avaient fait alors grand bruit, ou des haïkaïs choisis parmi ceux qu’il avait lui-même composés en compagnie de deux amis lors d’un voyage sur les canaux français en 1905[4]. À la fois étude et anthologie (plus de 150 haïkus japonais y sont cités, de Bashô et de ses disciples, mais aussi et surtout de Buson), cet essai, qui a eu une énorme audience (Sages et poètes d’Asie connaîtra en 1923 sa quatrième édition !), a fixé les grands traits de la première phase de réception du haïku en France. Il a par ailleurs lancé un vaste mouvement d’intérêt pour le haïku qui s’est traduit par un grand nombre d’imitations et adaptations de cette forme japonaise, mais aussi d’articles critiques qui ont débattu de sa valeur littéraire. Cette vogue du haïku a culminé en 1920 après la publication d’un numéro de La Nouvelle Revue Française débutant par un dossier intitulé « Haï-kaïs » et introduit par Jean Paulhan, où figurent les productions d’une douzaine d’écrivains français parmi lesquels, outre Couchoud et Vocance, on trouve Paul Eluard, Jean-Richard Bloch ou Jean Paulhan lui-même[5].
Après Couchoud, c’est son ami René Maublanc, écrivain et philosophe, qui se charge dans les années 1920 de populariser le haïku dans la revue rémoise Le Pampre où il publie, outre de nombreux haïkus de lui-même et d’autres poètes, une bibliographie et des articles critiques sur cette forme poétique nouvelle qu’il appelle « le haïkaï français[6] ». Bien que le haïku passe un peu de mode à partir des années 1930, on peut encore signaler la publication, en 1937, du Livre des haïkaï de Julien Vocance où le poète ami de Couchoud, qui a été l’un des premiers à adapter la forme en français durant la Première Guerre mondiale et qui lui est toujours resté fidèle dans les décennies suivantes, a rassemblé l’ensemble de sa production et où figure notamment un « Art poétique » qui nous renseigne sur la manière dont un poète français conçoit alors le haïku. D’autres écrivains publient encore, dans diverses revues, des poèmes appelés « haïkaïs » dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et en 1942 Paul Claudel republie chez Gallimard son recueil Cent phrases pour éventails qui avait connu une édition de luxe au Japon en 1927, avec une Préface où il reconnaît sa dette à l’égard du haïku en disant avoir voulu « mêler » ses phrases « à l’essaim rituel des haïkaï[7] ».
Durant la période de l’entre-deux guerres, le haïku suscite aussi nombre de traductions : après ceux cités par Couchoud, on peut lire en traduction française plusieurs dizaines de haïkus japonais dans l’Anthologie de la littérature japonaise de Michel Revon parue en 1910 ; on en trouve quelques autres dans le recueil de poèmes japonais Sur des lèvres japonaises que publie la jeune Franco-japonaise Kikou Yamata en 1924 avec une préface de Paul Valéry ; Émile Steinilber-Oberlin, avec l’aide du Japonais Kuni Matsuo [Matsuo Kuninosuke], fait paraître en 1927 une anthologie de Haïkaï de Kikakou, célèbre disciple de Bashô, et en 1936 tous deux signent encore une anthologie de Haïkaï de Bashô et de ses disciples, accompagnée de peintures de Foujita ; enfin au cours de la même année 1935, le japonologue Georges Bonneau consacre un petit volume bilingue aux Haïku de Bashô et Issa, en même temps qu’il présente un grand nombre de haïkus dans son Anthologie de la poésie japonaise.
On ne peut donc dire comme le font Étiemble, et à sa suite d’autres critiques, que « la vogue du haïku s’arrête […], brusquement, après 1925[8] » : certes, l’engouement des premiers temps est passé, mais le haïku, sous ce nom qui supplante peu à peu, comme au Japon, celui, d’usage plus ancien, de haïkaï, se fait dans les années 1920 et 1930 de mieux en mieux connaître et accepter dans le paysage littéraire français, et les revues ne cessent pas de s’y intéresser. À titre d’exemple de cet intérêt durable, signalons que, dans sa livraison du 2 avril 1938, le journal Les Nouvelles littéraires consacre une pleine page à « La Poésie japonaise », signée de Kikou Yamata, dans laquelle celle-ci accorde une bonne place à ce qu’elle appelle encore « le Haïkaï[9] ». D’ailleurs, Étiemble lui-même témoigne de cette survivance du haïku au-delà de 1925. En effet, en ouverture de l’Avant-propos à son recueil d’articles Du Haïku paru en 1995 aux éditions Kwok’On, il évoque sa découverte du haïku qui s’est produite justement dans les années 1930 : « Parmi les dates essentielles de ma naissance à la culture, […], je n’oublierai jamais ce 31 décembre 1934 où je découvris et acquis au Quartier latin les Haïkaï de Kikakou […] ». Et il ajoute plus loin : « La découverte du haïkaï allait me métamorphoser, en tant du moins que lecteur de poèmes […][10]. »
Même si la poésie ne l’a jamais beaucoup attiré pour sa part, il est permis de penser que Barthes, tout comme Étiemble dont il est le cadet de quelques années seulement, a également connu cette forme poétique durant ses années d’études, lui qui lisait nombre de revues littéraires où il n’était pas rare de voir paraître des « haïkaïs » ou « haïkus », qu’ils soient traduits du japonais ou écrits par des poètes français. Mais quoi qu’il en soit, on sait que son intérêt pour le haïku s’est manifesté bien plus tard, dans les années 1960, lorsqu’il effectua plusieurs voyages au Japon (un premier en 1966 et deux en 1967, entrecoupés d’un séjour aux États-Unis où il eut tout loisir de se documenter sur le Japon en général et sur le haïku en particulier), voyages qui donnèrent lieu ensuite à la composition de L’Empire des signes.
Or dans les années 1960, après une relative éclipse durant et après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons assez évidentes, le haïku connaît un regain d’intérêt en Occident, suscité par l’engouement pour le zen. Le zen avait été introduit aux États-Unis dans les années 1930 par Suzuki Daisetsu et ses Essays on Zen Buddhism qui sont traduits en français à partir des années 1940. Mais c’est surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les ouvrages sur le zen se multiplient, suscitant une véritable vogue au sein de la jeunesse américaine en quête d’alternative à la société de consommation[11]. Parmi ces ouvrages, figurent au premier rang ceux de Reginald Horace Blyth : Zen in English Literature and Oriental Classics, publié en 1942, et surtout les quatre volumes intitulés Haiku qui paraissent de 1949 à 1952 (ils seront plusieurs fois réédités, notamment en 1964) et A History of Haiku paru en deux volumes en 1963-1964[12]. Bien que le lien entre zen et haïku ait déjà été établi par Suzuki[13], c’est Blyth qui l’impose véritablement en affirmant dès son premier volume de la série Haiku : « Haiku are to be understood from the Zen point of view » ou encore « haiku is a form of Zen[14] ». Par ailleurs, l’Anglo-américain Alan W. Watts, qui se fait le vulgarisateur aux États-Unis des religions orientales et du zen en particulier qu’il a découvert à travers les essais de Suzuki et de Blyth, consacre plusieurs pages de son essai The Way of Zen (1957, traduit en français en 1960 sous le titre Le Bouddhisme zen) au haïku dont il fait une « poésie sans parole » (« a worldless poetry ») issue du zen [15]. À ces ouvrages sur le zen et le haïku, on peut ajouter diverses traductions de Bashô en anglais, notamment celles de ses journaux de voyage[16], qui contribuent à populariser l’image erronée de Bashô en moine zen itinérant, image qui marque les écrivains de la Beat Generation comme Jack Kerouac et Gary Snyder, et qui persiste encore aujourd’hui.
Toutes ces publications anglo-saxonnes qui lient haïku et zen sont peu à peu révélées au public français par des traductions ou adaptations, et relancent l’intérêt pour le haïku, mais avec un certain décalage par rapport aux États-Unis. En effet, c’est plutôt dans les années 1970 que de nouvelles anthologies de haïkus japonais commencent à paraître en France : après l’Anthologie de la poésie japonaise classique de Gaston Renondeau parue chez Gallimard en 1971, on peut signaler celle de Roger Munier, Haiku, et celle de Maurice Coyaud, Fourmis sans ombre, publiées toutes deux en 1978, ainsi que les traductions des Journaux de voyage de Bashô[17] et des « Sept livres de l’école de Bashô » dues à René Sieffert qui commencent à paraître dans les années 1980 aux Publications Orientalistes de France. L’Empire des signes, que Roland Barthes termine d’écrire en 1968 et publie en 1970, peut donc sembler un précurseur de cette nouvelle vague d’intérêt pour le haïku, mais est-ce à dire qu’il rompt avec la première vague ?
Barthes et la réception du haïku d’avant-guerre
Dans L’Empire des signes, Barthes ne cite aucune source française sur le haïku, mais l’on sait qu’il a lu les écrits de Suzuki, de Watts et de Blyth, en traduction française ou directement en anglais, durant son séjour aux États-Unis qui précède la publication de son essai sur le Japon[18]. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ait tout ignoré du haïku tel qu’il avait été traduit, commenté, interprété en France antérieurement à son essai. L’examen des sources des haïkus cités par Barthes[19] montre effectivement que Barthes a puisé aussi bien dans des ouvrages anglais des années d’après-guerre (notamment Blyth, Haiku, 1949-1952 ; Alan Watts, The Way of zen, 1957, trad. fr. Le Bouddhisme zen, 1960) que dans des anthologies françaises de l’entre-deux guerres (notamment Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, 1924 ; Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin, Matsuo Bashô et ses disciples, 1936). Comment Barthes se situe-t-il donc par rapport à ces sources très diverses et à quelle phase de réception se rattache-t-il ? L’espace nous manquant ici pour traiter la question sous tous ses aspects, nous allons l’envisager sous le seul aspect de la forme, qui est celui qui a le plus intéressé Roland Barthes.
Les haïkus que cite Barthes dans L’Empire des signes se présentent tous sous la forme d’un tercet, à une exception près[20]. Cette interprétation du haïku comme un tercet est celle que d’emblée ont proposée les premiers introducteurs du haïku en France et elle s’est immédiatement imposée à tous, traducteurs comme commentateurs, Kikou Yamata étant la seule à lui avoir préféré la forme du distique. La forme du tercet ne va cependant pas de soi, le haïku se présentant en japonais sur une seule ligne ou colonne dans les éditions typographiées, et les caractères qui servent à le noter pouvant être disposés tout à fait librement lorsqu’il est calligraphié. Dans la réception anglo-saxonne, les manières de transposer la forme du haïku ont été plus diverses : Asatarô Miyamori qui a publié en 1932 An Anthology of Haiku a présenté ses traductions sous la forme du distique qui permet de rendre compte de la structure bi-partite de la plupart des haïkus ; Nobuyuki Yuasa, dans sa traduction des journaux de voyage de Bashô, comme déjà dans sa traduction du journal parsemé de haïkus Ora ga haru de Kobayashi Issa (The Year of My Life, 1960), a adopté pour sa part la forme du quatrain (« a four-line stanza »), car elle permet de mieux rendre, selon lui, le « langage familier » (« the colloquialism[21] ») du haïku. Quant à Blyth, dans son anthologie Haiku en 4 volumes, il cite les haïkus japonais, à la fois en écriture japonaise et en transcription phonétique, en les présentant sur une seule ligne, même s’il les traduit ensuite sous forme de tercets. La forme du tercet finira aussi par s’imposer dans le monde anglo-saxon, mais à l’époque où Barthes compose L’Empire des signes, ce n’est pas encore le cas, comme le montre l’exemple de Jack Kerouac qui adopte la forme de la ligne continue lorsqu’il cite des haïkus japonais ou en compose lui-même[22].
Le haïku a été d’emblée présenté comme un tercet dans la réception française parce que les trois groupes rythmiques de 5, 7 et 5 mesures[23] qui le composent ont été interprétés comme des vers de cinq, sept et cinq syllabes. Mais si Barthes adopte presque systématiquement la forme du tercet, ce n’est nullement pour transposer le haïku dans le système prosodique français et en faire un poème. Il est significatif que nulle part dans L’Empire des signes le haïku ne soit désigné comme un « poème » ou une « forme poétique », et qu’il faille attendre plusieurs pages, dans le premier chapitre qui lui est consacré (« L’exemption du sens »), pour trouver, au détour d’une phrase et entre parenthèses, une mention de sa forme prosodique : « Ou encore, on veut à tout prix voir dans le tercet du haïku (ses trois vers de cinq, sept et cinq syllabes) un dessin syllogistique […][24]. » Ces « trois vers de cinq, sept et cinq syllabes » ne se retrouvent d’ailleurs dans aucun des haïkus qui y sont cités. Certes, ce non-respect du rythme 5-7-5 est le fait des traducteurs français qu’a utilisés Barthes, mais lorsqu’il a lui-même retraduit en français des traductions anglaises, il n’a en rien cherché à retrouver ce rythme et lorsque, dans Fragments d’un discours amoureux, après avoir cité un haïku de Bashô, il s’essaiera lui-même à l’écriture d’un haïku en en proposant plusieurs versions, il ne se préoccupera pas plus de rythme prosodique[25].
Si elle a été celle de la plupart des traducteurs[26], cette indifférence à l’égard de la prosodie du haïku a aussi été celle de la plupart des premiers commentateurs et praticiens du haïku. Paul-Louis Couchoud décrit bien la forme du haïku dans la toute première phrase de son essai : « Un haïkaï est une poésie japonaise en trois vers, ou plutôt en trois petits membres de phrase, le premier de cinq syllabes, le second de sept, le troisième de cinq : dix-sept syllabes en tout. C’est le plus élémentaire des genres poétiques. » Mais il ajoute aussitôt : « Peut-on même appeler poésie un tercet où il n’est tenu compte ni de rime, ni de quantité, ni d’accentuation, où le nombre même des syllabes admet quelque licence[27] ? », ce qui revient à mettre en doute que le haïku soit une forme poétique. Dans la suite de son essai, il ne revient plus du tout sur la forme prosodique du haïku, et aucun des haïkus qu’il traduit ne la respecte. Et lorsqu’il évoque pour finir les « haïkaïs français » qu’il s’est efforcé de faire avec deux amis « au cours d’un voyage en bateau », il précise bien que ceux-ci sont « sans règle prosodique, à l’imitation non des originaux japonais, mais des traductions françaises[28] ». Ce haïku en vers libres qu’ont inventé les traducteurs est celui qu’imiteront aussi tous ceux qui s’essaieront à cette forme à la suite de Couchoud. Certes, on débattra dans les années 1920 pour savoir si le haïku est encore de la poésie alors qu’il n’obéit à aucune règle métrique, et certains poètes s’essaieront à des schémas prosodiques divers pour tenter de remédier à l’absence de règles, mais ces tentatives n’aboutiront pas et les haïkus resteront, pour leurs lecteurs ou praticiens français, « des petites pièces en trois lignes » qui « ne prétendent pas au titre de poèmes », comme le revendiquera René Maublanc pour ses Cent Haïkaï[29].
Indifférent à la forme métrique du haïku, Barthes l’est aussi, dans L’Empire des signes[30], à l’égard de ses autres caractéristiques formelles qu’a définies Bashô, le maître du genre, notamment la nécessité d’un kigo (ou « mot-saison ») et l’emploi d’un kireji (ou « mot-césure »). Il pouvait pourtant les connaître, car Blyth les a présentées dans la section « The Technique of Haiku » de son premier volume Haiku. En cela, il suit plutôt, une fois, encore, les premiers introducteurs du haïku qui ont pareillement ignoré ces règles du haïku selon Bashô. Le seul trait formel du haïku qu’il retient, finalement, est l’extrême brièveté, une brièveté qui n’est pas celle des dix-sept mesures que compte le haïku japonais et qui lui importent peu, mais celle de « l’incident », de « la chose comme événement[31] » que saisit le haïku. Ainsi, pour Barthes, si le haïku n’est pas une forme poétique, il reste bien une forme, mais une forme qui n’est ni artificielle ni imposée, car elle est « adéquation du signifiant et du signifié » : « La brièveté du haïku n’est pas formelle ; le haïku n’est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste[32]. »
On comprend dès lors l’attachement de Barthes à la forme du tercet malgré son indifférence à la métrique : disposés selon les trois lignes du tercet, les mots du haïku constituent une sorte de bloc visuel qui brise la linéarité obligée du langage et transforme l’énoncé en un objet compact que l’on peut appréhender d’un seul coup d’œil, comme l’ « événement » qu’il transcrit. Cet effet est d’autant plus frappant que les tercets sont isolés sur la page par des marges blanches, des marges sans lesquelles on comprendrait mal que pour Barthes les haïkus constituent, par « leur nombre et leur dispersion d’une part, la brièveté, la clôture de chacun d’eux d’autre part », « un espace de purs fragments, une poussière d’événements[33] ». Il est significatif à cet égard que Barthes transforme un haïku traduit par Kikou Yamata sous forme de distique :
Je vis la première neige.
Ce matin-là, j’oubliai de laver mon visage[34].
en un tercet, isolé par des blancs, qui apparaît d’autant plus ramassé et compact qu’il est réorganisé syntaxiquement et placé entre des parenthèses :
(Je vis la première neige.
Ce matin-là j’oubliai
De laver mon visage.)[35]
Mais on pourrait trouver maints exemples de semblables effets visuels parmi les haïkus japonais cités par Couchoud ou les « haïkaïs français » publiés par La Nouvelle Revue Française. On peut d’ailleurs penser que c’est par référence à leur aspect graphique de très petites pièces compactes et discontinues que Jean Paulhan présentait dans cette dernière les « Haï-kaïs » comme de simples « miettes[36] ».
Pour réaliser cette « adéquation du signifiant et du signifié », le haïku selon Barthes ne se doit pas seulement d’être bref, il doit user d’un langage simple, concret, sans artifice, sans profondeur ni symbolisme, un langage qui n’obéit à aucun code et ne dit que ce qu’il dit, au sens propre : « le haiku opère […] en vue d’obtenir un langage plat, que rien n’assied (comme c’est immanquable dans notre poésie) sur des couches superposées de sens, ce que l’on pourrait appeler le « feuilleté » des symboles[37]. » En se faisant pure dénotation, le langage du haïku se rend homologue à ce qu’il dit et se suffit à lui-même, n’impliquant aucun non-dit et n’appelant aucun prolongement : « la dénégation du « développement » est ici radicale[38] ». Ainsi conçu, le langage du haïku se rapproche du style de la peinture chinoise ou japonaise, et en particulier celle de style haiga, qui n’est faite que de quelques « traits[39] », comme le montre la légende que donne Barthes à la peinture « Aubergine et concombre » du chapitre « L’effraction du sens » et qui prend quasiment la forme d’un haïku métapoétique : « Un concombre et deux aubergines, énoncés à la lettre, comme trois vers de haïkus[40] ».
La simplicité du langage du haïku, son absence totale de rhétorique et son effort pour faire coïncider signifiant et signifié, toutes caractéristiques qui vont de pair avec sa brièveté, c’est aussi ce sur quoi les premiers interprètes français du haïku ont mis l’accent. Paul-Louis Couchoud l’a le premier souligné : « Du poème japonais surtout, le discursif, l’explicatif sont extirpés. […] La poésie s’engloutit dans la sensation pure, elle se défend de lui donner une suite[41]. » Après lui, Jean Paulhan dira encore : « Il est difficile d’écrire plus court ; l’on dira : moins oratoire[42]. » Quant à Julien Vocance, il débutera son « Art poétique » paru pour la première fois en 1921 avec la courte strophe :
Le poète japonais
Essuie son couteau :
Cette fois l’éloquence est morte[43].
Et tous, à la suite de Chamberlain qui déjà établissait des comparaisons entre peinture et haïku, ils parlent du haïku en termes picturaux, tel Couchoud qui présente le haïku comme « un simple tableau en trois coups de brosse, une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche[44] », et qui observe aussi qu’au Japon haïku et esquisse sont équivalents : « Dans le premier cas le pinceau a tracé des mots, dans le second des traits, mais l’œil qui a vu est le même[45]. » Paul Claudel a tenté quant à lui de faire se rejoindre véritablement les deux langages en calligraphiant de sa main ses « phrases pour éventails » et en disposant lettres et mots librement sur la page de manière à combler le fossé entre les mots et les choses. Malgré cette recherche d’une adéquation du signifiant et du signifié, les « faiseurs de haï-kaïs », comme les appelle Jean Paulhan, ne pourront s’empêcher cependant d’user de figures rhétoriques, de tendre parfois vers l’abstraction ou le symbolisme, voire de cultiver une certaine préciosité. C’est que, comme le note Paul-Louis Couchoud : « Il semble facile de faire un haïkaï, mais cette facilité est justement le danger. C’est le genre littéraire d’où la littérature est le plus complètement exclue[46]. » Or il est difficile de ne pas céder à la tentation de faire de la « littérature » pour compenser la brièveté du haïku, comme l’observe pareillement Roland Barthes dans son chapitre « L’effraction du sens » où il s’en prend aux interprètes occidentaux du haïku qui ne peuvent s’empêcher, atavisme littéraire oblige, de doter le haïku d’une profondeur ou d’un symbolisme qu’il n’a pas selon lui.
Lorsqu’il commente certains haïkus en faisant référence (non sans raison d’ailleurs !) à « la symbolique des plantes » au Japon ou à la « philosophie bouddhiste », Paul-Louis Couchoud commet assurément cette « effraction du sens » que dénonce Barthes. Il pressent cependant que le haïku peut ne rien vouloir dire d’autre que l’émotion suscitée par le simple surgissement des choses. Ainsi, après avoir commenté plusieurs haïkus en développant leur symbolisme, il en cite deux autres qui lui font remarquer : « Sans aucun symbole, l’apparition inattendue de quelques branches de fleurs nous émeut dans ces deux haïkaï […][47]. » Et par ailleurs, il conteste lui aussi que le haïku soit « spirituel » (« Le haïkaï ne fait pas, proprement, de l’esprit parce qu’il ne fait pas de réflexion sur les choses. Il les voit[48]. ») ou qu’il soit « satirique » comme l’est en Occident l’épigramme à laquelle après Chamberlain il l’a pourtant comparé (« Il n’est pas une caricature car la caricature suppose une idée interposée entre l’œil et l’objet aperçu[49]. »). Bien loin de faire intervenir la pensée, le haïku selon lui « ne dépasse pas la vision pure et simple[50] », un terme qu’emploiera aussi Roland Barthes en faisant du haïku une « vision sans commentaire », même s’il estimera que « le mot est encore trop occidental[51] ». Et certains faiseurs de « haïkaïs français » useront du langage le plus plat qui soit pour simplement dire, voire figurer graphiquement, les choses telles qu’elles sont, comme Pierre-Albert Birot dans cet exemple de « haïkaï » auquel il serait difficile de prêter la moindre signification symbolique :
Au-dessus il y a le ciel et plus bas le plafond
Et sur la table une boîte de petits pois
Avec le mode d’emploi[52].
Cette vision du haïku comme écriture purement dénotative et excluant le commentaire ne correspond guère à ce qu’est le haïku japonais, tel du moins que l’a défini Bashô et tel que l’ont pratiqué beaucoup de ceux qui se sont réclamés de lui jusqu’à aujourd’hui, avec ses « mots-saison » (kigo) qui relient le haïku à un moment particulier du calendrier, mais aussi renvoient à toutes sortes d’idées, de suggestions, et fonctionnent comme des intertextes aux multiples couches de sens ; avec ses références ou allusions à la poésie classique, aussi bien chinoise que japonaise, avec laquelle il joue pour créer des effets de surprise ; ou encore avec ses principes philosophiques comme le fueki (« l’invariant ») et le ryûkô (« le changeant ») dont le contraste fonde sa construction bipartite comme sa vision du monde. Elle provient des traductions qui en ont été faites car, d’une part les traducteurs ont privilégié les haïkus en apparence les plus simples, ceux qui semblaient ne nécessiter aucune note explicative, aucune connaissance des codes culturels japonais (ainsi Couchoud a-t-il cité Buson, qu’il présente surtout comme un « peintre » et dont les haïkus sont selon lui « moins profonds que ceux de Bashô, moins exquis, moins philosophiques, plus purement pittoresques », bien plus que Bashô dont il reconnaissait lui-même que « ses haïkaï, difficiles même pour les Japonais, ne sont souvent intelligibles qu’à un esprit nourri des doctrines bouddhistes, des lettres chinoises et de l’histoire du Japon[53] »), d’autre part, ils ont traduit les haïkus en utilisant un langage simplifié (« L’abstrait en est éliminé. La syntaxe est elliptique à l’excès[54] », dit Couchoud), avec le plus souvent des phrases nominales, des substantifs sans déterminants, des énoncés sans connecteur logique, comme on peut le voir dans cet exemple d’un haïku de Buson cité par Couchoud :
Feu sous la cendre.
Maison sous la neige.
Minuit[55].
Ainsi, par son indifférence à la prosodie, sa vision du haïku comme forme brève, quasiment homologue à l’« incident » qu’il transcrit, usant d’un langage dénotatif dépourvu de toute rhétorique et même de tout sens autre que littéral, Roland Barthes s’inscrit dans le sillage des premiers traducteurs et adaptateurs français du haïku qu’il a sans doute connus, même s’il a assurément radicalisé leurs interprétations. Si ce rapport n’a guère été perçu, et si Barthes a semblé développer une vision du haïku tout à fait nouvelle et originale par rapport à celle de ses prédécesseurs, c’est qu’il a explicitement établi un lien entre zen et haïku en suivant des sources anglophones d’après-guerre. Comme Blyth en effet pour qui « haiku is zen », Barthes déclare que « le haïkaï n’est que la branche littéraire[56] » du zen, et c’est en usant de tout un vocabulaire ou de références appartenant au bouddhisme zen (mu, satori, koan, vide, bouddhéité, méditation assise ou Sixième Patriarche) qu’il tente de rendre compte de la spécificité du haïku. Mais ce vocabulaire et ces références suffisent-ils à faire de Barthes un interprète « zenniste » du haïku, tels ceux qui écriront sur le haïku après lui en se réclamant de L’Empire des signes ?
Zen et haïku
Remarquons tout d’abord que le lien entre zen et haïku n’est pas tout à fait absent de la première phase de réception du haïku. En effet, Paul-Louis Couchoud, suivant en cela Chamberlain, fait déjà référence au zen dans sa présentation de la vie et l’œuvre de Bashô. Selon lui, Bashô, après avoir étudié « la doctrine de la secte Zen, sorte de jansénisme bouddhique », partit sur les routes, et finalement, il devint « un mystique accompli » et « réalisa la doctrine Zen, la doctrine de l’extase, qui par l’intermédiaire de l’art mène aux sommets de la contemplation pure[57] ». Tout ce que dit Couchoud de « la doctrine Zen » et de la vie d’itinérance que suivit Bashô pour se conformer à celle-ci nous montre qu’il conçoit le zen d’une part comme une philosophie de vie, faite de la conscience du caractère éphémère de toutes choses, et d’autre part comme une forme de mysticisme où l’âme se fond dans la nature. Cette vision du zen se retrouvera dans les écrits des vulgarisateurs ultérieurs du zen en Occident que Couchoud n’a pu connaître, y compris pour ce qui est de ses rapprochements avec un certain christianisme[58]. Mais ce n’est pas elle qu’a retenue Barthes, lequel au contraire a vu dans le zen « un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre[59] » dans la mesure où il offre une vision du monde et donc aussi une conception du langage dépourvue de toute métaphysique.
Les présentateurs du zen l’ont tous dit, le zen conçoit le monde comme un monde sans dieu et vise à amener l’homme à « réaliser » (au sens de prendre conscience mais aussi de rendre réel), par des exercices pratiques et non par l’intellect, la réalité fondamentale de l’être et des choses, qui est le Vide (Mu). De l’idée d’un monde sans transcendance (« le Zen est sans Dieu[60] », rappelle-t-il), Barthes a déduit que le langage est pour les Japonais sans garant ultime et est donc libéré de la chaîne des signifiés qui dans le système linguistique occidental renvoie toujours le signifiant vers un signifié dernier[61]. Selon lui, le haïku, « articulé sur une métaphysique sans sujet et sans dieu, correspond au Mu bouddhiste, au satori Zen, qui n’est nullement descente illuminative de Dieu, mais « réveil devant le fait »[62] », et nous permet donc, à nous Occidentaux qui sommes toujours tentés par la production infinie de significations, de faire l’expérience de « l’exemption du sens », de la « suspension du sens ». Barthes établit ainsi un parallèle entre la réalité des choses, que le haïku, en tant que pratique zen, fait découvrir, et qui est vide, et les mots constitutifs du haïku qui seraient « vides de sens. » Mais cette idée d’un langage « ne voulant rien dire » ne se rencontre pas chez ses informateurs. Ceux-ci font effectivement du haïku la transcription de l’expérience des choses telles qu’elles sont. Ainsi pour Watts : « le haïku traduit les choses dans leur « naturalité », sans les commenter, vision du monde que les Japonais appellent sono-mama, « Tel que cela est » ou « précisément ainsi »[63] », un passage dont Barthes s’est à l’évidence directement inspiré pour son chapitre « Tel ». Mais s’ils reconnaissent que pour les poètes zen le langage, même réduit à sa plus simple expression, est encore de trop dans la mesure où il s’interpose entre le sujet et le monde, ils ne disent pas que le haïku est un langage « vide de sens » : au contraire ils le présentent comme un langage éminemment culturel. Ainsi, Blyth met en garde dès le début de son premier volume Haiku : « Nous pouvons dire que pour comprendre, pour lire convenablement un seul haïku, il faut des années d’absorption inconsciente de toute la culture de l’Inde, de la Chine et du Japon qui trouve son accomplissement dans ces petits vers[64] ». Et c’est pourquoi il ne se prive pas de commenter, à l’attention de ses lecteurs non-japonais, les haïkus qu’il cite en explicitant leurs significations, leurs allusions ou leurs connotations que les lecteurs japonais, selon lui, saisissent intuitivement, sans avoir besoin de commentaires.
Barthes avait certainement conscience de cet écart entre sa vision du haïku et celle de ses informateurs, car, dans les pages du chapitre « L’effraction du sens », il s’en prend implicitement à ceux-ci autant qu’aux commentateurs français du haïku de la première moitié du xxe siècle. Ainsi, lorsqu’il ironise sur ceux qui parlent de « silence » à propos du haïku, « (le silence étant pour nous signe d’un plein de langage ) », il a certainement en ligne de mire Blyth qui fait du haïku « a silent langage » et qui, pour le montrer, commente un haïku de Shiki dont « le sens véritable » (« the really significant point of the verse[65] ») n’est pas celui qu’on lui donne spontanément ; et lorsqu’il se moque de ceux qui veulent « à tout prix voir dans le tercet du haïku un dessin syllogistique, en trois temps[66] », il se réfère manifestement encore à Blyth qui, après avoir invité le lecteur à comparer le haïku de Bashô « The old pond ; / A frog jumps in, — / The sound of the water. » à l’énoncé « All men are mortal ; / A negro is a man, / Therefore a negro is mortal. », conclut : « The haiku has no logical connections of premise and conclusion, but there is some subtle similarity between it and the syllogism[67] ».
Cette différence entre les commentateurs du zen et Barthes tient au fait que pour ceux-là le haïku n’est pas une simple forme, il est aussi un exercice ou une « voie » (comme le tir à l’arc par exemple) qui fait prendre conscience de l’unité du moi et du monde. En outre, si le haïku est pour Blyth une expérience en tant qu’il est « l’appréhension d’une chose par la réalisation de notre unité originelle et essentielle avec elle » (« the apprehension of a thing by a realization of our own original and essential unity with it[68] »), cette expérience est pour lui aussi bien celle du lecteur que celle de l’auteur, car le haïku exige du lecteur « la création d’une expérience poétique analogue à celle que désigne le haïku » (« the creation of a similar poetic experience to which the haiku points[69] »). Et Watts souligne de même que « l’auditeur non japonais doit savoir qu’un bon haïku est un caillou lancé dans l’étang de l’esprit de celui qui écoute, faisant remonter des associations mentales des profondeurs de la mémoire[70] ». Barthes se réfère aussi à la réception du haïku lorsqu’il observe que le haïku « se dit deux fois, en écho », mais cet écho n’est pas pour lui résonance avec l’esprit du lecteur, il ne fait que souligner « la nullité du sens[71] ». Et si les derniers mots de L’Empire des signes relatifs au haïku évoquent encore la lecture du haïku en renvoyant à la métaphore du « caillou lancé » de Watts, c’est pour contester que le haïku ait le moindre effet sur le lecteur et le refermer définitivement sur lui-même : « comme une boucle gracieuse, le haïku s’enroule sur lui-même, le sillage du signe qui semble avoir été tracé, s’efface : rien n’a été acquis, la pierre du mot a été jetée pour rien : ni vagues, ni coulée du sens[72] ».
En revanche, la conception du haïku comme exercice spirituel, ou de manière plus réductrice comme philosophie de vie (voire méthode de développement personnel !), est celle que l’on trouve chez les interprètes occidentaux du haïku de la seconde période qui s’inspirent comme Barthes des essais de Suzuki, Blyth ou Watts. Ainsi, Roger Munier publie en 1978, dans la collection « Documents spirituels » chez Fayard, un recueil de Haiku, traduits de Blyth, qu’il fait précéder d’un Avant-propos où on lit ces déclarations que Barthes n’aurait pu cautionner : « Le haïku est par essence plus qu’un poème […]. Sa pratique, écriture et lecture, est en elle-même un exercice spirituel.[73] » Et le long commentaire que Munier propose d’un haïku de Ryôta vise à faire comprendre que si le haïku dit bien ce qu’il dit, il dit « autre chose encore », car il fait signe vers un au-delà des mots, un « dehors », dont on peut prendre conscience « dans le dépassement un bref instant de notre essence limitée » qui est cela qu’on appelle « satori, l’illumination »[74]. Plus tard, Henri Brunel dans son petit livre Les Haïkus, sous-titré « La poésie du zen en trois vers », tout en plaçant en tête de son Introduction une citation de Barthes (« Le haïku : l’art du bref »), dit du haïku que c’est « un poème singulier, presque un exercice spirituel », ou encore « un art de vivre », « une voie de sagesse »[75]. Et Franck Medioni, en introduction à son anthologie Le Goût des haïku, dans le même paragraphe où il cite abondamment Barthes pour montrer que le haïku « est vraiment le versant poétique de l’expérience zen », déclare aussi que « sa puissance est dans le non-dit » et qu’il « laisse libre cours à la pluralité des sens[76] », des propos que Barthes aurait naturellement contestés. Bien qu’ils se réclament pour nombre d’entre eux de Barthes, et bien que comme lui ils lient toujours le haïku et le zen, on ne peut donc dire que les interprètes français du haïku qui viennent après lui suivent son interprétation du haïku comme « exemption du sens ».
Au terme de cette étude, il nous faut reconnaître que la place qu’occupe L’Empire des signes dans l’histoire de la réception française du haïku est des plus singulière et paradoxale. Par les liens qu’il a établis entre zen et haïku, Barthes appartient pleinement à la seconde phase de réception et joue le rôle de précurseur pour nombre de commentateurs ultérieurs qui continuent d’interpréter le haïku à la lumière du zen. Toutefois, cette filiation se fonde sur un malentendu, car, malgré ses références au zen, Barthes n’a en rien fait du haïku un exercice spirituel ou un art de vivre comme l’ont fait ces derniers. Par ailleurs, son vocabulaire et ses références zen ont occulté les liens qu’il a entretenus avec ses devanciers de la première moitié du xxe siècle qui lui ont fourni nombre de traductions et d’analyses fondées sur celles-ci.
Mais ce qui constitue vraiment l’originalité de sa vision du haïku, l’idée de « l‘exemption du sens », ne se retrouve ni chez ses devanciers ni chez ses épigones, car outre qu’elle n’est guère défendable au regard de la pratique réelle du haïku, elle ne peut se comprendre, comme l’a montré Annie Cecchi, que rapportée à son désir de sémioticien d’échapper à « la maladie langagière occidentale[77] ». Finalement le haïku, comme pour ses premiers interprètes du début du xxe siècle, n’a jamais été pour lui qu’une « aventure[78] » permettant d’explorer de nouveaux modes d’écriture, comme le montreront mieux encore, mais différemment, les développements qu’il lui consacrera quelques années plus tard dans ses cours du Collège de France où il en fera une « préparation du roman ».
notes
-
Voir notamment Étiemble, Du Haïku, Paris, éditions Kwok’On, 1995, passim ; Eric Dussert, « Brève histoire des haïjin de France », in Au fil de l’eau. Les premiers haïku français, Paris, éditions Mille et une nuits, 2004, p. 5-16 ; Bertrand Agostini, « The Development of French Haiku in the First Half of the 20th Century: Historical Perspectives », Modern Haiku, vol. 32.2, Summer 2001, en ligne : http://www.modernhaiku.org/essays/frenchhaiku.html. Dans sa « Présentation » de l’ouvrage collectif Le Haïku en France. Poésie et musique (sous la direction de Jérôme Thélot et Lionel Verdier, Paris, éditions Kimé, 2011), Lionel Verdier distingue « trois principales étapes » : une première « à la fin du xixe siècle », une seconde « entre les deux guerres », et une troisième « dans les années 1960-1970 » (p. 9), mais on voit mal en quoi la première phase de découverte, qui ne débute pas à la fin du xixe siècle mais au début du xxe siècle, se distinguerait de la période de l’entre-deux guerres où se manifeste un « grand engouement pour l’idée du haïku tel qu’on l’imaginait alors », car l’engouement des poètes de cette période pour le haïku est inséparable des textes et traductions qui le révèlent peu à peu dans le même temps. ↑
-
Voir par exemple, parmi les ouvrages les plus récents, Le Goût des haïku (textes choisis et présents par Frank Médioni, Paris, Mercure de France, 2012), dont l’une des deux épigraphes initiales est une citation de Barthes, l’autre étant une citation de Bashô, et où le haïku est expliqué à grand renfort d’extraits de L’Empire des signes (p. 19) ; ou Henri Brunel, Les Haïkus. La poésie du zen en trois vers (Paris, Librio, 2006) qui place aussi en épigraphe une citation de Barthes ; ou encore L’Art du haïku. Pour une philosophie de l’instant (Paris, Belfond, 2009) où Pascale Senk, dans sa « Préface », cite plusieurs fois L’Empire des signes. ↑
-
Julien Vocance, « Cent visons de guerre », La Grande Revue, n°5, mai 1916. Sur Julien Vocance, voir Chantal Viart, Julien Vocance, maître haïjin français, préface de Serge Brindeau, Saint-Chéron, éditions Unicité, 2018. ↑
-
Au fil de l’eau, s.l., s. d. (1905) ; rééditions : Au fil de l’eau, les premiers haïku français, édition établie par Eric Dussert, Paris, éd. Mille et une nuits, 2004 (mais la plaquette y est datée par erreur de 1903, et l’édition comporte plusieurs autres erreurs), et Au fil de l’eau avec Paul-Louis Couchoud, version illustrée et commentée par Dominique Chipot, Editions DC/lulu.com, 2013. ↑
-
La Nouvelle Revue Française, n° 84, septembre 1920, p. 329-345. ↑
-
Sur René Maublanc, voir Dominique Chipot, René Maublanc. Le haïku des années folles, Saint-Chéron, éditions Unicité, 2016. ↑
-
Claudel, Cent Phrases pour éventails, Paris, Gallimard, 1942, s.p. ↑
-
Étiemble, op. cit., p. 88. ↑
-
Les Nouvelles littéraires, 2 avril 1938, p. 7. ↑
-
Étiemble, op. cit., respectivement p. 7 et p. 8. ↑
-
Voir à ce sujet Emmanuel Lozerand, « Les contrebandiers du zen. Sur le rôle des passeurs dans un processus de cosmopolitisation », in G. Bridet, X. Garnier, S. Moussa et L. Zecchini (dir.), Littérature et cosmopolitisme, « Écritures », Éditions universitaires de Dijon, 2019. ↑
-
Voir l’article d’Evelyne Lesigne-Audoly, « Meaning is sensation – La voie du haïku selon R. H. Blyth », dans la présente livraison de la revue Roland Barthes. ↑
-
Voir notamment Daisetz Teitaro Suzuki, Essais sur le Bouddhisme Zen., Troisième série (1943), trad. sous la dir. de Jean Herbert, Paris, Albin Michel, 1972, p. 354-358. ↑
-
R. H. Blyth, Haiku. Vol. I Eastern Culture (1949), Tokyo, The Hokuseido Press, San Francisco, Heian International, 1981, respectivement p. 5 et p. 6. ↑
-
Voir Alan W. Watts, Le Bouddhisme zen (1960), trad. par P. Berlot, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1991, p. 202-209. ↑
-
En 1966 Nobuyuki Yuasa publie une traduction de l’ensemble des cinq journaux de voyage de Bashô dans The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches, et en 1968 Cid Norman et Kamaike Susumu retraduisent ensemble son journal de voyage vers le nord (Oku no hosomichi) sous le titre Back Roads to Far Town: Bashô’s Okuno-hosomichi. ↑
-
Signalons cependant que le plus important des journaux de voyage de Bashô, Oku no hosomichi, avait déjà été publié dans une traduction de René Sieffert en 1968 dans la revue L’Éphémère (n°6, Éditions de la Fondation Maeght) sous le titre La Sente étroite du Bout-du-Monde, et qu’en 1976 il sera de nouveau traduit en français (mais cette fois à partir de la traduction anglaise de Dorothy Britton, A Haiku Journey : Bashô’s The Narrow Road to teh Far-North and Selected Haiku, 1974), sous le titre Le Chemin étroit vers les contrées du Nord, par l’écrivain-voyageur suisse Nicolas Bouvier (dont plusieurs photographies du Japon se retrouvent dans L’Empire des signes). ↑
-
Voir Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Seuil, p. 429-430. ↑
-
Voir l’article d’Emmanuel Lozerand, « D’où viennent les haïkus de L’Empire des signes ? » dans la présente livraison de la revue Roland Barthes. ↑
-
Il s’agit du premier haïku cité dans le chapitre « Tel », qui est emprunté au recueil de Kikou Yamata Sur des lèvres japonaises et qui se présente, comme tous les haïkus de ce recueil, sous forme d’un distique. ↑
-
Nobuyuki Yuasa, « Introduction », in Matsuo Bashô, The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches (1966), transl. By Nobuyuki Yuasa, London, Penguin Books, s. d., p. 48. ↑
-
Voir par exemple The Dharma Bums (1958), in Road Novels 1957-1960, New York, The Library of America, 1984, p. 322-323. ↑
-
Les mesures en question ne correspondent pas seulement à des syllabes, car une voyelle longue compte pour deux mesures et le –n qui termine certaines syllabes compte aussi pour une mesure. ↑
-
Roland Barthes, L’Empire des signes, Paris, éditions du Seuil, Points/Essais, 2007, p. 97. ↑
-
Voir Fragments d’un discours amoureux, Paris éditions du Seuil, 1977, p. 113-114. ↑
-
Georges Bonneau, qui était lui-même poète, est une exception, mais ses traductions, publiées chez l’éditeur orientaliste Paul Geuthner, ont eu une audience très limitée et Barthes ne semble pas les avoir connues. ↑
-
Paul-Louis Couchoud, Sages et poètes d’Asie, Paris, Calmann-Lévy, 1916, p. 53. ↑
-
Ibid., p. 132. ↑
-
Cent Haïkaï (1924), fac-similé in : Dominique Chipot, René Maublanc, op. cit., p. 61. Concernant les débats de l’époque sur le forme du haïku, voir aussi, dans ce même ouvrage, l’article de Dominique Chipot « « La chose en soi » : le haïku des années folles », notamment p. 159-164. ↑
-
Ce ne sera plus le cas dans les pages consacrées au haïku des cours du Collège de France de 1978-1980 intitulés La Préparation du roman (Paris, Seuil/IMEC, 2003) dont nous préférons ne pas parler, car, outre qu’elles ont été publiées tardivement et n’ont donc pas joué de rôle dans l’histoire de la réception du haïku qui nous occupe ici, elles offrent une vision du haïku qui n’est plus exactement celle de L’Empire des signes et qui repose en partie sur des sources postérieures à celui-ci. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 105. ↑
-
Ibid., p. 102. ↑
-
Ibid., p. 105. ↑
-
Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Paris, Le Divan, 1924, p. 96. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 104. ↑
-
La Nouvelle Revue Française, n° cité, p. 330. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 100. ↑
-
Ibid., p. 101. ↑
-
Barthes emploie plusieurs fois le mot « trait » comme un quasi synonyme de haïku (« haïku (le trait) », op. cit., p. 115), soulignant que « ce mot convient au haïku, sorte de balafre légère tracée dans le temps » (op. cit., p. 113) et que, dans cette « écriture alla prima » qu’est le haïku, « le trait […] n’exprime pas, mais simplement fait exister » (op. cit., p. 110). ↑
-
Ibid., p. 95. ↑
-
Paul-Louis Couchoud, op. cit., Préface, p. 8. ↑
-
La Nouvelle Revue Française, n° cité, p. 329. ↑
-
Cité in René Maublanc, « Un mouvement japonisant de la littérature contemporaine : Le Haï-Kaï français », La Grande Revue, février 1923, p. 614. ↑
-
Paul-Louis Couchoud, op. cit., p. 54. ↑
-
Ibid., p. 55. ↑
-
Ibid., p. 131 (c’est lui qui souligne). ↑
-
Ibid., p. 72 (c’est nous qui soulignons). ↑
-
Ibid., p. 80. ↑
-
Ibid., p. 107. ↑
-
Id. (c’est nous qui soulignons le mot « vision »). ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 113. ↑
-
La Nouvelle Revue Française, n° cité, p. 336. ↑
-
Paul-Louis Couchoud, op. cit., respectivement p. 126-127 et p. 123. ↑
-
Roland Barthes, op. cit.., p. 54. ↑
-
Paul-Louis Couchoud, op. cit., p. 89. ↑
-
Roland Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 101. Curieusement, Barthes emploie ici le terme « haïkaï » (et c’est l’unique occurrence dans tout l’ouvrage) qui était d’usage courant dans les sources françaises de la première moitié du xxe siècle alors que les sources anglaises d’après-guerre ne parlent plus que de « haïku ». ↑
-
Paul-Louis Couchoud, op. cit., respectivement p. 117 et p. 119. ↑
-
Suzuki a en effet développé une vision du zen marquée par le syncrétisme, et Blyth, dans son premier ouvrage Zen in English Literature au titre parlant à cet égard, mais aussi dans sa série de volumes Haiku, n’a cessé de faire des rapprochements entre bouddhisme et christianisme, poètes chinois ou japonais et poètes occidentaux. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 11. ↑
-
Ibid., p. 100-101. ↑
-
N’y a-t-il pas cependant une contradiction à observer d’une part que l’absence de métaphysique au Japon fait échapper le langage japonais à la quête du sens ultime qui est le propre du fonctionnement du langage occidental, et d’autre part que le zen « est une immense pratique destinée à arrêter le langage », ou le satori « une suspension panique du langage, le blanc qui efface en nous le règne des Codes » (Roland Barthes, op. cit., p. 101) ? ↑
-
Ibid., p. 105. ↑
-
Alan Watts, op. cit., p. 204. ↑
-
Blyth, op. cit., p. 7 (« We may say that to understand, to read properly a single haiku requires years of unconscious absorption of all the culture of India, China and Japan that comes to fulfilment in these small verses. ») ↑
-
Blyth, op. cit., p. 243. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 97. ↑
-
Blyth, op. cit., p. 329. Ce haïku fameux de Bashô a fait l’objet par ailleurs de huit pages de commentaires dans le premier ouvrage de Blyth, Zen in English Literature (p. 217-224) ! Il est vrai toutefois que dans le volume II de sa série Haiku (Tokyo, The Hokuseido Press, 1950, p. 253-254), où il cite de nouveau ce haïku, Blyth s’est montré beaucoup plus succinct dans son commentaire, précisant en note qu’il « a changé d’avis à son sujet » (« I have changed my mind about it »), mais il n’est pas sûr que, en voyant dans « le bruit de l’eau » (« the sound of the water ») évoqué par Bashô un son qui est « au-dela du son et du silence » (« sound that is beyond sound and silence »), il n’ait pas encore été visé par Barthes…. ↑
-
Ibid., p. 8. ↑
-
Ibid., p. 11. ↑
-
Alan Watts, op. cit.,, p. 202-203. ↑
-
Roland Barthes, op. cit., p. 103. ↑
-
Ibid., p. 116 (c’est nous qui soulignons). Notons là encore qu’il n’en ira pas de même dans La Préparation du roman où Barthes évoquera le haïku en tant que déclencheur d’émotions, de souvenirs, et donc aussi possible germe pour une écriture romanesque. ↑
-
Roger Munier, Haïku, Paris, Fayard, 1978, Avant-propos, p. IV. ↑
-
Voir ibid., p. V-VI. ↑
-
Henri Brunel, op. cit., respectivement p. 9, p. 12 et p. 41. ↑
-
Le Goût des haïkus, op. cit., p. 18-19. ↑
-
Annie Cecchi, « Roland Barthes et le mirage du haïku », in Proceedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association, New York, Garland Publishing, 1985, vol. 2, p. 599. ↑
-
C’est le terme qu’emploie Jean Paulhan dans sa présentation des « Haï-kaï » de La Nouvelle Revue Française (« Ils ne savent pas quelles aventures, ils supposent la plupart que des aventures attendent le haï-kaï français […] », n° cité, p. 330) et on le trouve aussi chez Barthes qui le définit ainsi : « (ce qui advient au langage plus encore qu’au sujet) » (op. cit., p. 105). ↑