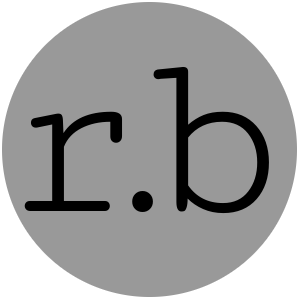Je puis aussi, sans prétendre en rien représenter ou analyser la moindre réalité (ce sont des gestes majeurs du discours occidental), prélever quelque part dans le monde (là-bas) un certain nombre de traits (mot graphique et linguistique), et de ces traits former délibérément un système. C’est ce système que j’appellerai : le Japon[1].
L’explication donnée par Roland Barthes à la démarche qu’il entend suivre dans L’Empire des signes présente deux versants : s’il réfute toute prétention à parler de la « réalité » japonaise, et s’il revendique donc le caractère fictif de son ouvrage, l’auteur affirme également que celui-ci se constitue bel et bien dans un certain rapport au « monde », et donc au réel nippon.
Il arrive d’ailleurs aux commentateurs d’insister tour à tour sur les deux aspects de l’ouvrage, de rappeler son caractère imaginaire, certes, mais pour mieux admirer sa pertinence descriptive. Comme si l’un expliquait l’autre : c’est parce que Barthes ne voudrait pas connaître le Japon, ne prétendrait pas le décrire, qu’il parviendrait à l’approcher au mieux. Maurice Pinguet par exemple, après avoir souligné le « parti pris d’utopie » de Barthes, situe aussitôt le livre « dans le champ du savoir japonologique » pour mieux mettre en valeur son « étonnante acuité d’observation, sous des angles que le compas des spécialistes ne peut pas ouvrir – mais dont se seraient délectés, à Edo, les maîtres du dessin ou de la notation, Bashô ou Hokusai[2] ».
Mais que signifie au juste « prélever des traits dans le monde », expression essentielle mais plus opaque qu’il n’y paraît ? Cher à l’administration fiscale, le terme « prélever » apparaît aussi fréquemment dans l’expertise médico-légale (« prendre une partie d’un tout à des fins d’essai ou d’analyse[3] »). Il semble souvent comporter en lui une part irréductible de violence, d’agressivité. Dans Pilote de guerre en 1942, Saint-Exupéry n’écrivait-il pas : « Mon corps, durant le jour, ne m’appartenait pas. Ne m’appartenait plus. On pouvait en prélever des membres, on pouvait en tirer du sang[4]. » Ce que l’on prélève en effet n’est-il pas exigible comme un dû, avant tout partage ? Quant à « trait », si Barthes en souligne une certaine polysémie, il omet de préciser que ce « mot graphique et linguistique » est aussi militaire : il peut désigner un projectile blessant. De manière générale, si l’on sait comment prélever une taxe ou un échantillon, on voit moins bien ce qu’implique de « prélever des traits » à la définition incertaine.
Essayer de mieux comprendre le rapport de Barthes au « monde » nippon, et aux « traits » qu’il y « prélève », amène à s’interroger sur deux problèmes bien différents : celui des « sources » de l’auteur ; celui de l’écriture même de L’Empire des signes. Ce second point est essentiel. Selon les fragments en effet, Barthes ne met pas du tout en scène de la même manière son rapport au réel. Il y a en effet un abîme entre le « je » qui décrit le cuisinier au travail, « devant nous » (« L’interstice[5] »), et celui qui donne un cours ex cathedra sur « le Zen » (« L’exemption du sens[6] »), ou entre celui erre dans les rues et les trains (« Sans adresses[7] », « La gare[8] »), et celui qui décrit les propriétés syntaxiques de la langue japonaise (« La langue inconnue[9] »), les manifestations étudiantes (« L’écriture de la violence[10] »), ou la photographie de la femme du général Nogi la veille de sa mort (« Le visage écrit[11] »). On n’a sans doute pas encore assez souligné à quel point l’écriture de L’Empire des signes est hétérogène et changeante[12].
Mais c’est sur la question des sources de Barthes que nous voudrions ici nous arrêter. C’est là un problème beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Si l’on en croit Maurice Pinguet, « la stratégie de Barthes » aurait été d’une grande simplicité : « Il se garda bien de rassembler les connaissances de seconde main qui épaississent tant de livres de voyageurs, il voulut conserver devant les choses mêmes la naïveté d’un premier regard ». L’Empire des signes serait donc un livre sans intertexte, écrit à partir de « l’expérience », un « livre d’images » tout entier composé de « notations frêles, factuelles, où se devine encore la jubilation des premiers moments[13] ». Or, s’il semble indéniable que certains fragments ont effectivement été composés à partir de rencontres avec des éléments vécus du réel nippon[14], d’autres, en revanche, et fort nombreux, ont une origine livresque.
Barthes ne fut pas au Japon ce voyageur ignorant de tout savoir que fantasme Maurice Pinguet de manière un peu trop irénique, mais bel et bien un lecteur informé. Le contraire serait d’ailleurs étonnant. Si L’Empire des signes ne comporte aucune note[15], on peut y repérer la présence souterraine de beaucoup d’intermédiaires : Jean-Louis Barrault, Paul Claudel, Charles Haguenauer, Alan Watts ou D. T. Suzuki par exemple, dont les discours travaillent en profondeur le texte barthésien. Et parmi les traits du monde réel nippon retenus par Roland Barthes, il en est dont la nature même implique un mode de prélèvement particulier : les haïkus[16], dont les citations jouent un rôle central dans l’économie générale du livre.
Si Barthes en effet n’a pas inventé les haïkus de son ouvrage[17], deux questions viennent immédiatement à l’esprit : par quels canaux ceux-ci sont-ils arrivés jusqu’à lui, dans quel ouvrage « de seconde main » les a-t-il trouvés, ? et, si ces haïkus existent en japonais, quel rapport existe-t-il éventuellement entre ces originaux et les traductions qu’en cite Barthes ? ou, pour le dire autrement, en quoi la vision barthésienne du haïku a-t-elle été façonnée par ce que lui proposaient les traducteurs chez qui il a « prélevé » les poèmes cités ?
Répondre à ces questions nous renseignerait plus avant sur le processus d’écriture de L’Empire des signes, qui n’est pas totalement élucidé[18] ; cela pourrait aussi aider à mieux situer Roland Barthes dans l’histoire du japonisme, des discours sur le Japon, et plus particulièrement dans celle de la réception du haïku en Occident[19]. Cela permettrait surtout de mieux comprendre le lien, et les écarts, entre les deux « Japon » de Roland Barthes : le « Japon » où il a voyagé entre 1966 et 1968, sur lequel il s’est documenté et où il « prélève des traits », et le « Japon » fictif, dont son ouvrage « forme délibérément système ».
Où trouver l’origine des haïkus de L’Empire des signes ?
Les haïkus cités dans L’Empire des signes semblent venir de nulle part. Barthes les cite sans la moindre note ou référence[20], dans une espèce d’évidence. Pour essayer de remonter à leurs sources occultées, trois voies s’offraient à nous : les archives, les textes ultérieurs de Barthes lui-même, les commentaires des traducteurs japonais.
Dans la boîte d’archives consacrée à L’Empire des signes à la Bibliothèque nationale de France, il semble n’y avoir que très peu de choses, et en tout cas rien de spécifique sur le haïku[21].
On trouve en revanche des indices précieux dans le cours prononcé au Collège de France en 1978-1979 et 1979-1980, intitulé La Préparation du roman[22]. Lors de la séance du 6 janvier 1979 en particulier, Barthes distribue un « fascicule[23] » intitulé « Haïkus » et il explique d’où proviennent les traductions qu’il a compilées :
Il y a d’abord une œuvre extraite d’un recueil que j’ai eu, que j’avais acheté mais que j’ai perdu comme tous les livres importants. J’ai voulu le retrouver, mais il n’est plus en vente nulle part. Je n’ai même pas pu retrouver la bibliographie. J’ai été à la Bibliothèque nationale, j’ai été dans une bibliothèque spécialisée, je n’ai pas pu resituer la référence bibliographique d’un livre que pourtant j’ai eu entre les mains, donc ce n’est pas un objet halluciné. Ce livre, si vous trouvez la référence, vous me la donnez bien sûr, que j’en fasse part à tout le monde, c’est un recueil de haïkus très complet en quatre volumes. Les haïkus sont traduits en anglais donc par un Anglais dont le nom est Blyth. Si vous trouvez la référence, vous voudrez bien me la donner. Si vous trouvez ce livre, vous l’achetez et je vous l’achèterai[24].
Or Barthes ouvre ainsi la séance suivante, le 13 janvier :
Au dernier cours, j’ai fait état d’un livre, d’un recueil de haïkus d’un Anglais dont j’ai dit n’avoir retrouvé ni le livre, que j’avais pourtant avant, ni la référence. Des personnes inconnues, je dis bien inconnues et non pas anonymes, ont eu la gentillesse de me procurer ce livre et aussi de me procurer la référence et cela une heure exactement après que j’en ai eu parlé ici, ce qui est un prodige pour un livre introuvable. […] Voici la référence de ce livre : c’est donc un Anglais qui s’appelle Blyth (je ne sais pas si je prononce bien), prénom : Reginald Horace et le titre est A History of Haïku. Ça a été publié au Japon aux Hokuseido Press, Tokyo, en 1963, et il y a quatre volumes[25].
La bibliographie distribuée par Barthes précise en outre : « BLYTH, Horace Reginald, A History of Haïku, Tokyo, Hokuseido Press, 1963, 4 volumes[26] ».
J’ignore l’origine de la confusion[27], mais il semble que Barthes – ou ses informateurs inconnus – aient confondu deux titres de Blyth : A History of haïku parue en deux volumes en 1963-1964[28], et l’anthologie Haïku, parue en quatre volumes de 1949 à 1952[29]. Au-delà de la question du nombre de volumes, Barthes explique plus précisément que, « dans le livre de Blyth », « les quatre volumes correspondent en gros aux quatre saisons, les haïkus sont groupés par saison[30] ». Or cette description est précisément celle de l’anthologie en quatre volumes de 1949-1952, Haïku, ainsi constituée : « Volume 1: Eastern Culture. Volume 2: Spring. Volume 3: Summer-Autumn. Volume 4: Autumn-Winter ».
Il faut préciser en outre que ces quatre volumes ont été beaucoup plus diffusés et connus à travers le monde que A History of haïku, plus tardif. Ce sont eux qui ont inspiré les beatniks, en particulier Gary Snyder et Jack Kerouac (on pense aux Dharma Bums de 1958, traduit en français sous le titre Les Clochards célestes en 1963 ), aussi bien que Philippe Jaccottet (qui les découvrit en 1960 via son ami ésotériste Jacques Masui[31]) ou Yves Bonnefoy[32]. Cette anthologie de haïkus de Blyth apparaît donc comme une des sources les plus probables de L’Empire des signes[33].
Barthes précise aussi dans son cours de 1979 que viennent alors de paraître des anthologies de Maurice Coyaud et Roger Munier[34], mais, par définition, il n’a pu les utiliser pour la rédaction de L’Empire des signes, sorti en 1970.
Il ajoute enfin qu’il a utilisé « quelque chose qui était dans la bibliothèque de [sa] maison[35] », en l’occurrence un ouvrage de Kikou Yamata [Yamata Kiku], Sur des lèvres japonaises, paru en 1924. On sait que Noémie Lepet-Révelin, la grand-mère maternelle de Barthes, remariée avec le professeur de philosophie Louis Révelin, tint place du Panthéon un salon que fréquentait par exemple Paul Valéry, auteur d’une « lettre-préface » à l’ouvrage de Kikou Yamata, dont il était proche[36]. On peut raisonnablement penser que ce « quelque chose qui était dans la bibliothèque de ma maison » y est entré dès sa parution, avant d’être transmis à Henriette Binger (la mère de Barthes), ou à Barthes lui-même, à la mort de Noémie en 1953. Cela pourrait aussi être cohérent avec cette remarque du cours du 13 janvier 1979 : « Il y a pour moi un enchantement du haïku depuis sans doute plus de vingt ans que périodiquement j’en lis[37] », qui fait commencer la découverte du haïku par Barthes dans les années 1950.
Toutefois Roland Barthes mentionne lui-même le 13 janvier 1979 d’autres origines plus mystérieuses, comme oubliées, occultées, à ses haïkus préférés : « Quelquefois ils ne sont pas dans Blyth mais je ne me rappelle pas – j’avais une autre liste avec des haïkus sans savoir où je l’avais pris[38] ». Il y a là une énigme à éclaircir.
Si les traducteurs japonais de Barthes – Sô Sakon en 1996 et Ishikawa Yoshiko en 2004[39] – ne nous aident pas à savoir d’où pourrait provenir cette autre liste[40], leur apport est en revanche inestimable puisqu’ils ont identifié avec précision les originaux des haïkus cités dans L’Empire des signes[41]. Nous y reviendrons un peu plus loin.
Partant des remarques de Barthes, qui mentionnait des anthologies françaises et anglo-saxonnes de poésie japonaise comme sources de son « fascicule » de 1979, nous sommes donc partis à la recherche des ouvrages qu’il aurait pu avoir en main lors de ses voyages au Japon et de la rédaction de L’Empire des signes, à la fin des années 1960[42].
Sources des haïkus cités par Barthes dans L’Empire des signes
D’après notre enquête, les seize haïkus cités par Roland Barthes dans L’Empire des signes proviennent de six sources différentes[43] : aux ouvrages déjà mentionnés de Kikou Yamata (1924) et Reginald Horace Blyth (1949-1952), il faut ajouter une anthologie compilée et traduite en 1936 par Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin, Haïkaï de Bashô et de ses disciples, le livre d’Alan Watts sur Le Bouddhisme zen de 1957, lu par Barthes dans la traduction de Pierre Berlot parue chez Payot en 1960, le manuel de René Sieffert, La Littérature japonaise, paru chez Armand Colin en 1961, ainsi que le catalogue d’une exposition sur la peinture japonaise présentée à Zürich en 1962.
1) Deux haïkus empruntés à Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Le Divan, 1924.
Je vis la première neige.
Ce matin-là, j’oubliai de laver mon visage[44].
Brise printanière :
Le batelier mange sa pipette[45].
Remarquons que dans L’Empire des signes le second de ces haïkus est cité sur deux lignes, conformément au choix de Yamata, alors que le premier est disposé par Barthes sur trois lignes (comme il le fera systématiquement dans le fascicule de La Préparation du roman[46]), et entre parenthèses, de manière exceptionnelle :
(Je vis la première neige.
Ce matin-là, j’oubliai
De laver mon visage[47].)
2) Six haïkus empruntés à Kuni Matsuo [Matsuo Kuninosuke] et Émile Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, illustré par Foujita, Institut international de coopération intellectuelle, 1936.
Concombre coupé.
Son jus coule
dessinant des pattes d’araignée[48].
Que de personnes
ont passé à travers la pluie d’automne
sur le pont de Seta[49] !
J’arrive par le sentier de la montagne.
Ah ! ceci est exquis !
une violette[50] !
Déjà quatre heures…
Je me suis levé neuf fois
pour admirer la lune[51].
Le vent d’hiver souffle.
Les yeux des chats
clignotent[52].
Un oignon blanc
qui vient d’être lavé
Impression de froid[53].
On peut supposer qu’il s’agit majoritairement de ces poèmes dont Barthes dit le 13 janvier 1979 : « quelquefois ils ne sont pas dans Blyth mais je ne me rappelle pas – j’avais une autre liste avec des haïkus sans savoir où je l’avais pris[54] ». En dehors de la presque parfaite coïncidence entre les citations de Barthes et les propositions de Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin, un autre élément vient confirmer l’origine de ces haïkus. Plusieurs fois en effet, dans L’Empire des signes, Barthes met en cause sans les nommer des « commentateurs » maladroits. Ainsi, quand il moque ceux qui voient dans
Que de personnes
Ont passé à travers la pluie d’automne
Sur le pont de Seta !
« l’image du temps qui fuit[55] », il cite en réalité Matsuo et Steinilber-Oberlin qui ont ainsi annoté leur traduction : « Le poète est sur le pont, admirant la nature. À travers chaque ondée de nuages passagers, des piétons passent rapidement, devançant même la pluie : image du temps qui fuit[56]. »
Quand il critique ceux pour qui, quand Bashô écrit :
J’arrive par le sentier de la montagne.
Ah ! ceci est exquis !
Une violette !
« c’est qu’il a rencontré un ermite bouddhiste, “fleur de vertu[57]” », c’est à nouveau à Matsuo et Steinilber-Oberlin qu’il se réfère sans le dire, puisque ceux-ci ont donné à ce verset la note : « Surprise délicieuse et parfumée. Ce haïkaï renferme-t-il un sens métaphorique ? Certains le prétendent : un jour, cheminant dans la montagne, Bashô aurait rencontré un ermite bouddhiste, fleur de vertu[58]. »
Et c’est encore ces deux traducteurs qu’il cite mot-à-mot sans les nommer quand il dénonce « le commentateur » qui à propos de
Déjà quatre heures…
Je me suis levé neuf fois
Pour admirer la lune
écrit « innocemment » : « La lune est si belle que le poète se lève et se relève sans cesse pour la contempler à sa fenêtre[59] ».
3) Cinq haïkus empruntés à Horace Reginald Blyth, Haïku, quatre volumes, The Hokuseido Press, 1949-1952, et traduits de l’anglais en français par Barthes.
A cloud of cherry blossoms : Un nuage de cerisiers en fleurs :
The bell, — is it Ueno ? La cloche. – Celle de Ueno ?
It is evening, autumn ; C’est le soir, l’automne,
I think only Je pense seulement
The old pond ; La vieille mare :
A frog jumps in, – Une grenouille saute dedans :
With a bull on board Avec un taureau à bord,
A small boat passes across the river Un petit bateau traverse la rivière,
Through the evening rain[66] À travers la pluie du soir[67].
In the fisherman’s house, Dans la maison du pêcheur,
The smell of dried fish, L’odeur du poisson séché
Cette série de haïkus empruntés à Blyth est très intéressante puisque qu’elle permet d’apprécier le travail de Barthes traducteur de l’anglais : il procède à un calque scrupuleux des propositions blythiennes, à la seule exception de l’ajout d’un « oh ! » dans le célèbre verset de la grenouille, ajout peut-être dû à l’interférence d’autres traductions d’un poème tant et tant traduit en anglais comme en français[70].
On notera par ailleurs que c’est vraisemblablement Blyth qui est visé dans la remarque faite à propos de ce verset de la grenouille : « on veut à tout prix voir dans le tercet du haïku (ses trois vers de cinq, sept et cinq syllabes) un dessin syllogistique, en trois temps (la montée, le suspens et la conclusion[71]) », puisque ce dernier écrit : « There is a kind of syllogostic nature about the form which gives it the utmost clarity while actually containing no logical elements, often no intellectual connections between the parts », ou encore : « The haiku has no logical connections of premise and conclusion, but there is some subtle similarity between it and the syllogism[72] ».
4) Un haïku emprunté à Alan Watts, Le Bouddhisme zen, traduction française de Pierre Berlot, 1960 (The Way of Zen, 1957).
Comme il est admirable
Celui qui ne pense pas : « La Vie est éphémère »
En voyant un éclair[73] !
Cette traduction française de l’ouvrage d’Alan Watts (best-seller international des années 1960) constitue une des principales sources de L’Empire des signes puisque Barthes lui emprunte la quasi totalité de ces nombreuses références au bouddhisme en général, et au zen en particulier[74]. Il figure d’ailleurs dans la bibliographie générale de La Préparation du roman.
À dire vrai, Watts se réfère lui aussi à Blyth[75], et le texte anglais qu’il donne de ce poème de Bashô est directement emprunté à sa célèbre anthologie :
How admirable
He who thinks not, « Life is fleeting, »
When he sees the lightning[76] !
La seule différence avec les haïkus précédents, c’est que la traduction n’est pas ici de Barthes, mais du traducteur, Pierre Berlot, qui adopte cependant le même principe de traduction ultra-littérale du texte de Blyth.
5) Un haïku emprunté à René Sieffert, La Littérature japonaise, collection « Langues et civilisations », Armand Colin, 1961.
Pleine lune
Et sur les nattes
L’ombre d’un pin[77].
Ce haïku est le seul traduit par René Sieffert dans son manuel de 1961. La traduction de Blyth n’est guère différente :
The bright moon ;
On the tatami
The shadow of the pine-tree[78]
Elle ne comporte pas toutefois de conjonction de coordination, et on peut donc penser que Barthes a bien emprunté ce haïku à René Sieffert, à l’époque professeur de littérature classique japonaise aux LanguesO’[79], dont le livre est en outre mentionné par Barthes dans la bibliographie de La Préparation du roman en 1979[80]. Bien que ponctuelle, cette référence à un éminent japonologue (qui partira ensuite en guerre contre le « zennisme » et la « mystification japonolâtre[81] ») est intéressante, parce qu’elle tend à prouver que Barthes a bien lu des écrits savants à l’occasion de son voyage dans l’archipel ou de l’écriture de L’Empire des signes. Il emploie ainsi le vocabulaire métalinguistique très spécialisé (« suffixes fonctionnels », « particules enclitiques[82] ») mis au point par Charles Haguenauer pour décrire la langue japonaise[83] et longtemps utilisé dans l’enseignement du japonais en France[84].
6) Un haïku emprunté au catalogue Japanische Tuschmalerei Nanga und Haiga, aus der Zammlung Heinz Basch, Kunstgewerbemuseum Zürich, 8 juillet 12 août 1962.
[Beim Pilzesammeln
Wirkt habsüchtig selbst der Blick,
Der Nach unten geht][85]
Il se fait cupide
aussi, le regard baissé
sur les champignons[86].
Ce dernier haïku a un statut différent des précédents. Il ne figure pas dans le corps du texte de L’Empire des signes, mais dans la table des illustrations. Il s’agit en effet de la traduction d’un verset calligraphié en japonais sur une image choisie par Barthes[87]. On peut imaginer que la traduction française, très libre, de la traduction allemande a été proposée par des employés de Skira, ce catalogue ayant peut-être été apporté à Barthes au Maroc par un envoyé de l’éditeur pendant l’hiver 1969, au moment où Barthes choisit l’iconographie de l’ouvrage, dont il remania d’ailleurs le texte à cette occasion. Plusieurs illustrations de L’Empire des signes proviennent de ce catalogue[88].
On voit donc se distinguer assez nettement trois périodes dans la relation de Barthes au haïku :
– La première, la plus ancienne, semble dater des années 1950 (à supposer qu’elle ne soit pas plus ancienne encore[89]). Elle s’enracine vraisemblablement dans les deux anthologies de Kikou Yamata d’une part, Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin d’autre part, c’est-à-dire dans la perception japoniste du haïku des années 1920-1930.
– Une deuxième période, celle des voyages au Japon et de la rédaction de L’Empire des signes, dans la seconde moitié des années 1960, semble placée sous le signe de la lecture de Blyth et de Watts (et de la reprise des haïkus de la période précédente) : on manque d’éléments précis pour la borner précisément, mais peut-être faut-il faire l’hypothèse que Barthes serait devenu sensible à ces ouvrages, comme au bouddhisme zen en général, lors de ses séjours aux États-Unis – alors en pleine vague zen[90] – de 1966 et 1967, séjours par ailleurs intercalés entre ses voyages au Japon (en décembre 1967, pour le troisième et dernier d’entre eux, il partira directement de Baltimore pour Tôkyô). Ce qui est certain en tout cas, au-delà de la traduction-citation des poèmes, c’est que la conception zen que Blyth a du haïku, complètement absente de la vision japoniste d’avant-guerre, a eu une influence majeure sur la rédaction de L’Empire des signes et qu’elle fut par ailleurs confortée par les ouvrages de Watts et de Suzuki. C’est de ces lectures que Barthes tire sa formule aussi péremptoire qu’inexacte : « le zen dont le haikai n’est que la branche littéraire[91] ».
– La troisième période sera celle du cours La Préparation du roman, à la fin des années 1970. Elle intégrera les anthologies toutes récentes de Roger Munier et Maurice Coyaud parues en 1978, elles-mêmes d’ailleurs fortement influencées par l’anthologie de Blyth comme par… L’Empire de signes. Ce sera le temps d’une nette évolution vers ce que Barthes va alors nommer « mon haïku[92] », forme exemplaire de « la Notation », étape décisive de la préparation d’une « Œuvre » littéraire[93].
À jeter un regard synthétique sur cet itinéraire, on mesure à quel point Roland Barthes, né en 1915, mort en 1980, fut un homme du xxe siècle, les différents moments de son rapport au haïku se superposant avec les grandes étapes de la « réception », c’est-à-dire de l’appropriation du genre en Occident.
Comment les traducteurs informent-ils la vision du haïku de L’Empire des signes ?
Barthes a eu accès aux haïkus japonais par le biais des traductions qu’il a pu en lire. Il s’en montre parfaitement conscient dans le cours du 6 janvier 1979, mais pour mieux évacuer le problème : « Quand je lis des haïkus je suis entièrement livré au traducteur et cependant visiblement le traducteur ne fait pas barrage[94]. » Or, s’il est vrai les traductions « ne font pas barrage », d’une certaine manière (puisque Barthes est sensible à « quelque chose » du haïku), bien loin cependant d’être neutres et transparentes, elles ont profondément orienté et construit la vision qu’il se fait du genre[95].
Nous passerons rapidement sur un fait capital. Les anthologies auxquelles Barthes a pu avoir accès ne présentent qu’un nombre infime de poèmes, car, comme il le dit très bien lui-même : « Combien de haïku dans l’histoire du Japon[96] ? » Cette immense quantité de versets rend d’ailleurs l’histoire du genre inséparable de nombreux processus de sélection et de compilation, au Japon même. Il faut néanmoins souligner que les auteurs des anthologies occidentales, françaises ou anglo-saxonnes par exemple, ne choisissent généralement que les haïkus dont ils peuvent espérer faire quelque chose en traduction, omettant de ce fait tous ceux dont la langue ou la poétique leur résistent[97]… Remarquons en outre que les seize haïkus cités par Barthes mêlent à un corpus de versets classiques (la grande majorité sont de Bashô ou de ses disciples – Kikaku, Jôsô, Hassô, Etsujin –, et datent donc de la fin du xviie siècle), un verset de Buson et un de Yayû, qui ont vécu un siècle plus tard, ainsi que deux versets de Masaoka Shiki, l’homme qui a réformé le genre au xixe siècle en s’appuyant sur une conception occidentale de la littérature[98]. Enlever à la forme son historicité : tel est le premier effet pervers des anthologies occidentales de haïkus, qui n’épargne pas Roland Barthes.
Constatons enfin que sur les seize haïkus cités par Barthes dans L’Empire des signes, quatre étaient déjà cités par Paul-Louis Couchoud dans son article fondateur (en langue française) de 1906[99], et quatre par Basil H. Chamberlain dans la toute première étude sur le genre en langue anglaise, parue en 1902[100]. On mesure ainsi une certaine force d’inertie des premières présentations du genre en Europe et aux États-Unis.
Mais concentrons-nous, à partir de quelques exemples, sur le travail de traduction lui-même et sur la manière dont il induit et façonne le commentaire barthésien[101]. Le premier haïku cité par Barthes est une traduction de Kikaku [Kikakou] par Matsuo et Steinilber-Oberlin :
Concombre coupé.
Son jus coule
Dessinant des pattes d’araignée
que Barthes commente ainsi :
L’avenir du concombre n’est pas son entassement ou son épaississement, mais sa division, son éparpillement ténu. […] Il y a convergence du minuscule et du comestible : les choses ne sont petites que pour être mangées, mais aussi elles sont comestibles pour accompagner leur essence, qui est la petitesse[102].
L’original japonais se présente de manière quelque peu différente :
瓜の皮 水もくもでに 流れけり
Uri no kawa mizu mo kumode ni nagarekeri
Nous proposons de traduire, le plus littéralement possible :
Peau de melon. Le jus aussi, en pattes d’araignée, s’est écoulé.
La version française utilisée par Barthes change le référent du poème : sans s’attarder sur l’hésitation à traduire uri par « concombre » ou par « melon » (qui sont tous deux possibles, mais le second est plus vraisemblable[103]), il faut noter que le verset original ne renvoie pas à de la chair coupée en morceaux, mais à une « peau » (kawa) qui a été enlevée : le fruit reste entier. Si le jus s’écoule bien en toutes directions, la thématique de la division, de l’éparpillement, de la petitesse, est absente. C’est la traduction, et elle seule, qui l’a proposée à Barthes.
Le deuxième haïku cité dans L’Empire des signes ponctue une réflexion sur les gares et les quartiers de Tôkyô. Il a été retraduit par Barthes à partir d’une version anglaise de Bashô par Blyth :
Ainsi sonne chaque nom, suscitant l’idée d’un village, pourvu d’une population aussi individuelle que celle d’une peuplade, dont la ville immense serait la brousse. Ce son du lieu, c’est celui de l’histoire ; car le nom signifiant est ici, non souvenir, mais anamnèse, comme si tout Ueno, tout Asakusa me venait de ce haïku ancien (écrit par Bashô au XVIIe siècle) :
Un nuage de cerisiers en fleurs :
La cloche. – Celle de Ueno ?
Celle d’Asakusa[104] ?
Il se présente ainsi en japonais :
花の雲 鐘は上野か 浅草か
Hana no kumo kane wa Ueno ka Asakusa ka
Proposons la traduction :
Nuage de fleurs La cloche est-elle d’Ueno ? Est-elle d’Asakusa ?
Comme on le voit, la façon dont les traductions de Blyth, puis de Barthes, isolent exagérément le mot « cloche », faisant de lui une sorte de réponse à « nuage de cerisiers en fleurs », favorise un commentaire axé sur le « son du lieu », sur la manière dont « sonne chaque nom, suscitant l’idée d’un village » alors que le texte japonais ne s’appesantit pas sur cette cloche dont il cherche l’origine[105].
Dans le fragment consacré au théâtre de marionnettes intitulé « Les trois écritures », Barthes parle du visage du maître manipulateur qui tient le haut de la poupée et son bras droit : « Il a le visage découvert, lisse, clair, impassible, froid comme “un oignon blanc qui vient d’être lavé” (Bashô[106]) » Ces mots attribués à Bashô viennent d’une traduction par Matsuo et Steinilber-Oberlin du verset suivant :
葱白く 洗ひたてたる 寒さかな (芭蕉)
Nebuka shiroku araitatetaru samusa kana
On pourrait proposer :
Un poireau, à blanc, je viens de rincer. Quel froid !
Nebuka en effet désigne plus un poireau qu’un oignon, et il ne s’agit donc pas ici de laver un oignon blanc, mais de rincer un poireau terreux pour que sa partie blanche apparaisse. Shiroku en japonais n’est pas employé en fonction déterminante, mais en fonction adverbiale : on lave le poireau « à blanc », pour qu’il devienne blanc. C’est à nouveau un référent créé par la traduction, et absent de l’original, qui suscite le commentaire de Barthes[107].
Mais considérons à présent quelques-uns des haïkus à partir desquels Barthes élabore sa théorie de ce genre poétique. Le premier, cité dans la section « L’effraction du sens », est un verset de Buson, mot-à-mot retraduit de la version anglaise de Blyth, comme on l’a vu :
C’est le soir, l’automne,
Je pense seulement
À mes parents.
Les versions anglaises et françaises proposent un micro-récit qui commence par la mise en place d’un cadre temporel : « C’est le soir, l’automne », suivi d’une notation personnelle : « Je pense seulement / À mes parents ». Le lecteur se trouve donc comme devant une entrée de journal intime ou de récit à la première personne, d’une très grande simplicité et qui illustre à la perfection le propos introductif de Barthes : « Le haïku a cette propriété quelque peu fantasmagorique, que l’on s’imagine toujours pouvoir en faire soi-même facilement. On se dit : quoi de plus accessible à l’écriture spontanée que cela[108]. » L’original japonais a pourtant une logique quelque peu différente :
父母の ことのみおもふ 秋の暮
Chichi haha no koto nomi omou aki no kure
Je propose de le traduire ainsi :
À père et mère seulement je pense – Soir d’automne
Se télescopent ici deux motifs : l’acte quelque peu mystérieux de « penser seulement à père et mère » (Chichi haha no koto nomi omou), puis la mention d’une référence temporelle courante et conventionnelle, « Soir d’automne » (aki no kure), mot de saison présent par exemple dans un des plus fameux versets de Bashô : Kareeda ni / karasu no tomarikeri / aki no kure (Sur la branche morte / un corbeau se tient perché / l’automne à la brune[109] »
Il n’y a donc pas dans l’original l’embrayage de départ, « c’est le soir », qui pose un cadre dans lequel une action s’insère logiquement. Le verset de Buson exploite la coupe intérieure du verset[110] pour créer une surprise, un effet de montage, entre un motif bien connu, le soir d’automne et sa tristesse, et une notation personnelle. C’est la traduction de Barthes (après celle de Blyth) qui fabrique donc le fallacieux sentiment de facilité, de spontanéité, que retient le commentateur.
Pour mieux dénoncer les « voies d’interprétation » « déchiffrantes, formalisantes ou tautologiques » par lesquelles les commentateurs, « chez nous », cherchent à « percer le sens », c’est-à-dire à « le faire entrer par effraction[111] », Barthes s’appuie un peu plus loin sur un poème de Bashô, cité par Alan Watts d’après une version anglaise de Blyth, et dont il emprunte la traduction à Pierre Berlot :
Comme il est admirable
Celui qui ne pense pas : « La Vie est éphémère »
En voyant un éclair !
L’original japonais est plus elliptique, et son sens quelque peu différent :
Inazuma ni satoranu hito no tattosa yo
Soit en français :
A l’éclair celui qui ne s’éveille pas, comme il est digne de respect!
Ou, pour être plus clair :
Respect pour celui qui n’éprouve pas un satori à chaque éclair !
La traduction de Blyth (et la retraduction de Berlot) constituent donc une glose bavarde d’un verset original beaucoup plus sec, léger et moqueur. En japonais, celui-ci est d’ailleurs précédé d’un avant-texte sans ambiguïté : « Un moine de grande vertu dit : La demi connaissance du zen est à l’origine de grands dommages. Je lui en ai été fort reconnaissant » (ある智識ののたまわくなま禅大疵のもとひとかやいとありがたく覚えて). Il est ainsi à craindre que ce haïku ne vise précisément, comme par une ironique anticipation, ceux qui « s’éveillent » – ont des satori – à la moindre occasion, comme c’est précisément le cas dans la vulgate zenniste de Blyth, Watts ou… de Roland Barthes lui-même :
[Chaque image] a été seulement pour moi le départ d’une sorte de vacillement visuel, analogue peut-être à cette perte de sens que le Zen appelle un satori[112].
L’écriture est en somme, à sa manière, un satori : le satori (l’événement Zen) est un séisme plus ou moins fort (nullement solennel) qui fait vaciller la connaissance, le sujet : il opère un vide de parole[113].
Le haïku, au contraire, articulé sur une métaphysique sans sujet et sans dieu, correspond au Mu bouddhiste, au satori Zen, qui n’est nullement descente illuminative de Dieu, mais « réveil devant le fait », saisie de la chose comme événement et non comme substance, atteinte de ce bord antérieur du langage, contigu à la matité (d’ailleurs toute rétrospective, reconstituée) de l’aventure (ce qui advient au langage, plus encore qu’au sujet[114]).
Ce haïku, dont la traduction amenait Barthes à se gausser de ceux qui sur-interprètent un phénomène naturel, se présente ainsi dans sa version originale comme une moquerie à l’égard des demi-habiles dont la conception du satori, « éveil », « compréhension », serait trop superficielle[115].
Approchons à présent un verset parvenu à Barthes via une traduction de Kikou Yamata :
Je vis la première neige.
Ce matin-là j’oubliai
De laver mon visage[116].
L’original d’Etsujin est le suivant :
初雪を 見てから顔を 洗ひけり
Hatsuyuki o mitekara kao o araikeri
On peut tenter de le traduire par :
Première neige, ai regardée, puis mon visage ai lavé
Ou, plus prosaïquement,
Après avoir regardé la première neige, j’ai lavé mon visage.
Comme on le voit, la traduction de Yamata, citée par Barthes, crée deux phrases dans un poème qui n’en a qu’une (ce qui n’est pas la norme du haïku). Elle coupe au lieu de lier. Elle inverse en outre le sens du texte pour mieux en amplifier la tension : la « première neige » devient ici occasion d’un événement. Son importance justifie une attente, un report. Et l’usage du passé simple contribue, évidemment, à dramatiser ce verset.
Or la particule finale -keri (dans araikeri) permet d’exprimer « la découverte subite d’une réalité existante, qui était déjà là dans le passé, mais dont on prend soudain conscience. Une nuance émotive s’y attache[117] ». Le verset japonais dit ainsi la prise de conscience de la succession paisible de deux actions : le poète est sans doute sorti sur la coursive extérieure, il a pris le temps d’observer la première neige, puis il s’est lavé le visage. Il n’y a là aucune trace du pseudo-événement artificiellement fabriqué par Yamata au prix d’un contresens volontaire (« J’oubliai / De laver mon visage), mais un retour au quotidien (trivial) après le temps consacré au spectacle (poétique) de la nature impliqué par le mot de saison « première neige ». C’est à nouveau une traduction française créatrice d’incident qui amène Barthes à penser que « c’est l’événement proprement dit qui prédomine[118] », alors que l’original japonais donnait à apprécier à ses lecteurs le plaisir de la découverte d’une plaisante conjointure entre élégance et trivialité.
On retrouvera une logique similaire dans la traduction d’un haïku de Hassô, attribué par Barthes à Bashô à la suite de Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin à qui il l’emprunte.
Le vent d’hiver souffle.
Les yeux des chats
Clignotent.
Alors que les verbes, on le voit, sont au cœur de cette traduction, l’original japonais en est totalement dépourvu :
凩や 胯しげき 猫の面
Kogarashi ya matataki shigeki neko no tsura
Soit mot-à-mot :
Premier vent d’hiver ! Clignements fréquents Face du chat
Barthes commente ainsi le verset qu’il vient de citer :
De tels traits (ce mot convient au haïku, sorte de balafre légère tracée dans le temps) installent ce qu’on a pu appeler « la vision sans commentaire ». Cette vision (le mot est encore trop occidental) est au fond entièrement privative ; ce qui est aboli, ce n’est pas le sens, c’est toute idée de finalité : le haïku ne sert à aucun des usages (eux-mêmes pourtant gratuits) concédés à la littérature : insignifiant (par une technique d’arrêt du sens), comment pourrait-il instruire, exprimer, distraire[119] ?
On voit bien comment la traduction de Matsuo et Steinilber-Oberlin crée un parallélisme entre « vent d’hiver » et « yeux des chats » : l’un « souffle », les autres « clignotent », et le lecteur se trouve en présence d’un petit récit paratactique en apparence rétif à toute interprétation, disposé à être reçu « tel » qu’il s’offre à cette « vision sans commentaire ».
En japonais cependant, l’intérêt du lecteur est suscité par le mot de saison kogarashi, désignant la bise glaciale qui annonce la fin de l’automne et le début de l’hiver. Très banal en poésie, et donc éminemment « littéraire », il a fait l’objet de nombreuses associations. Tout l’art de Hassô est ici de surprendre en associant ce terme conventionnel à une notation prosaïque finement observée : le visage d’un chat, qui s’amuse à se tourner vers ce vent piquant et à offrir un spectacle inhabituel (les chats généralement ne clignent pas des yeux), comme s’il était malade (interprétation grave) ou amoureux (interprétation légère). Il n’y a pas « événement » ici, « balafre légère tracée dans le temps », mais bien jeu divertissant tenant une fois encore à l’association d’un mot de convention poétique à une notation prosaïque[120].
Petitesse et éparpillement, son du nom, oignon blanc lavé, simplicité, notation d’incident, lutte contre les interprétations plaquées… La manière dont Barthes « forme système » obéit évidemment à son imaginaire et à ses raisons propres, par principe respectables[121]. Mais les « traits » qu’il combine ne sont pas prélevés « là-bas » dans le réel japonais, comme il le dit, mais bien ici, dans le courant de ce que l’on peut appeler pour simplifier « le japonisme littéraire français » des soixante premières années du xxe siècle[122]. Loin de toute « naïveté d’un premier regard » (Pinguet), inconsciemment peut-être, Barthes s’inscrit dans les chemins et les ornières qu’ont tracés et creusées une série de traducteurs et commentateurs occidentaux dont il emprunte le pas, dans une démarche pour « acclimater notre inconnaissance de l’Asie grâce à des langages connus (l’Orient de Voltaire, de la Revue Asiatique, de Loti ou d’Air France[123]) », qu’il dénonçait pourtant lui-même au début de L’Empire des signes.
Conclusion
Le Japon de Roland Barthes est celui du milieu des années 1960, en un double sens. Il est ce Japon réel que Barthes a visité, avec lequel il a eu contacts et échanges entre 1966 et 1968. Mais il est aussi le Japon imaginaire auquel rêvait la France de ces années-là, dans le droit fil d’une longue élaboration fantasmatique inaugurée par le célèbre récit inaugural de Marco Polo, élaboré à la fin du XIIIe siècle :
Çipingu est une île au Levant, qui est en haute mer, à mille cinq cents milles des terres. Elle est très grandissime. Les gens sont blancs, de belles manières et beaux. Ils sont idolâtres et se gouvernent eux-mêmes, et ne sont sous la seigneurie de nuls autres hommes, sinon d’eux-mêmes.
Et vous dis aussi qu’ils ont or en grandissime abondance, parce qu’on en trouve outre mesure en ce pays[124].
Dans les années 1960, à un moment où le monde essaye de sortir de l’après-guerre, le Japon honni de Pearl Harbour, le Japon détruit de Hiroshima, redevient un vif objet d’intérêt en Occident[125], après une longue parenthèse, parce qu’il rentre à nouveau dans le jeu des nations (son rôle à l’Unesco est alors caractéristique), parce que la révolution des transports le rapproche (on y va désormais en avion), mais surtout sans doute parce qu’il semble incarner pour certains une « troisième voie », voire une « quatrième », à l’écart du capitalisme, du communisme et du tiers-mondisme[126].
Cette redécouverte du Japon se fait dans un mouvement complexe qui associe à une réinterprétation d’un japonisme très français hérité de la fin du xixe siècle[127], des contacts directs avec le Japon contemporain en pleine transformation, mais aussi la prise en compte d’autres visions, venues du monde anglo-saxon par exemple (avec la Beat Generation), voire, même si c’est moins directement évident pour le haïku, d’Allemagne (qu’il s’agisse d’Eugen Herrigel, Martin Heidegger, ou Karlfried Graf Durckheim[128]). Il est important de bien prendre en compte l’existence de ces strates, sans céder aux illusions de la linéarité, car des éléments plus anciens peuvent, dans des situations nouvelles, acquérir une signification inédite.
La rencontre de Barthes avec le néo-bouddhisme de Suzuki Daisetsu, ce « zen de contrebande » auquel il accède essentiellement par le biais de Reginald H. Blyth et d’Alan Watts, est survenue à un moment où il était sensible – aussi bien sur le plan intime que sur le plan intellectuel – à un certain épuisement de la démarche engagée sous les auspices du structuralisme et de la nouvelle critique. C’est aussi à cette époque d’ailleurs qu’il découvre l’ouvrage de Vladimir Lossky, Théologie négative et connaissance de Dieu chez maître Eckhart, paru en 1960. Frappé par cette idée du haïku comme « branche littéraire du zen » issue de la réception anglo-saxonne du genre, il la développe dans sa logique à lui, non pas dans le sens d’une mystique diffuse à la Blyth, mais comme utopie sémiologique d’un langage fonctionnant comme pure désignation[129], bien qu’il s’agisse là d’un complet contresens par rapport à la réalité historique du haïku japonais[130].
La conception du haïku de L’Empire des signes prend ainsi place dans un contexte complexe qui la détermine autant qu’elle contribue à le faire évoluer. Barthes fut à la fois l’héritier d’une vision du haïku venue des premières années du xxe siècle et l’un des introducteurs privilégiés en France de la conception zen proposée par Reginald H. Blyth[131]. Il fut ainsi, grâce en particulier à la puissance de certaines de ses formulations, un des initiateurs d’une nouvelle popularité du genre.
Ce que nous avons tenté dans cet article, c’est d’une part d’identifier le plus précisément possible les sources des citations de Roland Barthes, d’autre part de montrer, sur une poignée d’exemples, comment ses analyses étaient directement héritières des logiques mises en œuvre par certaines traductions. Alors même que Barthes critique les commentaires de Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin, ou qu’il se démarque du mysticisme de Blyth, il développe pourtant sa propre vision dans le droit fil de leurs traductions, sans imaginer une seconde que celles-ci sont, par principe, porteuses d’une certaine vision du genre.
La naïveté du Barthes de L’Empire des signes à l’égard du travail de traduction est troublante[132]. Elle tient sans doute d’une forme de bêtise amoureuse, mais aussi d’une certaine attitude à l’égard des langues étrangères[133]. En janvier 1979, dans un entretien avec Nadine Dormoy Savage publié dans The French Review[134], il répondra ainsi à la question « Peut-on parler un peu de votre intérêt pour les cultures orientales ? » :
Sur le plan des faits, il est absolument évident qu’un Occidental ne peut pas avoir un accès authentique aux cultures extrême-orientales pour des raisons linguistiques. Ce sont des langues très difficiles et très lointaines dont l’apprentissage demande des années de très grande spécialisation ; encore n’est-on pas sûr d’y arriver. Un intellectuel occidental ne peut pas se permettre cela dans sa vie ; quand bien même il se mettrait à apprendre un peu de chinois, au bout de trois ans d’efforts il ne saura pas le chinois, c’est absolument évident. Je dirai la même chose pour les langues qui véhiculent le bouddhisme. Donc, nous n’avons de la pensée extrême-orientale qu’un très vague reflet, très déformé, et nous ne nous mettons pas, nous autres Occidentaux, par rapport à l’Extrême-Orient, dans une relation de vérité, parce que nous n’y avons pas accès linguistiquement. Mais l’Orient nous sert parce qu’il représente une Altérité authentique. […] Nous avons besoin (en tout cas c’est nécessaire dans ma vie intellectuelle) d’une sorte de pulsation entre le même et l’autre. Ce que je peux percevoir, par reflets très lointains, de la pensée orientale me permet de respirer.
On est saisi par l’alliance paradoxale de deux arguments : alors même que l’« accès authentique » aux cultures extrême-orientales est posé comme impossible, celles-ci sont pourtant censées représenter une « altérité » tout aussi « authentique ». On mesure dès lors à quel point l’incipit de L’Empire des signes est moins clair qu’il n’y paraît, combien la frontière est poreuse entre le Japon réel, où l’on prélève des traits, et le Japon fantasmé dont on fait système. Or, parmi les opérateurs qui permettent ce brouillage des frontières, il y eut précisément toute une série de « passeurs », au premier rang desquels les traducteurs, dont les œuvres favorisent la confusion entre Japon réel et Japon fantasmé. Réfléchir au travail de ces passeurs eux-mêmes, aux contacts qui furent les leurs avec le réel japonais, à la manière dont ils l’intégrèrent eux-mêmes à leurs imaginaires, fournit ainsi un terrain privilégié pour comprendre les circonstances de la fabrication du fantasme barthésien comme la nature exacte de celui-ci.
Quels que soient les malentendus et les contresens sur lesquels elle a reposé, ou qu’elle a suscités, la rencontre de Barthes et du haïku n’en fut pas moins féconde. Terminons notre propos en la rapprochant de deux autres, toutes aussi singulières, qui doivent beaucoup elles aussi à ces intermédiaires décisifs que sont les traducteurs. Dans les années 1920, c’est Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein qui découvre la présentation du haïku donnée par Yone Noguchi [Noguchi Yonejirô] – le père d’Isamu Noguchi – dans The Spirit of Japanese Poetry paru aux Etats-Unis en 1914. Il en tire un formidable article, « Le principe cinématographique et la culture japonaise », où il poursuit l’élaboration de sa théorie du montage en y intégrant une réflexion sur les caractères chinois, le kabuki et… le haïku[135].
Plus près de nous, c’est Philippe Forest qui séjourne en 1999 à la Villa Kujôyama à Kyôto et qui tombe à la librairie Maruzen sur l’œuvre du poète de haïku Kobayashi Issa parue en traduction anglaise deux ans plus tôt[136] :
Je me souviens avoir mis la main un peu par hasard sur la traduction anglaise de Ora ga haru. Une providence veille sur les vrais lecteurs et leur fait toujours découvrir au moment juste le livre que leur désir appelle sans même qu’ils le sachent encore. […] Plusieurs années ont passé et mon troisième roman [Sarinagara ] est sorti tout entier de la lecture de Issa[137].
Personne n’a peut-être aussi bien exprimé ce qui se passe dans ce genre de situations que Camille Pissarro dans une lettre envoyée à son fils Lucien le 3 février 1893, au sortir d’une exposition d’estampes : « Ces artistes japonais me confirment dans notre Parti pris visuel[138]. »
notes
- Roland Barthes, L’Empire des signes, Genève, Skira, coll. « Les Sentiers de la création », 1970 (toujours cité d’après le (presque) fac-similé paru aux éditions du Seuil, Paris, 2015), p. 9. ↑
- Maurice Pinguet, Le Texte-Japon, Paris, Le Seuil, 2009, p. 31. ↑
- Article « Prélever », in Trésor de la Langue Française informatisé.http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3877138575; ↑
- Cité dans l’article « Prélever », in Trésor de la Langue Française informatisé, idem. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 35-39. ↑
- Ibid., p. 97-101. ↑
- Ibid., p. 47-51. ↑
- Ibid., p. 52-57. ↑
- Ibid., p. 13-17. ↑
- Ibid., p. 139-143. ↑
- Ibid., p. 120-126. ↑
- Merci à Claude Coste (communication orale, « Les archives de L’Empire des signes », séminaire d’équipe « L’Empire des signes : un objet, une époque », Centre d’études japonaises, Inalco, 8 mars 2016) pour nous avoir alerté sur ce point. ↑
- M. Pinguet, op. cit., p. 31. ↑
- Même s’il est avéré que Barthes travaillait à partir de fiches (Maurice Pinguet, Le Texte-Japon, op. cit., p. 25), celles qui auraient servi à l’élaboration de L’Empire des signes ne sont pas connues. ↑
- Les images utilisées par Barthes sont en revanche mieux repérables puisque l’ouvrage comporte une « Table des illustrations » (voir R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 153-155). Au sujet des images utilisées par Barthes dans L’Empire des signes, voir Emmanuel Lozerand, « La beauté convulsive d’un marché aux puces surréalistes. William Klein, Roland Barthes, Maurice Pinguet et le Japon des années 1960 », in Julien Bouvard et Cléa Patin (éd.), Japon Pluriel 12, Arles, Philippe Picquier, 2018. ↑
- Nous choisissons de transcrire « haïku » à la manière de Roland Barthes. ↑
- Un Philippe Forest par exemple a inséré de faux haïkus de sa composition dans Sarinagara (Paris, Gallimard, 2004). À ce sujet, voir Nao Sawada, « Délice et supplice de la traduction : le cycle japonais de Philippe Forest », in Aurélie Foglia, Catherine Mayaux, Anne-Gaëlle Saliot et Laurent Zimmermann (éd.), Une vie à écrire, Paris, Gallimard, Coll. « Les Cahiers de la NRF », p. 273-281. ↑
- Voir Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Le Seuil, 2015, passim ; et E. Lozerand, « La beauté convulsive… », art. cit. ↑
- À ce sujet, voir l’article de Muriel Detrie dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes.↑
- Les quelques notes présentes dans « La leçon d’écriture », Tel Quel, no 34, été 1968, p. 28-33 (OC III, 33-39) ont disparu dans L’Empire des signes en 1970. Parfois, cependant, Barthes donne un nom d’auteur (« Bashô »), ou une date (« xviie siècle »). ↑
- Claude Coste, communication orale, déjà citée. ↑
- On sait qu’il existe deux éditions de ce cours, celle des notes préparatoires en 2003, celle de la version prononcée en 2015 : Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Seuil / IMEC, coll. « Traces écrites », 2003 ; Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Seuil, 2015. C’est à cette dernière que nous nous référerons ici. ↑
- Le fascicule « Haïkus » est reproduit dans Roland Barthes, La Préparation du roman, 2015, op. cit., p. 557-565. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, 2015, op. cit., p. 72. ↑
- Ibid., p. 74. ↑
- Ibid., p. 567. ↑
- Partagée par l’éditrice Nathalie Léger (ibid., note 2, p. 72). ↑
- Reginald H. Blyth, A History of Haïku, deux volumes, Tôkyô, The Hokuseido Press, 1964. ↑
- Reginald H. Blyth, Haïku, quatre volumes, Tôkyô, The Hokuseido Press, 1949-1952 (réédition Tôkyô, The Hokuseido Press/Heian International, 1981). ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 82 ↑
- Philippe Jaccottet, « L’Orient limpide », La Nouvelle revue française, no 95, novembre 1960, 1960, p. 901-908 (repris dans Une transaction secrète, Gallimard, 1987, p. 121-131). C’est en août 1960 que Jaccottet mentionne Blyth pour la première fois dans des notes personnelles. ↑
- « Telle est la raison de l’intérêt pour le haïku que l’on a vu se développer en France dans la deuxième moitié de notre xxe siècle, et qui est aujourd’hui toujours aussi fort. Cet intérêt s’est établi quand les textes et une certaine idée des poètes japonais commencèrent à circuler, grâce à des traductions ou des commentaires, et c’est ainsi que le livre de Blyth, Haïku, a joué un grand rôle auprès de certains d’entre nous. […] Je n’hésiterai pas à dire que les meilleurs des poètes français depuis les années 1950 ont réfléchi à cette forme de poésie. Il ne s’est pas agi de ce qu’on pourrait appeler une mode du haïku, mais de la prise de conscience d’une référence nécessaire et fondamentale, qui ne peut que rester au centre de la pensée poétique occidentale. » (Yves Bonnefoy, « Le haïku, la forme brève et les poètes français », Masaoka Shiki International Haïku Awards Project, septembre 2000)(https://web.archive.org/web/20031004020410/http://www.shiki.org/2000/french.pdf ↑
- Sur Reginald H. Blyth, voir l’article d’Evelyne Lesigne-Audoly dans la présente livraison de la Revue Roland Barthes. Voir aussi la traduction de Daniel Py, Haïku, vol. 1 (La culture orientale), Saint-Chéron, Editions Unicité, 2017. ↑
- Roger Munier, Haïku, préface d’Yves Bonnefoy, Paris, Fayard, coll. « Documents spirituels », 1978 ; et Maurice Coyaud, Fourmis sans ombre. Le livre du haïku. Anthologie-promenade, Paris, Phébus, 1978. Ce sont des haïkus choisi dans les quatre volumes de Blyth qu’a traduits, de l’anglais, Roger Munier, disciple de Heidegger, qui avait découvert le livre de Blyth lors d’un voyage au Japon en 1959. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, op. cit., 2015, p. 72. ↑
- T. Samoyault, op. cit, p. 69-72. Je remercie Tiphaine Samoyault d’avoir attiré mon attention sur cette connexion entre Kikou Yamata et la famille de Roland Barthes. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 74. ↑
- R. Barthes, ibid., p. 75. ↑
- La traduction de Sô Sakon a paru sous le titre Hyôchô no teikoku (Tôkyô, Shinchôsha, 1974, réédition Tôkyô, Chikuma gakugei bunko, 1996) ; celle d’Ishikawa Yoshiko sous celui de Kigô no kuni (Tôkyô, Misuzu shobô, 2004). ↑
- Sô Sakon n’en dit rien, Ishikawa Yoshiko mentionne Yamata et Blyth, sans approfondir. ↑
- Tous deux donnent une retraduction en japonais des haïkus cités par Barthes, ainsi que les versets originaux en japonais (Sô Sakon dans le corps du texte, Ishikawa Yoshiko en note), en accentuant fortement la différence entre « retraduction » et originaux. ↑
- Sur le regard français sur le Japon à l’époque, voir Emmanuel Lozerand, « La dilution du sujet japonais chez les intellectuels français au tournant des années 1970. Avatars d’un stéréotype », in Fabien Arribert-Narce, Kuwada Kôhei et Lucy O’Meara (dir.), Réceptions de la culture japonaise en France depuis 1945. Paris-Tôkyô-Paris : détours par le Japon, Honoré Champion, 2016, p. 51-70. ↑
- Certains haïkus, comme celui de « la grenouille » ou du « nuages de fleurs », avaient déjà fait l’objet de nombreuses traductions en français. Voir Jérôme David, Faire la fête avec un seul confetti : sur un haïku de Bashô, revue L’Ours blanc, n° 14, Genève, éditions Héros-Limite, 2016. ↑
- Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Sur des lèvres japonaises, Paris, Le Divan, 1924, p. 96 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 102. ↑
- Kikou Yamata, op. cit., p. 96 ; cité par R. Barthes, op. cit., p. 110. ↑
- Cité sous une forme un peu différente dans le fascicule « Haïkus » : « Je vis la première neige / Ce matin-là, / J’oubliai de laver mon visage » (R. Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 561). ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 102. ↑
- Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, illustré par Foujita, Institut international de coopération intellectuelle, 1936, p. 58 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 26. La traduction de ce haïku avait déjà été publiée dans Kuni Matsuo et Émile Steinilber-Oberlin, Les Haikais de Kikakou, Paris, G. Cres et C°, 1927, p. 336. Rien n’indique cependant que Barthes ait connu cet ouvrage. La disposition du poème et les choix de casse y sont d’ailleurs différents de ceux de Bashô et ses disciples, que suit fidèlement Barthes. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 69 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 40 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 38 ; cité R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 95. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 22 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 111. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 24 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 68, 126. ↑
- L’occultation par Barthes de la référence à Matsuo est profonde, car, au début du fascicule (op. cit., p. 557), il explique que, sauf référence à Coyaud, Munier ou Yamata, « les autres haïkus ont été rassemblés et traduits de l’anglais par le professeur ». Tout laisse donc penser, pour le lecteur, qu’ils proviennent de l’anthologie de Blyth. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 70. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 40. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 96 ; K. Matsuo et É. Steinilber-Oberlin, Bashô et ses disciples, op. cit., p. 38. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 25. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 57. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 204. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 91. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 284. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 165. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 102. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. III, p. 656. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 111. ↑
- Voir Jérôme David, Faire la fête avec un seul confetti, op. cit. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 329. ↑
- Alan Watts, Le Bouddhisme zen, Paris, Payot et Rivages, 2003, p. 253 (première édition, Paris, Payot, 1960) ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 96. C’est ici aussi une référence totalement occultée dans La Préparation du roman (op. cit., p. 557), bien que le titre de l’ouvrage de Watts figure dans la bibliographie du cours (op. cit., p 572). ↑
- Par exemple la réflexion sur « Tel » (voir à ce sujet l’article de Muriel Détrie dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes). ↑
- « Toutes les traductions anglaises de ces poèmes sont l’œuvre de R. H. BLYTH et sont tirées de son magnifique ouvrage Haïku, qui est indiscutablement la meilleure étude du sujet existant en anglais. » (Alan Watts, op. cit., note 1, p. 252). ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. I, p. 189. ↑
- René Sieffert, La Littérature japonaise, Paris, Armand Colin, collection « Langues et civilisations », 1961, p. 149 ; cité par R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 110. Je remercie Muriel Détrie d’avoir attiré mon attention sur la traduction de René Sieffert. ↑
- R. Blyth, Haïku, 1981, op. cit., vol. III, p. 927. ↑
- René Sieffert (1923-2004) faisait alors figure d’autorité incontestée pour ce qui concerne la littérature japonaise classique. Il est très frappant de constater qu’il publie la première traduction française de « La Sente étroite au bout du monde » de Bashô (Oku no hosomichi) dans le numéro 6, été 1968, de la revue de poésie L’Éphémère, dirigée par Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Louis-René des Forêts et Gaëtan Picon, c’est-à-dire au moment même où Barthes publie sa « Leçon d’écriture » dans Tel Quel. C’est fin 1968 que Gaëtan Picon quitte la revue L’Éphémère. Il va fonder chez Skira en 1969 la collection « Les Sentiers de la création », dont Barthes publiera en 1970 le cinquième volume : L’Empire des signes. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, 2015, op. cit., p. 572. ↑
- René Sieffert, Le Haikai selon Bashô, Cergy, Publications orientalistes de France, p. X-XI. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 15. ↑
- Charles Haguenauer, Morphologie du japonais moderne, Vol. 1: Généralités; Mots invariables, Paris, Klincksieck, 1951. ↑
- Jean-Jacques Origas, Structure de la langue, Inalco, 1re édition 1970-1972. ↑
- Catalogue Japanische Tuschmalerei Nanga und Haiga, aus der Zammlung Heinz Basch, Kunstgewerbemuseum Zürich, 8 juillet 12 août 1962, p. 10. J’adresse mes plus vifs remerciements à mon collègue Michel Vieillard-Baron qui a attiré mon attention sur cette exposition (se reporter à son article sur le waka dans la présente livraison de la Revue Roland Barthes). ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 153. ↑
- Ibid., p. 32. ↑
- Voir L’Empire des signes, op. cit., p. 32, 61 et 95. ↑
- Voir à ce sujet l’article de Muriel Détrie dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- Sur la diffusion du zen en Occident, voir Emmanuel Lozerand, « Les contrebandiers du zen. Sur le rôle des passeurs dans un processus de cosmopolitisation », in G. Bridet, X. Garnier, S. Moussa et L. Zecchini (dir.), Littérature et cosmopolitisme, « Écritures », Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2019. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 99. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, 2015, op. cit., p. 58. ↑
- Voir à ce sujet les articles de Terada Sumie et Tiphaine Samoyault dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. Voir aussi Philippe Forest, « Haïku et épiphanie : avec Barthes, du poème au roman », in Haikus, etc. suivi de 43 Secondes (Allaphbed, t. 4), Nantes, éditions Cécile Defaut, 2008. ↑
- R. Barthes, La Préparation du roman, 2015, op. cit., p. 63. ↑
- Paul-Louis Couchoud écrivait d’ailleurs lui aussi : « Pour apprécier un uta il faut avoir l’éducation classique chinoise et japonaise. Un haikai au contraire, même en traduction pourra nous frapper. C’est une vision qui s’adresse directement à notre œil, une impression vive qui peut éveiller en nous quelque impression endormie » (« Les Haï-Kaï. Les épigrammes poétiques du Japon », Les Lettres, 1906, réédition sous le titre « Les épigrammes lyriques du Japon », dans Sages et poètes d’Asie, Calmann-Lévy, 1916 ; ici cité d’après Le Haïkaï. Les épigrammes lyriques du Japon, Paris, La Table ronde, 2003, p. 29). ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 132. À titre d’exemple, notons que l’on connaît environ mille versets de Bashô, deux mille de Buson, trente à quarante mille de Shiki… Il existe donc bien des millions de haïkus japonais. ↑
- René Sieffert aimait à partir en guerre contre les « anthologies » : « Prétendre réaliser une “anthologie du haiku” en choisissant au petit bonheur des versets hétéroclites, empruntés à des auteurs de tendances et d’époques différentes, assemblés de bric et de broc, ne peut aboutir qu’à des créations informes […] » (« Introduction », in Le Manteau de pluie du singe, Cergy, POF, 1986, p. xiv). Il a ainsi tenté de proposer en français une vision du haïku différente de celle des Chamberlain, Couchoud, Yamata, Matsuo, Blyth, Munier ou Coyaud en publiant une traduction intégrale commentée des Sept recueils de Bashô (Cergy, POF, 1986-1994). ↑
- Voir Emmanuel Lozerand, « Refonder le haiku », in Compte-rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (à paraître). ↑
- Paul-Louis Couchoud, « Le haïkaï. Les épigrammes lyriques du Japon », op. cit.. Il s’agit des haïkus « Pleine lune… », « Que de personnes… », « C’est le soir, l’automne…”, et « La vieille mare… ». ↑
- Basil Hall Chamberlain, « Bashô and the japanese poetical epigram », Transactions of the Asiatic Society of Japan, v. 30, 1902, p. 241-362. Il s’agit des haïkus « La vieille mare… », « Que de personnes… », « J’arrive par le sentier de la montagne… », « Déjà quatre heures… », les deux premiers étant donc cités à la fois par Chamberlain et Couchoud. ↑
- Voir à ce sujet les remarques de Makiko Andro-Ueda dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. Nous la remercions vivement pour ses aperçus très suggestifs qui nous ont beaucoup stimulé. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 26. ↑
- Voir à ce sujet l’article de Makiko Andro-Ueda dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 57. ↑
- Voir à ce sujet l’article de Makiko Andro-Ueda dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 68. ↑
- Voir à ce sujet l’article de Makiko Andro-Ueda dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 91. ↑
- Traduction de René Sieffert, in Le Haïkaï selon Bashô, Cergy, POF, 1983, p.127. ↑
- Voir Mitsuko Kaneko, « La poétique du haiku et quelques aspects du poème court. Fonction de la coupure », Cahiers Forell – Formes et Représentations en Linguistique et Littérature – De la brièveté en littérature | Archives (1993-2001). http://09.edel.univ-poitiers.fr/lescahiersforell/index.php?id=109. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 94. ↑
- Ibid., p. 7. ↑
- Ibid., p. 11. ↑
- Ibid., p. 103. ↑
- Rappelons qu’une des figurations les plus courantes du satori vient d’une série d’images intitulée « Les dix taureaux » (Jûgyû-zu) qui représentent les étapes progressives du cheminement exigeant qui mène à la compréhension subite. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 102. On a vu que Yamata disposait sa traduction sur deux lignes. ↑
- Jacqueline Pigeot, Manuel de japonais classique, Paris, L’Asiathèque, 1998, p. 78. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 102. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 111. ↑
- Comme dit Haruo Shirane pour définir ce qu’il appelle « haikai imagination », « the vernacular injects new life in a classical cliché » (Haruo Shirane, Traces of Dreams. Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Bashô, Stanford, Stanford University Press, 1998, p. 10. Voir aussi du même auteur, « Beyond the Haiku Moment : Basho, Buson and Modern Haiku myths », Modern Haiku, vol. XXXI, no 1, hiver-automne 2000, consulté en ligne http://www.haikupoet.com/definitions/beyond_the_haiku_moment.html. ↑
- Car comme l’écrit Philippe Forest, « qui se ferait juge le juge du rêve d’autrui ? » (Philippe Forest, Allaphbed – Tome 4, Haikus, etc. Suivi de 43 secondes, Nantes, éd. Cécile Defaut, 2012, p. 15). Sur les liens entre Forest et le Japon, voir Emmanuel Lozerand, « Lettre d’un savant à un ignorant », in Aurélie Foglia, Catherine Mayaux, Anne-Gaëlle Saliot et Laurent Zimmermann (dir.), Philippe Forest. Une vie à écrire. Actes du colloque international Duke University & Universités de Paris 3, Paris 7 et Cergy-Pontoise, Les Cahiers de la Nrf, Paris, Gallimard, 2018, p. 164-183. ↑
- Voir à ce sujet l’article de Muriel Détrie dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 10. ↑
- Cité ici d’après Michel Butor, Le Japon depuis la France : un rêve à l’ancre, Paris, Hatier, 1995, p. 23. ↑
- À ce sujet, voir Emmanuel Lozerand, « La dilution du sujet japonais chez les intellectuels français au tournant des années 1970. Avatars d’un stéréotype », in Fabien Arribert-Narce, Kohei Kuwada et Lucy O’Meara (dir.), La réception de la culture japonaise en France depuis 1945. Paris-Tokyo-Paris: détours par le Japon, Paris, Champion, p. 27-38 ; et « La beauté convulsive d’un marché aux puces surréaliste. William Klein, Roland Barthes, Maurice Pinguet et le Japon des années 1960 », in Julien Bouvard et Cléa Patin (dir.), Japon Pluriel 12. Autour de l’image : arts graphiques et culture visuelle au Japon, Arles, Philippe Picquier, 2018, p. 359-376. ↑
- Voir en particulier les notes sur « le snobisme japonais » ajoutées par Alexandre Kojève en 1968 lors de la seconde édition de son Introduction à la lecture de Hegel de 1947. À ce sujet, Emmanuel Lozerand, « La dilution du sujet japonais chez les intellectuels français au tournant des années 1970 », op. cit. passim. ↑
- N’oublions pas que Barthes est né en 1915 et qu’il a été imprégné du japonisme d’avant-guerre avant de redécouvrir le Japon d’après la seconde guerre mondiale. ↑
- Sans compter le jésuite Hugo Lassalle, un des inspirateurs majeurs du dialogue œcuménique. À ce sujet, voir Emmanuel Lozerand, « Les contrebandiers du zen. Sur le rôle des passeurs dans un processus de cosmopolitisation », in Guillaume Bridet, Xavier Garnier, Sarga Moussa et Laetitia Zecchini (dir.), Littérature et cosmopolitisme, collection « Écritures », Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2019. ↑
- Ce n’est pas le même haiku que dans La Préparation du roman. Voir à ce sujet les articles de Terada Sumie et Tiphaine Samoyault dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes ; Ou encore Philippe Forest, « Haïku et épiphanie : avec Barthes, du poème au roman », in Allaphbed – Tome 4, Haikus, etc. op. cit. ↑
- Le haïku, au Japon, a souvent été un genre savant, descriptif, narratif, qui suscite des commentaires à l’infini. ↑
- À laquelle il donna cependant une inflexion personnelle. Voir à ce sujet l’article de Muriel Détrie dans le présent numéro de la Revue Roland Barthes. ↑
- Elle est moins grande dans La Préparation du roman. Voir Roland Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 63-66. ↑
- Tiphaine Samoyault, « Les langues étrangères de Roland Barthes », Littera (Revue de langue et litterature francaises), Tôkyô, Nihon furansugo furansu bungakkai, , vol.1, p. 5-13, 2017. ↑
- Reprise dans Roland Barthes, Œuvres complètes V, Paris, Seuil, 2002, p. 741. ↑
- Publié en russe à Moscou en 1929, il a été traduit en anglais en 1931. Il est publié en français dans Sergueï Eisenstein, Le Film : sa forme / son sens, Paris, Christian Bourgois, 1976. ↑
- Kobayashi Issa, The Spring of My Life: And Selected Haiku, traduction de Sam Hamill, Boulder, Shambhala, 1997. ↑
- Philippe Forest, Allaphbed – Tome 4, Haikus, etc. op. cit. ↑
-
Camille Pissaro, Lettres à son fils Lucien, Paris, Albin Michel, 1950. ↑