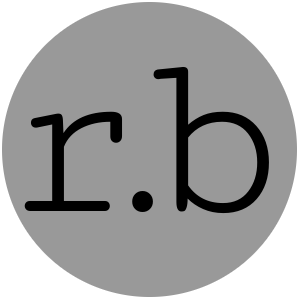Roland Barthes a donné au Collège de France entre 1978 et 1980 deux cours intitulés La Préparation du roman : le premier, qu’il a nommé « De la vie à l’œuvre », était consacré au haïku, le second, intitulé « L’œuvre comme volonté », a été interrompu par sa mort. Quel rôle a joué le haïku tel qu’il a été pensé par Barthes dans sa quête d’une nouvelle écriture à la fin de sa vie ? Mais tout d’abord, qu’est-ce qui l’a conduit à réfléchir avec autant d’insistance sur le haïku pour aborder la question qu’il nomme « la préparation du roman » ? Et quelle curieuse formulation que cette « Préparation du roman », comme si écrire un roman était une cérémonie… Si les particularités du haïku sont clairement exposées par Barthes, ce qu’il envisage par le terme de « roman » n’est pas vraiment explicité, et les contours du projet de ces deux années deviennent de plus en plus flous. Les plans et les notes qu’il a rédigés dans sa quête d’une Vita Nova montrent que le roman est envisagé par lui dans des configurations changeantes, tantôt situé sur le même plan que les autres types d’écriture, l’essai, le fragment et le journal, tantôt en opposition avec le journal, ou associé avec le fragment[1].
Le neutre et la question de l’écriture
Pour cerner l’enjeu que représente le haïku dans cette dernière entreprise de Roland Barthes, il me paraît utile d’introduire une perspective plus large et de considérer la question à partir du « désir du neutre », thème auquel était consacrée l’année précédant le cours sur le haïku. En effet, un lien étroit unit son discours durant les deux dernières années et le cours sur le neutre qu’il a donné entre février et juin 1978, période au cours de laquelle il a pris « la décision d’entrer dans l’écriture[2] ». Lors de la première séance du cours sur le neutre, Barthes précise ce qu’il entend par ce terne :
Le neutre ne renvoie pas à des impressions de grisaille, de « neutralité », d’indifférence. Le neutre, mon neutre peut renvoyer à des états intenses, à des états forts, à des états inouïs. Déjouer le paradigme, puisque c’est ce qu’est le neutre, peut être une activité ardente et brulante[3].
Cependant, au lieu de se concentrer sur « son neutre » désirable, Barthes examine les figures du neutre dans leur double aspect positif et négatif, recourant de plus en plus systématiquement à une logique d’opposition. Par ailleurs, les deux derniers cours semblent se partager deux aspects opposés : le cours sur le haïku se concentre sur le neutre désirable, tandis qu’il parle dans la deuxième année peu du neutre, et aucune figure franchement positive n’apparaît dans cette phase. Ceci nous invite à regarder au préalable la place du neutre dans les éléments clés du discours de Barthes sur le haïku, quitte à reprendre la discussion par la suite.
Dans cette perspective, le cours de Barthes sur le haïku soulève deux questions concernant l’écriture : celle que pose l’idée de fragment et celle du rapport qu’entretiennent les textes littéraires avec le réel. La première, celle du « fragment », se situe du côté de la praxis et constitue le versant formel de la seconde, relative au « rapport avec le monde » de l’écrivain. Barthes met à l’épreuve sa perception du réel à travers la pratique de la notation, et situe le rapport de son écriture avec le monde. Ces trois termes : fragment, réel et rapport avec le monde sont travaillés directement ou indirectement par l’idée du neutre, qui est une figure en soi déjà complexe, et qui entraîne inévitablement chez lui une autre figure à combattre : le paradigme. Barthes dit au début de son cours sur le neutre : « j’appelle Neutre tout ce qui déjoue le paradigme », et il précise : « là où il y a sens, il y a paradigme. […] On peut dire elliptiquement que le sens repose sur le conflit, c’est-à-dire le choix d’un terme contre un autre[4] ». Il transpose cette vision conflictuelle du système langagier sur le plan éthique, dans celle du rapport avec les autres, avec la société, avec le monde en général. Le neutre pour Barthes constitue les «champs polymorphes d’esquive du paradigme, du conflit[5] ».
Quant au lien du neutre avec la question du réel, Barthes parle dans « L’effet de réel[6] » de détail « inutile » à propos du baromètre qui apparaît dans la description d’un salon de Madame Aubain, personnage du Cœur simple de Flaubert. La « notation insignifiante » de cet objet crée, selon lui, un effet de réel à cause de l’absence apparente de contribution à la construction du récit. Le baromètre, dit Barthes, n’a d’existence que par sa fonction, qui est de fonder la vraisemblance de ce roman réaliste. Commentant un haïku sur un enfant promenant un chien, sur lequel je reviendrai plus loin, Barthes parle dans son cours du « sel » de la contingence qui fait qu’on ne puisse douter que cet enfant ait existé. La logique qu’il invoque comme génératrice de la sensation de réel est semblable dans les deux cas, la contingence, avec cette différence fondamentale que le haïku est dépourvu d’une fonction qui le relie à un autre discours supérieur au sien et qu’il s’épuise dans son écriture[7]. Barthes dira un peu plus loin :
Le haïku, c’est – ce qui survient (contingence) mais en tant que cela entoure le sujet – qui cependant n’existe et ne peut se dire sujet que par cet entour fugitif et mobile. […] on pose seulement des entours (des circonstants), mais l’objet s’évapore, s’absorbe dans la circonstance : ce qui entoure l’objet, le temps d’un éclair[8].
Ici encore, nous retrouvons deux figures du neutre contrastées : celle, terne et inerte du roman au service de l’ensemble dont il fait partie et celle du haïku, fragment solitaire et rayonnant qui déploie dans son mouvement un instant d’individuation par l’association d’un garçon, d’un chien et de la lune.
Pour Barthes, le haïku est l’écriture même du neutre désirable, avant tout à cause de sa facture fragmentaire, qui se traduit dans sa brièveté. Il s’agit donc de la question du temps que le texte peut renfermer. Barthes dit : « Un instant immédiat, consommé immédiatement, mais qui a en lui une sorte de vocation à être un souvenir », et il oppose le régime de la « mémoire immédiate » qui en découle à la mémoire involontaire de Proust « qui prolifère à travers une explosion infinie de métonymies, tandis que la mémoire immédiate ne prolifère pas, elle reste sur elle-même[9] ». L’écriture brève et fragmentaire est désirable parce qu’elle résiste à la prolifération du sens et ne se laisse pas envahir par les discours ambiants quels qu’ils soient. Le goût du fragment, de la brièveté et l’instant sont consubstantiels. En parlant du haïku Barthes dit encore : « Il y a une sorte d’accord instantané, fugitif et éblouissant du dire et du dit[10] ». Le goût pour l’immédiat fait donc partie intégrante du discours fragmentaire.
Les réflexions de Barthes sur le haïku sont souvent étonnamment pertinentes quand on pense à la différence des cultures, à son ignorance de la réalité historique du haïku. Ses cours sur le haïku, sur le corps, sur le temps qu’il fait, sur les objets sensibles sont imprégnés de sensations lumineuses du réel, de l’immédiat. On pourrait expliquer cette qualité de lecture dont il a fait preuve par sa sensibilité naturelle aux mots dont il a su capter les nuances à travers les traductions. Mais il convient de l’attribuer surtout à sa préoccupation constante pour les faits de langage et au rapport tendu qu’il entretenait avec celui-ci : son intérêt pour le langage, en tant que système de fonctionnement médiat par excellence, entrait en conflit avec son attachement farouche aux relations immédiates. Rappelons que La Chambre claire s’ouvre par un aveu sur son attachement à un rapport sans médiation. Voici le passage :
Un jour, il y a bien longtemps, je tombai sur une photographie du dernier frère de Napoléon, Jérôme (1852). Je me dis alors, avec un étonnement que depuis je n’ai jamais pu réduire : « Je vois les yeux qui ont vu l’Empereur. » Je parlais parfois de cet étonnement, mais comme personne ne semblait le partager, ni même le comprendre (la vie est ainsi faite à coups de petites solitudes), je l’oubliai[11].
La photographie est certes un support médiat, c’est une surface, considère Barthes, où se déroule un processus de « la révélation chimique de l’objet (dont, je reçois, à retardement, les rayons)[12] », qui le touche directement. Le temps de transmission s’abolit dans un instant de sidération. Dans le même livre, Barthes dit à propos de la photographie de sa mère, prise dans son enfance :
D’un corps réel, qui était là, sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici ; peu importe la durée de la transmission ; la photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographié[13].
Bernard Comment précise à propos de ce passage que « la magie chimique et lumineuse de la photographie permet la présence continuée de l’absent en l’émanation sans fin de l’instant de sa saisie […] Cet enchantement pour les “radiations immédiates (les luminances)” de l’être aimé répercutées sur la surface de l’image…[14] » Le cours de haïku est guidé par ce désir de l’immédiat fantasmé face à une absence.
À partir des différences entre deux réalités littéraires : le haïku en tant que fait historique et le haïku en tant qu’expérience personnelle de Barthes, je m’interrogerai maintenant d’une manière indirecte sur l’enjeu que représente l’écriture nouvelle à laquelle Barthes cherchait à accéder dans et par le roman. Se posent alors deux questions à propos de sa compréhension du haïku. La première est celle de la notation, et la seconde concerne la place de « l’autre » dans cette poésie. Commençons par la première question.
Question de la notation
En tant que premier pas vers le roman, Barthes prend note de ce qui a retenu son attention, de ce qui arrive autour de lui. C’est une écriture quotidienne et spontanée qui se fait au ras de la réalité. Il prend le haïku comme modèle de cette écriture.
Quand on examine le propos de Barthes à la lumière de la réalité historique du haïku, on peut dire qu’il a à la fois tort et raison. Si l’on considère le haïku de l’époque pré-moderne, on peut dire que l’idée que s’en fait Barthes est très loin de la réalité. Comme toutes les grandes formes littéraires, le haïku est, malgré son apparence simple et spontanée, très construit. Il ne s’agit nullement d’une écriture spontanée proche du journal. Sur ce plan, Barthes semble confondre l’écriture de haïku et l’effet engendré par cette écriture. Mais si l’on considère ce qui s’est passé à partir de l’époque moderne, après l’introduction des œuvres et des notions littéraires occidentales, quand le romantisme, le réalisme et le naturalisme sont entrés en même temps au Japon sans aucune mise en perspective, Barthes n’a pas tout à fait tort de considérer le haïku comme il le fait. Car sa compréhension correspond exactement à ce que dit un poète moderne Masaoka Shiki[15] à propos du haïku célèbre de Bashô :
Un vieux marécage / Une grenouille y saute / Oh le bruit de l’eau[16]
Voici ce que dit Shiki, qui rejette les interprétations philosophico-religieuses obscures avancées à propos de ce haïku :
Les débutants ont tendance à chercher l’idéal qu’exprimerait l’auteur par le haïku pour comprendre ce dernier. Cependant on trouve rarement ce type de composition, et nombreux sont les haïkus qui disent une chose telle qu’elle est. On trouve les pièces excellentes plutôt dans cette dernière catégorie. Des gens s’interrogent sur ce que représente le poème sur la grenouille de Bashô : un idéal de calme profond, le satori prêché dans la secte zen, etc.… Il faut le comprendre littéralement, tel quel, sans idéal caché derrière. Bashô a composé ce haïku en entendant le bruit d’eau « splash ! » qu’a fait une grenouille en sautant dans un vieil étang[17].
Shiki s’efforce de promouvoir la pratique de l’esquisse ou notation poétique (shasei) et conseille aux débutants de se promener avec un carnet pour composer beaucoup de haïkus. C’est le meilleur moyen selon lui pour progresser. Il n’oublie pas de donner des recommandations pratiques, comme des conseils sur les tenues vestimentaires. C’est une attitude qui correspond exactement au type de réflexions que fait Barthes sur la pratique de la notation dans son cours, et la remarque de Shiki rejoint tout à fait la compréhension qu’a Barthes du haïku : poésie de la notation pure, essence même de la Notation[18].
Ce haïku sur la grenouille est en fait loin d’être une simple notation. Cette forme poétique, appelée à l’époque haïkai, est née des transformations successives d’une forme qui remonte au viiie siècle, et qui n’a pas connu de rupture sur le plan fondamental de sa poétique. La codification s’accentue au cours de l’histoire. Comme l’illustre cette estampe de Hiroshige, la grenouille (kawazu) est de préférence associée aux

Corètes et grenouilles, Utagawa Hiroshige (1797-1858), Tokyo National Museum
fleurs de corète, à pétales d’or éclatant, et cela remonte à la première anthologie de la poésie japonaise (viiie siècle), le Man.yô-shû (Recueil des dix mille feuilles)[19]. D’un autre côté, l’essence poétique (hoi ou hon.i) de la grenouille, ce sont ses chants. On pouvait parfois, par souci de variété, associer les grenouilles avec d’autres éléments que la corète, mais la grenouille et son chant – en tant que sujet poétique – traversent l’histoire, inchangés jusqu’à Bashô. La grenouille chante, et cela depuis le premier recueil poétique du Japon. Bashô fait disparaître ce chant millénaire et fait entendre à sa place un bruit d’eau. Le changement est certes ténu, mais la secousse que ce haïku a provoquée fut suffisamment forte à l’époque pour le rendre tout de suite célèbre. Un haïku qui nous parle, qui produit une résonance en nous, est autre chose qu’une simple notation.
Le réel et le retour du souvenir
Dans L’Empire des signes, en parlant de ce qu’est le sens dans le haïku, Barthes dit : « Le sens n’y est qu’un flash, une griffure de lumière », et il enchaîne par une citation de Shakespeare : « When the light of sens goes out, but with a flash that has revealed the invisible world[20] ». Cette phrase rappelle un mot de Bashô : « Tâchez de fixer dans les vers, pendant qu’il demeure avant de disparaître, l’éclat des choses qui vous a touché[21] ». Dans ces deux phrases, on retrouve une conscience de l’urgence, plus précisément, de l’urgence de la situation d’écriture. Mais si Shakespeare parle de la lumière que l’homme projette vers l’extérieur, Bashô parle de la lumière qui émane de l’objet. Selon lui, la tâche du poète est de capter cette lumière et de la fixer dans le langage. Si la visée est très proche, le rapport avec le monde est envisagé de façon inverse, l’un posant le « je », le sujet, au départ du processus, tandis que, pour l’autre, c’est au sein de l’objet que le mouvement démarre. Barthes reprend le processus décrit par Shakespeare, qui va du sujet vers le monde, en mettant dans la case du sujet un enfant qui répète un geste de pure désignation, faisant disparaître le monde en même temps que le sens. Ainsi, dans les propos de Barthes sur le haïku dans L’Empire des signes, c’est le « je » hypertrophié qui part au combat contre le langage, contre l’Occident. Cependant, à mesure qu’on avance dans le cours sur le haïku, l’approche du monde change, le processus s’inverse, et le discours se rapproche sensiblement des mots de Bashô : à la place du geste ostentatoire de l’enfant qui désigne un monde en fait absent (figure symbolique de l’arrêt du langage), Barthes parle du processus qui s’enclenche du côté du monde où le sujet « moi » se présente comme le récepteur. Parlant du haïku comme poésie de l’instant, il dit : « C’est une sorte de sonnerie, de son de cloche très bref, unique et cristallin qui dit : je viens d’être touché par quelque chose. Voilà ce que ça veut dire, le haïku[22]. »
Ce retour du monde est étroitement lié avec la question du souvenir. À propos d’un haïku de Buson :
La rivière d’été / Passée à gué quel bonheur / Savates à la main[23],
Barthes dit qu’il a la certitude d’avoir vécu cette scène, et il continue : « Le haïku, si je développe cette certitude, serait produit par l’éblouissement d’une “mémoire personnelle involontaire[24]” ». Et la semaine suivante, citant le haïku :
L’enfant / Promène le chien / Sous la lune d’été[25],
il dit :
Il y a ici une sorte de « sel » de la contingence, en ce sens que personnellement je ne peux pas douter que cet enfant ait existé. Je suis sûr que cet enfant a existé. Et je vois par là que le haïku, pour moi, n’est pas fictionnel, il n’invente pas, il dispose en lui, par une chimie spécifique de la forme brève, la certitude que ça a eu lieu[26].
Cette compréhension du haïku, poésie sur le retour de souvenir, ou du témoignage au sujet de la réalité conduit Barthes à le ranger du côté de l’écriture autobiographique, plus précisément du journal. Pour lui, le haïku serait une écriture de pure contingence, représentative de la forme de l’Album, une écriture sans armature. À cette forme s’oppose le Livre qu’il définit en se référant à Mallarmé, comme une écriture architecturale et préméditée[27]. Si cette description correspond bien à une partie de ce qu’est le haïku, en affirmant que « le haïku n’est pas fictionnel », Barthes rétrécit indûment le champ de cette poésie. Prenons par exemple le haïku de Buson ci-après :
Un chien aboie / Contre un colporteur / Pêchers en fleurs[28]
Barthes le cite pour illustrer une des caractéristiques de la notation pure, l’écriture de l’instant. Or il ne s’agit pas en fait d’un simple témoignage sur un instant, mais d’une composition qui joue sur l’intertextualité : les expressions « un chien qui aboie » et les « pêchers en fleur » renvoient à un texte classique chinois célèbre, La source aux fleurs de pêcher de Tao Yuanming (365-427) ; ce haïku s’ajoute à une série de pièces inspirées de ce texte classique, et il s’agit donc d’un poème qui se déploie dans la réalité littéraire. Nous trouvons un cas contraire vers la fin du propos de Barthes sur le haïku, lorsqu’il parle des cas limites qui ne correspondent pas à sa définition du haïku. Voici le poème composé également par Buson :
En bateau on regarde la lune / Pipe tombée à l’eau / Rivière peu profonde[29]
Barthes voit dans ce poème le début d’une narration : on a laissé tomber une pipe dans l’eau, mais la rivière n’est pas profonde, donc on peut la rattraper, etc. Mais on peut le lire comme un spectacle de l’individuation de la nuit, en ne nous intéressant qu’à la lumière éblouissante de la lune qui éclaire la pipe tombée dans l’eau. Nous nous dirons alors que l’eau est sans doute limpide, puisqu’on voit la pipe sous la clarté de lune, sans nous préoccuper de savoir si l’on parviendra à la récupérer ou pas. Ainsi, selon la culture littéraire ou la sensibilité, un haïku peut basculer du côté de la poésie qui ouvre sur la vérité de l’individuation ou d’un début de narration. On peut expliquer historiquement la part plus importante du premier groupe. Le haïku, appelé hokku à l’époque de Bashô, était le premier vers qui ouvrait une séance collective de composition en 36 vers, appelée kasen, la forme la plus couramment pratiquée à son époque. C’était le seul vers qui avait un ancrage dans les circonstances de la composition, d’où l’obligation de l’emploi d’un mot de saison lié au moment de la composition. Le deuxième vers, lui, était la réponse du maître de maison à la salutation que constituait le premier vers, présenté par l’invité d’honneur. Au-delà, à partir du troisième vers, on entrait dans un monde imaginaire, chaque vers étant composé en fonction de celui qui venait d’être achevé et présenté. Cependant, comme on commença assez tôt à composer des haïkus sans lien avec une séance collective, nous avons des haïkus possédant une dimension narrative, comme le reconnaît Barthes lui-même.
La vision de Barthes sur le haïku ne vient donc pas tant de cette forme poétique elle-même, que de son besoin d’une écriture nouvelle. Au début de la première année, il dit : « Le roman vient d’une déformation de la mémoire[30]. » Et à propos du haïku sur le chien qui aboie, cité ci-dessus, il dit qu’au contraire de La Recherche de Proust, il s’agit de : « trouver (et non pas de retrouver) le Temps tout de suite et sur le champ ; le temps est sauvé tout de suite comme s’il y avait concomitance de la note (de l’écriture) et de l’incitation ». Et il ajoute que, s’il arrive à publier ce cours (niant tout de suite cette possibilité), le titre en pourrait être « Demain, le souvenir ». Rappelons que le cours fut donné après la mort de sa mère, dans une période qu’il conçoit comme la « dernière case » de sa vie[31]. En parlant de la valeur du « temps qu’il fait », il dit :
Disons que des affections absolues, dont la défection, par la mort, accomplit un déchirement atroce, peuvent ainsi et ont pu se mouvoir, vivre, respirer dans l’insignifiance douce des propos : le temps-qu’il-fait, dans ces cas-là, loin d’être une forme banalisée d’interlocution, exprime au contraire une sorte d’en deçà du langage (du discours) qui est, en fait, l’enjeu même de toute relation affective. Je pense à la douleur qu’il y a à ne plus pouvoir jamais parler du temps-qu’il-fait avec l’être aimé s’il a disparu. Par exemple, voir la première neige dans l’année et ne pas pouvoir lui dire : « Voilà la première neige », tout simplement, et être obligé de garder cette neige pour soi[32].
Dans son cours, il qualifie le haïku de propédeutique, de cours préparatoire qu’on suit avant d’aller aux études approfondies. L’année consacrée au haïku constitue une étape préliminaire au cours de laquelle il pacifie son rapport avec le langage à travers une écriture du quotidien, c’est ainsi qu’il qualifie le haïku, capable de traiter la chose la plus commune, la vie quotidienne telle quelle, sans la déformer, sans l’alourdir avec des approches doxales pour passer « de la vie à l’œuvre ».
Question de l’autre
La deuxième question de fond que soulèvent les propos de Barthes sur le haïku concerne le rapport à autrui qui s’avère être un problème crucial pour lui dans sa praxis de l’écriture. Ce problème apparaît d’une manière brutale dans la présentation de l’évolution historique du haïku. L’explication est confuse et fantaisiste, mais la conclusion qu’il en tire est extrêmement intéressante pour comprendre l’écrivain qu’était Barthes. Il évoque le détachement du premier vers de la chaîne de la composition collective :
ce qui est tombé dans l’évolution du poème, c’est le jeu à deux, c’est le dialogue qui est tombé ; et ce qu’on a gardé, dans le haïku, c’est la notation individuelle, solipsiste […]. Autrement dit, […] l’autre (l’interlocuteur) qui avait une fonction polémique, celui-là a été éliminé. Et par là même, le poème a perdu tout fonctionnement de combat, agonistique […]. Et on pourrait dire, en forçant à peine les choses, que le haïku est venu d’un mouvement d’égotisme : on a renvoyé les autres partenaires qui, finalement, gênaient le Narcisse, et on a joué tout seul. On a arrêté la chaîne (renga) : dès que je passe dans l’énonciation, on fait un nœud avant que tu ne s’en mêle ; et ça fait un haïku. On a isolé le sujet, on a aboli le conflit, la compétition et on a donc pacifié l’égo, qui dans le haïku se retrouve seul et voluptueux au milieu de la création[33].
D’abord quelques précisions s’imposent. La poésie en chaîne ou renga, qui s’épanouit durant la période médiévale, entre les xive et xvie siècles, puis dans une version plus libre appelée haïkai, qui se développe à la fin de cette période, est réalisée en chaînes où alternent des vers de 17 syllabes et de 14 syllabes[34]. Cette forme est le résultat de la scission en deux d’un poème waka, comprenant 31 syllabes. La séance réunit généralement entre trois et sept personnes et ne se présente pas forcément sous forme d’un dialogue poétique. Tour à tour, chaque participant improvise un vers qui s’enchaîne au vers venant d’être présenté et s’ajoute à la chaîne ainsi constituée. Il s’agit d’une poésie entièrement consacrée à la représentation de la diversité du monde, qui à ce titre privilégie une progression variée et mouvementée. Au départ, on la pratiquait en tant que jeu de société, avec des récompenses. D’où son caractère de compétition. Mais on développe assez rapidement des compositions collectives pour le seul plaisir littéraire. Et ces deux modes de composition coexistent ; des éléments de compétition subsistent dans le haïku, qui éclipse la poésie en chaîne à l’époque moderne. Shiki, le poète déjà cité plus haut, en parle. Le raisonnement que tient Barthes ne correspond donc pas à la réalité de cette poésie. Il nous dit, en revanche, combien les autres étaient une source de souffrance et d’ennui pour lui. Ne pouvoir envisager une composition collective autrement qu’en terme de combat et de conflit est en soi symptomatique. Pour citer un exemple du contraire, dans une jam session de jazz, les musiciens concourent pour créer une musique en se répondant avec leurs sensibilités différentes les unes des autres, sans esprit de compétition, ni de lutte. On a besoin des autres pour se dépasser. Les meilleures séances de renga ou de haïkai ne se produisent pas autrement. Bashô dit qu’il ne serait pas si difficile de trouver des poètes qui composent des haïkus meilleurs que les siens. En revanche, il se dit fier de sa capacité à animer des séances de haïkai, une qualité qui est essentielle dans cette poésie[35]. Bashô est en effet un chef d’orchestre incomparable, qui débloque les impasses, suggère des perspectives nouvelles, propose les vers les plus variés. Le plaisir que les participants éprouvaient avec lui transparaît dans l’enchaînement des vers créés en sa présence.
Les propos de Barthes dans son cours nous proposent une image à l’opposé du bonheur de la création collective. On est frappé par la violence des expressions qu’il utilise dans le passage que je viens de citer : « l’autre qui avait une fonction polémique […] a été éliminé[36] » ; « fonctionnement de combat, agonistique », etc.… D’autres passages y font écho. À propos de la pratique de notation, il dit : « Mes notations, ce seraient les (très petites) nouvelles qui me sont, à moi, sensationnelles et que je veux « rafler » à même la vie[37].». Et ceci : « on ne peut pas écrire sans rivalité, sans compétition[38] ». Et encore ceci, qui est extrêmement violent :
Ecrire n’est pas sage en ceci que c’est se remettre entièrement et complètement au regard […] de l’Autre […]. Je suis objectivé exactement comme un papillon qui est piqué […] par conséquent il [l’autre] me met exactement dans la position du mort. Ecrire et accepter d’écrire, vouloir écrire, c’est accepter à un certain moment d’être dans la position du mort[39].
En se référant à la pensée de Sartre, il dit à propos de cet « Autre » qu’implique son activité d’écrivain : « Autrui c’est qui ou ce qui, plutôt, ignore ma subjectivité, le sujet que je suis, et donc ignore ma liberté[40] ». La liberté signifie ici le différentiel qui se produit entre l’écriture achevée qui s’expose au regard de l’Autre et ce qui est en moi à l’état latent, «le Moi Idéal » selon sa propre expression, qui m’incite à me remettre à une nouvelle écriture[41].
Emmanuel Lozerand a signalé à juste titre combien sont insistants les éléments de violence dans L’Empire des signes et il les a resitués dans le discours sur le barbare caractéristique du discours orientaliste depuis l’âge classique. En relisant ce cours, je me suis demandé si cette violence ne proviendrait pas en fin de compte du rapport extrêmement conflictuel qu’il envisage avec les autres, comme nous l’avons vu à propos du désir du neutre.
Vers le roman
De L’Empire des signes à La Préparation du roman Barthes a évolué. Le point qui nous paraît le plus significatif est sa vision du processus de la création. Cette vision s’est inversée : de L’Empire à La Préparation il a déplacé, nous l’avons vu, le point de départ, du « sujet qui désigne » à l’« objet dans le monde », et il s’est rapproché de la vision proposée par Bashô. La citation de Joyce qu’il fait à la fin de la première année, dans la partie qui traite du passage de la vie à l’œuvre résonne comme étonnamment proche de ce qu’a dit Bashô. Voici la citation :
la « soudaine révélation de la quiddité (en anglais whatness) d’une chose ». Il n’est pas besoin de souligner la parenté avec le haïku, car au fond la quiddité c’est presque ce que j’ai appelé le « C’est ça », le tilt du « C’est ça » […][42]. Pour Joyce, donc, […] « moment où l’âme de l’objet le plus commun nous paraît s’irradier[43] ».
De l’appareil photo sans pellicule de L’Empire des signes à la lumière des choses qui irradie de l’intérieur de La Préparation du roman, nous pouvons qualifier ce cheminement comme un retour du Monde, « un ciel voilé, mais très haut, immensément haut, où flottent doucement des nuages gris » que découvre le prince André dans Guerre et paix[44], le garçon qui promène le chien sous la lune, le son de cloche très bref, unique et cristallin…
Dans le cours de la deuxième année, qu’il a intitulé « L’œuvre comme volonté », il présente le roman comme une écriture qui dépasse les limites qui sont selon lui celles du haïku. Ainsi dit-il :
créer l’Autre […], c’est le rôle du Roman. […] D’où le souhait – et la décision, […] de mettre le Roman en Projet, étant entendu que j’appelle Roman, non pas tel genre historiquement déterminé, mais toute œuvre où il y a transcendance de l’égotisme, non vers l’arrogance de la généralité, par exemple la science ou l’essai ou la critique, mais vers la sympathie avec l’autre, sympathie en quelque sorte mimétique[45].
L’Autre dont parle Barthes ici n’est pas cet Autre réduit à un regard qui porte un jugement sur ses écrits, mais un sujet singulier comme lui, doté d’une réalité sensible, même s’il s’agit d’une figure de fiction. Il dit à ce propos : « je ne peux pas être satisfait du témoignage que je me porte si je ne l’étends pas aux autres, car que puis-je valoir si je ne rends pas justice aux autres ? ». Il précise plus loin, que le mot « Compassion », donné par Rousseau comme le fondement de la sociabilité humaine[46], représente le mieux cette idée.
Cependant Barthes ne parvient pas à intégrer la dimension de l’autre dans son écriture. Nous avons constaté deux déformations majeures dans les propos de Barthes sur le haïku dans son cours au Collège de France : la première concerne la dimension romanesque, qu’il dénie au haïku, et la seconde l’exclusion des autres de la sphère du poème. Or ces deux points, la fiction et la place des autres, sont des questions centrales dans son projet de préparation du roman, qu’il présente avec prudence comme une simulation, et ils constituent les principaux éléments de blocage dont il parle de plus en plus fréquemment.
Barthes cherche à dépasser l’écriture fragmentaire, sans pouvoir créer une armature. Au début du cours sur le haïku il se confie sur son sentiment d’urgence[47], et au moment où il termine La Préparation du roman il est toujours à la recherche d’une nouvelle écriture. Il avoue ne pas avoir l’imagination fabulatrice[48] qui lui permettrait de concevoir l’avant et l’après des fragments, pour les relier et pour faire avancer son projet d’écriture dont il parle en termes de Vita Nova. En fait, cette situation de blocage est d’abord liée avec l’égotisme qu’il a exalté dans le haïku en parlant de la « mémoire immédiate ». Il dit, nous l’avons vu, que cette mémoire « ne prolifère pas et reste sur elle-même », qu’elle est donc incapable de créer une suite narrative à la différence de la mémoire involontaire de Proust. Mais le blocage semble être lié plus profondément à sa prise de position ambivalente vis-à-vis d’une question plus fondamentale du langage ou du sens, la structure paradigmatique. D’une part, Barthes s’en sert à fond, comme on peut le constater dans ses démarches argumentaires. Il dit en parlant du travail qui constitue l’écrivain : « une soumission lucide à la persistance du langage, […] pour faire travailler les mots, il nous faut, comme toujours, les mettre en paradigme[49]. » Mais, en même temps, il combat le système paradigmatique au nom de l’écriture neutre. Car ce système générateur du sens opère selon une logique d’opposition, selon un rapport d’exclusion mutuelle des mots. En ce sens, le mécanisme de cet outil de réflexion barthésien est à l’opposé de l’idée du neutre qu’il associe étroitement à sa vision de l’utopie du langage : le neutre, selon lui, n’opère pas par une opposition des termes, mais par le degré d’intensité et un jeu de différences subtiles[50].
Le problème auquel est confronté Barthes apparaît avec netteté quand on le situe dans l’évolution des recherches linguistiques. La notion de paradigme était surtout utilisée au départ en tant qu’outil de distinction par l’opposition, comme cela est illustré sans ambiguïté dans la notion de « paire minimale ». Antoine Culioli, tout en reconnaissant une caractéristique importante et utile du structuralisme, ne conçoit pas comme valable de « travailler en tout ou rien. Et de ramener les concepts de différenciation à finalement la négation de la propriété préliminaire : blanc / pas blanc, signifiant uniquement noir ». Il propose de considérer l’acte d’énonciation comme un processus qui construit la frontière avec des opérateurs comme « vraiment », « pas vraiment », « presque »… et explique que, entre, par exemple, crû et cuit, on a « un gradient avec des attracteurs vers crû / cuit de moins en moins crû et de plus en plus cuit[51] ». L’explication de Culioli est en fait très proche de ce que dit Barthes sur le neutre à propos du mode de différenciation. Mais ce dernier semble être toujours prisonnier d’une conception dichotomique, qui ne propose qu’une vision fragmentaire du sens. Nous avons vu que l’année précédant le cours sur le haïku Barthes s’est consacré, au Collège de France, au thème du « neutre ». Dans une des séances, il dit en parlant de la conscience hyperesthésiée :
Le sujet que je suis est comme une partition de musique, c’est-à-dire, une grande surface, un grand papier avec des portées musicales, les unes au-dessus des autres, et chaque partie dans cette partition que je suis […] est indépendante, claire, vive, chantée et entendue vivement. Mais il n’y a en moi au-dessus de moi, aucun moi pour lire l’ensemble verticalement et harmoniquement. […] Je ne suis pas le chef d’orchestre de ma propre partition[52].
Il reprend cette thématique de l’incapacité à créer un rapport de résonance dans son cours sur le haïku :
Au fond, ce qu’il y a de très difficile aujourd’hui, c’est de tenir un discours vrai, […] un discours qui reproduise clairement les différentes voix dont est fait un sujet […]. C’est un problème pour moi très aigu dans la mesure où je voudrais écrire des textes qui fassent entendre la pluralité, la diversité des sujets qui sont en moi, mais […] je n’arrive pas à bien faire entendre, et finalement je produis […] un discours unitaire[53].
Mais, en même temps, le désir de l’utopie ne le lâche pas et il semble le conduire à des analyses paradigmatiques d’opposition d’autant plus poussée, comme si pour justifier l’irréalisable qu’est l’utopie, Barthes avait besoin de passer en revue tout ce qui concerne l’écriture neutre.
À la dernière séance sur le « neutre » qui eut lieu en juin 1978, il annonça que le thème du prochain cours serait le haïku en précisant qu’il s’agissait d’une autre forme d’écriture du neutre[54]. Comme nous l’avons vu, il a situé le haïku au stade propédeutique. Il a parlé du besoin de dépasser l’écriture rhapsodique, de sortir de la forme de l’album. Avait-il besoin, pour s’avancer dans une nouvelle écriture, d’une armature qui aurait une résistance suffisante pour contrebalancer le vide avec lequel il se débattait depuis quelques années ? Après ce cycle qui s’est déroulé sous le signe du bonheur, son cours est entré dans un stade de stagnation. Mais il n’a pas enterré pour autant l’idée d’écrire un roman, et il a continué à remanier le plan de Vita Nova.
À son dernier cours au Collège de France, il dit : « Eh bien, je dirais, ce sera le mot de la fin pour ce cours, qu’en un sens l’objet de mon désir d’œuvre, ça serait d’écrire une œuvre en Do Majeur[55] ». Une écriture simple, une écriture en quelque sorte propédeutique qui situe simplement mais clairement l’acte d’écrire dans le monde.
notes
-
Au chapitre intitulé « La littérature comme déception » dans le premier plan de Vita Nova (21/08/79), Barthes énumère, séparément, l’une après l’autre, quatre formes d’écriture : le déjà fait : l’Essai, le Fragment, le Journal et le Roman. Le lendemain, il remanie l’organisation en opposant le déjà fait : l’Essai, d’une part, et le Fragment, le Journal, le Roman, regroupés ensemble, de l’autre. Quelque temps après (30/09/79), quand il cherche à choisir une écriture dont l’objet « même du livre » est devenu la mutation de sa vie qui a suivi la mort de sa mère, il hésite entre le Journal (direct) et le « Roman » (indirect). Il envisage entretemps (03/09/79) le Roman romantique en le rattachant aux Fragments. (Roland Barthes Album, Paris, Seuil, 2015, p. XXXIII-XXXIV, XXXIX, LXI). Barthes désigne, en s’appuyant sur les écrits de Novalis, par roman romantique « un mélange des genres, en l’absence de toute hiérarchie ou de tout découpage. » (La Préparation du roman : Cours au Collège de France 1978-79 et 1979-80, Paris, Seuil, 2015, p. 268 [08/12/79]). ↑
-
Il parle d’« une sorte de conversion à la littérature » qu’il a vécue le 15 avril 1978 (Préparation du roman, op. cit., p. 25-27 [02/12/78]). Notons que c’est au jour anniversaire, le 15 avril 1979, où il a commencé à travailler sur La Chambre claire. ↑
-
Roland Barthes, Le Neutre : cours au Collège de France 1977-78, Paris, Seuil, 2002, livre audio (21h), 1er cours (18/02/78). ↑
-
Ibid. ↑
-
ibid. ↑
-
OC III [« L’L’effet du réel », Communications, n° 11, mars 1968], p. 25-32. ↑
-
Le haïku pose la question de la double lecture : lecture des pièces en tant que telles, isolées les unes des autres, et lecture qui tient compte de la place de chaque pièce parmi les autres et leur organisation dans des recueils. Se pose également la question de l’effet qu’engendrent l’association du haïku avec de brèves notations en prose ou sa combinaison avec des peintures. Il s’agit globalement d’opérations combinatoires dont l’enjeu ne recoupe pas directement le discours de Barthes. ↑
-
La Préparation du roman, op. cit., p. 120 (27/01/79). ↑
-
Ibid, p. 114. ↑
-
Ibid, p. 182 (24/02/79). ↑
-
OC V [La Chambre claire, 1980], p. 791. ↑
-
Ibid, p. 796. ↑
-
Ibid, p. 854. ↑
-
Bernard Comment, roland barthes, vers le neutre, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1991, p. 126-127. ↑
-
Masaoka Shiki (1867-1902), poète et essayiste, qui a initié le mouvement de renouveau de la poésie japonaise (haiku et waka). Sur ce poète, voir Emmanuel Lozerand, « Repères biographiques, Masaoka Shiki (1867-1902) », in Masaoka Shiki, Un lit de malade six pieds de long, trad. E. Lozerand, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 311-330. ↑
-
Furuike ya / Kawazu tobikomu / Mizu no oto ; La Préparation du roman, op. cit., p. 144 (10/02/79). ↑
-
Masaoka Shiki, Principes du haïkai (Haïkai taiyô), 1895, coll. « Iwanami bunko », Iwanami shoten, 1984 (1re édition, 1955), p. 22. ↑
-
La Préparation du roman, op. cit., p. 49 (16/12/1978). ↑
-
Voici l’un des poèmes de ce recueil qui concentre la subjectivité dans le suffixe modal de conjecture « –ramu ».
« À la rivière Kamunabi / Où chantent les grenouilles / Ecloront-elles maintenant / Les fleurs de corètes / Reflétant leur image sur l’eau ? (Kawazu naku / Kaminabi-gawa ni / Kage miete / Imaya sakuramu / Yamabuki no hana : Livre « Les poèmes divers du printemps »). ↑
-
OC III [L’Empire des signes, 1970], p. 415. ↑
-
Mono no mietaru hikari, imada kokoro ni kiezaru uchi ni iitomubeshi (Cahier rouge [Akazôshi], in Trois cahiers [Sanzôshi], Rengaron-shû Hairon-shû, coll. « Nihon koten bungaku taikei », Tôkyô, Iwanami shoten, 1961, p. 401). Ce propos de Bashô fut recueilli par un de ses disciples et publié au début du xviiie siècle. Sur la poétique de Bashô, voir Le Haïkai selon Bashô, trad. René Sieffert, Paris, POF, 1990. ↑
-
La Préparation du roman, op. cit., p. 113-114 (27/01/1979). La première phrase est une citation de Proust (signalée par Tiphaine Samoyault à l’occasion de la journée d’études, Roland Barthes : Empire des signes, empire du haïku qui a eu lieu le 8 juin 2017 à l’Inalco). ↑
-
Natsukawa o / Kosu ureshisa yo / Te ni zôri (trad. Maurice Coyaud), ibid., p. 96 (20/01/1979). ↑
-
Ibid., p. 96 (20/01/79). ↑
-
Shônen no / Inu hashirasu ya / Natsu no tsuki (trad. Roger Munier), haïku d’un disciple de Buson, XVIIIe siècle, ibid., p 119 (27/01/79). ↑
-
Idem. ↑
-
Ibid., p. 350 (12/01/80). ↑
-
Akindo o / Hoyuru inu ari / Momo no hana (trad. M. Coyaud), ibid., p. 113 (27/01/1979). ↑
-
Tsukimibune / Kiseru o otosu / Asase kana (trad. M. Coyaud), Ibid., p. 190 (24/02/1979). ↑
-
Ibid., p. 44 (09/12/78). ↑
-
OC V [« Longtemps, je me suis couché de bonne heure », conférence au Collège de France (1978) reprise dans Le bruissement de la langue (1984)], p. 467. Ici il situe son projet de Vita Nova à partir d’une conscience qu’il présente de la manière suivante : « tout d’un coup on se sent mortel […] il me faut, impérieusement, loger mon travail dans une case aux contours incertains, mais dont je sais (conscience nouvelle) qu’ils sont finis : la dernière case. ↑
-
La préparation du roman, p. 93, (20/01/79). ↑
-
Ibid., p. 145-146 (10/02/79). ↑
-
Plus exactement « mores », unités rythmiques qui comptabilisent comme une mesure des séquences difficilement dissociables des unités de sons qui les précèdent, mais qui produisent des volumes sonores identifiables sur le plan phonologique : ex. la partie de l’allongement d’une voyelle, l’arrêt du souffle entre une voyelle et une consonne. ↑
-
La parole de Bashô cité dans le Cahier noir (Kuro zôshi), in Trois cahiers, op. cit., p. 432. ↑
-
Dans ce paragraphe, nous avons mis en italique les mots concernés. ↑
-
La préparation du roman, p. 197 (03/03/79). ↑
-
Ibid., p. 294 (08/12/79). ↑
-
Ibid., p. 309 (15/12/79). ↑
-
Idem. ↑
-
Ibid., p. 301-309 (15/12/79). ↑
-
Barthes cite ici la définition de la quiddité dans le Larousse illustré : « l’ensemble des conditions qui déterminent un être en particulier ». ↑
-
La préparation du roman, p. 216 (10/03/79). ↑
-
Le Neutre, op. cit. 1er cours (18/02/78). Barthes lit au début du cours la scène de l’évanouissement du prince dans Guerre et Paix. Le passage fait partie des quatre textes qu’il a choisis comme épigraphes de son cours sur le neutre. ↑
-
La préparation du roman, p. 307, (15/12/79). ↑
-
Idem. Je renvoie à la note de cette page. ↑
-
Ibid., p. 15-17, (02/12/78). ↑
-
Ibid., p. 363 (12/01/80). ↑
-
Le Neutre, op. cit., 11e cours (20/05/78). ↑
-
Ibid., 4e cours (11/03/78). ↑
-
Antoine Culioli, Variations sur la linguistique, Klincksieck, 2002, p. 217-218. ↑
-
Le Neutre, op. cit., 7e cours (01/04/78). ↑
-
La Préparation du roman, p. 106 (20/01/79). ↑
-
Le Neutre, op. cit., 13e cours (03/06/78). ↑
-
La Préparation du roman, op. cit., p. 556 (23/02/80). ↑