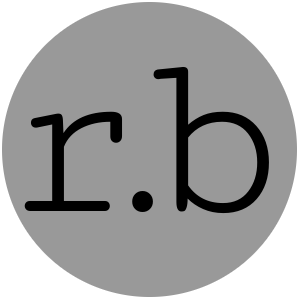Dans sa nouvelle Sarrasine, Balzac, parlant d’un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase : « C’était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiments. » Qui parle ainsi ? (« La Mort de l’auteur », III, p. 40)
La démarche biographique est une démarche de compréhension : saisie intellectuelle et totalité, connaissance compréhensive (selon la définition du TLF, « Qualité, attitude d’une personne compréhensive, capable de saisir la nature profonde d’autrui dans une communion affective, spirituelle allant parfois jusqu’à une très indulgente complicité »). Certains points résistent pourtant à toutes ces formes de compréhension, ce qui est le cas avec Barthes de la peur. La peur est peut-être même l’incompris de la biographie. Peur de l’incompris, peur subjective d’échapper quelque chose, de le laisser échapper, voire d’échapper ou de laisser échapper tout ; peur de ne pas être comprise dans la compréhension. C’est aussi la peur objective, la peur en tant que ce qui, précisément, n’est pas compris. L’insistance de Barthes sur la peur reste ce qui se dérobe à ma compréhension après que j’ai travaillé plusieurs années sur lui et surtout après que j’ai écrit sur lui : car certaines choses qui n’étaient pas comprises au départ – la nature exacte de l’amour filial ou la puissance active du neutre, pour ne prendre que deux exemples, de nature très différente –, l’ont été dans l’après-coup, dans l’écriture et sa façon de libérer et de révéler en nouant les termes d’une manière particulière. Certaines choses, mais pas la peur, qui a continué à se dérober à la compréhension, même dans l’écriture et c’est cette peur comme objet qui me retient ici, la peur de Barthes ou la peur chez Barthes. Mon retard, ou ma lenteur, dans la compréhension de ce problème rejoint déjà une des peurs de Barthes, énoncée dans le cours sur le Neutre, qui est la peur de ceux qui sont rapides à la comprenette. C’est lors de la séance sur le sommeil, où il cite une phrase de Gide sur la lenteur qu’il met à se réveiller et à comprendre, qu’illustre ensuite une réflexion des Cahiers de la Petite Dame (1950, 242) : « Le plus souvent il comprend avec un grand retardement. » Le commentaire de Barthes est le suivant : « Le retard à comprendre : ne pas le mettre dédaigneusement au compte de la déchéance physique, comme si c’était “bien” et “normal” de comprendre vite, tout de suite → peut-être : temps pour comprendre, sorte de temps divin : passage juste (délicat, lent, bienveillant) d’une logique à l’autre, d’un corps à l’autre. Si je devais créer un dieu, je le doterais d’une “comprenette lente” : sorte de goutte-à-goutte du problème. Les gens qui comprennent vite me font peur. » (Le Neutre, p. 67) Cette étrange fiction (« si je devais créer un dieu ») et cette non moins étrange supposition (« je le doterais d’une comprenette lente »), cette étrange hypothèse d’une religion sans peur est sans doute une clé ouvrant une des portes de l’explication [1].
La peur de quelque chose [2]
Il y a des peurs et il y a la peur. Il y a la peur de quelque chose, qui est multiple, variable et répétée, qui se dit au pluriel et il y a la peur sans objet, qui se dit au singulier. Dans le premier registre, qui reste de l’ordre de la compréhension, de quoi Barthes a t-il peur ?
Barthes a peur :
- de la répétition (Lexique de l’auteur, p. 288)
- de relire ses livres (Lexique de l’auteur, p. 101, 264)
- de ne pouvoir échapper aux stéréotypes (V, p. 546)
- de l’aphasie (V, p. 546)
- de n’avoir plus rien à dire (V, p. 546)
- de dire vieux (V, p. 383)
- de dire faux (V, p. 383)
- de dire bête (V, p. 383)
Barthes a peur :
- de la jalousie (V, p. 59)
- d’être jaloux (V, p. 59)
- de la délibération (V, p. 59)
- des rumeurs (V., p. 627)
- de la scène (IV, p. 732)
- du théâtre (IV, p. 901)
- des fuites de la subjectivité (IV, p. 738)
- d’être déplacé (IV, p. 752)
- d’être seul (V, p. 383)
Barthes a peur :
- de [sa] propre destruction (V, p. 248)
- de mourir (II, p. 278)
- du langage (IV, p. 690
- de [son] langage (V, p. 648)
- du mot (Lexique de l’auteur, p. 130)
Barthes a des peurs nocturnes (IV, p. 690)
Barthes a peur :
- d’écrire (IV, p. 249, Préparation du roman, p. 24)
On le voit, les peurs sont liées au rapport du sujet à son corps, à son langage, au fait de ne pouvoir toujours les habiter entièrement ou de ne plus les habiter du tout (dans l’amour, la jalousie, la mort). Elles sont liées au manque (l’aphasie) ou à l’excès (la scène, le théâtre), au trop ou au trop peu. Elles sont en même temps une forme de régulation permettant de ne verser ni dans l’un ni dans l’autre. Elles évitent de tomber dans ce qui serait l’inverse de la peur, ce qui se signale par l’absence de peur : le système, la certitude, le stéréotype, la bêtise. Ce qui est récupéré par la culture ne fait pas peur. Ces peurs sont qualifiables, qu’elles soient sociales ou métaphysiques, on peut les caractériser, les renvoyer à d’autres ; elles dessinent le territoire des névroses. Il y a des antidotes à ces peurs. Certains d’entre eux ne peuvent être d’aucun secours dans la mesure où ils constituent des repoussoirs, des solutions impossibles : ainsi de la bêtise qui offre un certain confort mais assorti de vulgarité ; bien sûr, au commencement, en révélant une différence, elle présente un certain pouvoir de fascination [3] ; mais très vite, sa vocation de Sirène s’éteint et ne reste qu’une forme de confort bourgeois ou, en d’autres termes, une place de père douillettement occupée : « une voix [qui] vient plutôt à la place du Père qui m’a manqué ; c’est comme si je découvrais avec effroi, en le retrouvant, un Père vulgaire [4]… ». L’euphorie de la bonne place, où le négatif glisse comme sur une vitre, est le don de la bêtise qu’il devient impossible de contredire. Comme le dit Barthes dans la discussion qui suit l’intervention de Françoise Gaillard à Cerisy précisément intitulée « Qui a peur de la bêtise ? », « la seule preuve que nous puissions nous donner que nous ne sommes pas bêtes, c’est d’avoir peur de la bêtise. C’est la seule preuve qui soit à notre disposition, et encore elle n’est pas suffisante [5]. » Ainsi, la bêtise serait l’antidote à ma peur, mais comme j’ai peur de la bêtise, il m’est impossible de soigner le mal par le mal. Il faut aller chercher ailleurs le remède, dans des formes élevées de dépassement de l’intelligence (dont la bêtise serait la forme basse). La sortie du système institue le dépassement, mais là encore, comme elle est abandon de la protection, elle implique l’entrée dans la peur. Pourtant cette peur peut être transformée et Barthes insiste alors sur le rôle de Nietzsche qui intervient comme « entraîneur » dans cette opération : « il transforme la peur, il accentue, par l’exemple même de son écriture, la jubilation d’écrire [6]. » Nietzsche est « ensemenceur d’écriture », « supplément », puissance de jeu. Parce qu’il interdit d’être nietzschéen en ne proposant pas de système, Nietzsche a un rôle idéal qui est « de nous permettre de jouer contre les systèmes tout faits. » Plus qu’un antidote à proprement parler, il est un adjuvant dans la peur, il permet d’en faire quelque chose.
Pourtant, même si ces peurs de quelque chose sont caractérisables, compréhensibles et, dans une certaine mesure, dépassables, elles peuvent être distinguées. Il y a celles qui sont récupérables, par le comportement ou par le jeu – par exemple la peur de relire ses livres, la peur d’être jaloux, la peur du stéréotype (qui est sans doute celle qui offre la plus grande part de jeu possible) ou la peur de la scène – quand d’autres peurs (la peur d’écrire ou la peur de la mort) confrontent à la grande peur, à la peur sans objet dont je vais traiter maintenant.
La peur sans objet
Si la peur est un sujet c’est qu’elle est parfois sans objet. Elle n’est plus peur de quelque chose mais peur tout court et c’est à ce moment-là qu’elle se dérobe à la saisie, à la compréhension. Et c’est aussi parce qu’elle confronte le sujet à l’incompréhension radicale qu’elle expose le sujet qui l’éprouve à ne plus être compris. Partons d’un petit détail, qui a presque l’air d’une coïncidence : la discussion suivant l’intervention de Françoise Gaillard a Cerisy sur la bêtise, dont il a été question plus haut, se clôt par un portrait de Barthes en torero par Antoine Compagnon, auquel Barthes, pour conclure, donne ce trait distinctif : « En tout cas un torero qui serait mort de peur chaque fois. » Et il ajoute, « c’est peut-être le cas des toreros [7]… » Or sa propre intervention au colloque suit directement celle de Françoise Gaillard (le lendemain matin) et elle s’ouvre sur le passage à la majuscule, la Peur. De la peur devant le taureau, qui est à la fois une peur de l’animalité, une peur de l’altérité massive et combattante, qui est encore la peur de quelque chose (même si elle se rapproche sans doute de la corne du taureau), on est passé à la peur majuscule, qui ne peut tenter de se saisir que par conjectures, où s’exprime un lien qu’il est impossible de couper, un cercle dont il n’est pas possible de sortir. On peut faire table rase de tout, mais on retrouvera la peur qui est à l’origine et que tout le reste avait permis illusoirement d’apaiser.
« À l’origine de tout, la Peur. (De quoi ? Des coups, des humiliations ?) Parodie du Cogito, comme instant fictif où, tout ayant été rasé, cette tabula rasa va être réoccupée : “J’ai peur, donc je vis.” Une remarque : selon les mœurs d’aujourd’hui (il faudrait une éthologie des intellectuels), on ne parle jamais de la peur : elle est forclose du discours, et même de l’écriture (pourrait-il y avoir une écriture de la peur ?). Placée à l’origine, elle a une valeur de méthode ; d’elle, part un chemin initiatique [8]. »
Plusieurs remarques :
- À l’orée de son intervention au colloque dont il est le sujet, ce paragraphe peut être entendu comme un métadiscours ; une forme de captatio où Barthes dit : j’ai peur de prendre la parole, j’ai peur d’être là devant vous, j’ai peur de l’image que je vais donner (en parlant de l’image), j’ai peur des images que vous donnez de moi (il reviendra sur ce point dans les conclusions). L’origine est donc aussi l’origine du discours. Ce n’est peut-être pas la façon dont on entend la première occurrence (« À l’origine de tout, la Peur »), mais c’est certainement aussi la façon dont on entend la seconde (« Placée à l’origine, elle a une valeur de méthode»). Comment comprendre cette méthode ? Sans doute comme une conscience aiguë du semblant. Le risque de prendre la parole n’a d’égale que la conscience que cette parole fera retrouver le risque à l’autre bord. La peur n’a pas de remèdes.
- C’est un motif récurrent depuis Le Plaisir du texte que celui de la censure de la peur dans la culture et dans la société modernes. Dans le Plaisir du texte: « elle est le laissé-pour-compte de toutes les philosophies (seul, Hobbes, je crois : « la seule passion de ma vie a été la peur ») ; la folie n’en veut pas (sauf peut-être la folie démodée : Le Horla), et ceci interdit à la peur d’être moderne [9]. » Ou encore, dans un entretien de 1978 : « Les hommes ont de très grandes peurs. Il y a de grandes peurs de civilisation. Celles-là sont à peu près étudiées et approchées par les historiens mais le fond de peur qui est dans l’homme, le fond d’effroi, le fond de menace qui est dans tout homme subit une sorte de censure. Les hommes reconnaissent difficilement qu’ils ont peur, qu’ils sont dans un état permanent de peur [10]… » Cette censure de la peur, qui est à la fois une autocensure chez chacun et une grande censure collective n’est pas une invention de Barthes. Il y a un fond de rousseauisme dans la pensée qui préfère penser le lien que s’arrêter devant le vide de la coupure…
- « J’ai peur donc je vis » : la peur vient en naissant. Elle vient même, Barthes développe cette idée ailleurs, de la néoténie des êtres humains. Cette thèse, développée en particulier par l’anatomiste hollandais Louis Bolk dans le Problème de la genèse humaine [11] et reprise par Lacan dès les années 1930, connaît un grand développement dans les années 1960-1970, en particulier avec le livre de Desmond Morris traduit en français en 1968, Le Singe nu [12]. Cette idée d’un caractère néoténique au sens large de l’être humain caractérise celui-ci par un retard de développement, un caractère inachevé, qui le met dans un état d’intense fragilité initiale. Ce que Barthes souligne dans l’entretien déjà cité, en rattachant la peur à ce trait du développement anthropologique : « De tous les animaux, ce qui définit l’homme, c’est que c’est un animal qui naît immature, qui naît prématurément et il naît par conséquent en état d’insécurité totale. Le nourrisson qui vient de naître n’est protégé par absolument rien, au contraire de l’animal qui se protège très vite, qui naît déjà protégé. L’homme naît donc avant terme et c’est pour cela qu’il est fondamentalement dans un état de peur. De ce fait, évidemment, tout le développement de la société humaine vise à compenser cette peur native de l’homme. L’éducation, les rapports des parents ont un rôle de protection [13]… » Ainsi, le défaut de nature qui caractérise l’être humain implique un relais de la culture ou de la technique, capables eux aussi, comme le soin parental, d’apaiser et de réduire la peur. Or – et cela Barthes ne le sait peut-être pas, en tout cas il n’en dit rien, il se trouve que Hobbes attribue sa « passion de la peur » à sa prématurité. Sa naissance avant-terme n’est pas une image, elle n’est pas seulement la condition de tous les hommes. Le 5 avril 1588, il est bel et bien né prématuré, encore plus fragile à cause, dit-il, d’une grande peur de sa mère apprenant la nouvelle de l’arrivée de l’Armada espagnole. L’anecdote se trouve dans l’autobiographie en latin et en vers qu’il a traduite lui-même : The Life of Mr Thomas Hobbes of Malmesbury, written by Himself in a Latine Poem, and now translated into English (version latine 1672 version anglaise, 1679). Atque metum concepit tunc mea mater/ Ut pareret geminos meque metumque simul. Ce qui donne dans la traduction anglaise : « That she gave birth to two twins myself and fear. » Elle a donné naissance à deux jumeaux, la peur et moi, la peur et moi sommes nés jumeaux. Liée à la mère, la peur est aussi congénitale, gémellaire, même. La nouvelle était pourtant elle-même prématurée puisque l’Armada n’a pas été vue devant les côtes de l’Angleterre avant le 29 juin de cette année 1588. Mais il se trouve que c’est le récit que donne Hobbes pour expliquer sa passion de la peur et qu’il la situe bien « à l’Origine de tout ».
- Une dernière remarque : la valeur de méthode (en italiques) attribuée à la peur. En la reconnaissant comme nature, on se défendrait et des pièges de la nature et de ceux de la culture. De ceux de la nature en tant que celle-ci serait une identité ou une essence. Si la nature est coupure et vide, alors on ne peut pas en faire une qualité. De ceux de la culture qui sont des artifices censés nous guérir de cette peur mais qui nous laisseront aussi démunis devant la mort qu’on l’a été en naissant. Cette valeur de méthode est bien celle de la lucidité, qui fait voir la violence partout, à l’origine, au terme et dans les moyens élaborés pour la recouvrir ou s’en accommoder.
Quand apparaît cette obsession de la peur, cette idée qu’elle est à l’origine de tout et qu’il faut la prendre en compte en vivant, en écrivant ? On pourrait penser qu’elle apparaît au moment du Plaisir du texte, lorsque Hobbes devient une sorte d’accompagnant majeur. Il n’en est rien, ce que prouve une relecture de Sur Racine à l’occasion de cette enquête sur la peur. La scène tragique est bien un espace de la peur, espace de transition, de passage entre la peur expérimentée et la peur parlée. Un paragraphe de « L’homme racinien » s’intitule « la peur des signes » et préfigure le fragment du Roland Barthes par Roland Barthes sur « La peur du langage ». Dans la tragédie, le héros est enfermé et sa fermeture « est une peur, à la fois très profonde et très immédiate, entretenue à la surface même de la communication humaine : le héros vit dans un monde de signes il se sait concerné par eux, mais ces signes ne sont pas sûrs [14]. » Il suffit de s’arrêter sur une signification pour qu’elle soit aussitôt troublée ou démentie ; tout peut se révéler être un piège et l’ambiguïté peut même connaître un second degré ; bref, on est dans « l’enfer des significations ». Face aux signes, le héros tragique est pareil à l’homme moderne devant sa télévision qui se trouve face à un langage dont il est séparé et où soudain tout ce qui pouvait paraître rassurant se révèle en même temps soupçonnable ou frustrant (sécurité de la distance, illusion de la retraite) et, cette conclusion : « avoir peur de ce qu’on dit (indissociable de la manière dont on le dit) [15]. » Seuls ceux qui n’ont pas peur peuvent évoluer comme un poisson dans l’eau dans le langage. Sur Racine porte donc bien une réflexion intense sur la peur, qui doit autant au phobos aristotélicien qu’à la réflexion de la psychanalyse sur l’angoisse. C’est d’ailleurs parce qu’elle s’est instituée comme un langage « prêt à recueillir la peur du monde » que la psychanalyse est conviée au banquet [16]. Mais si elle est bien à ce titre un élément central de la poétique, elle n’est pas au départ d’une politique (c’est aussi le cas chez Aristote ou le phobos apparaît dans la Poétique, mais pas dans la Politique).
Le recours à Hobbes change la donne. J’ai cherché à savoir (réflexe de biographe) où Barthes avait prélevé la citation, s’il citait de première ou de seconde main. J’ai d’abord fait l’hypothèse de la seconde main en pensant qu’il l’avait peut-être trouvé chez Sartre, mais je n’ai rien découvert de tel (sans certitude bien entendu). Le fait qu’il cite Bataille dans le paragraphe sur la peur – Barthes cite en effet deux fois la phrase de Hobbes dans Le Plaisir du texte, en épigraphe et dans le développement sur la peur – m’a fait chercher la source chez Bataille, même si, dans l’autoportrait, il accole de façon très ambiguë le nom de Bataille à la peur tout en le refamiliarisant par la peur. C’est le fragment « Bataille, la peur » : « Bataille, en somme, me touche peu : qu’ai-je à faire avec le rire, la dévotion, la poésie, la violence ? Qu’ai-je à dire du “sacré”, de l’“impossible” ? Cependant, il suffit que je fasse coïncider tout ce langage (étranger) avec un trouble qui a nom chez moi la peur, pour que Bataille me reconquière : tout ce qu’il écrit, alors, me décrit : ça colle [17]. » L’opération de refamiliarisation par la peur est osée : la langue de Bataille lui est étrangère mais s’il la traduit, la pensée convient et adhère. C’est manifestement l’impossible que Barthes traduit par le mot peur et les deux notions, chez l’un et chez l’autre, ont bien avoir l’une avec l’autre. Il s’agit d’une déchirure et d’une puissance en même temps. Pourtant la peur fait aussi partie du vocabulaire de Bataille et si Barthes, dans l’autoportrait, choisit de l’oublier, il ne l’oublie probablement pas dans le passage sur la peur du Plaisir du texte. Le Coupable (1944) est un grand texte sur la peur, où le mot apparaît. « C’est la peur que je veux et que je recherche », écrit Bataille, « celle qui ouvre un glissement vertigineux, celle qui atteint l’illimité possible de la pensée [18] ». S’opposant à la pensée de système, il oppose la recherche de la vérité de la philosophie à la recherche de la peur. « L’anthropologie de Bataille, quant à elle, est une anthropologie de la peur, car la jointure des deux ordres qui définit en propre l’humain y est la peur. À la recherche philosophique de la vérité – c’est-à-dire à la science – Bataille oppose la recherche de la peur pour autant que la peur, ou plus précisément “j’ai peur” est une attitude qui s’éloigne, et qui doit donc être restaurée [19]. » L’idée d’une censure de la peur que nous avons envisagée plus haut vient donc aussi en droite ligne de la réflexion de Bataille. Mais chez Bataille, cette peur est spécifiée : c’est bien la peur de la mort qui définit l’humain et permet de le penser. Comme chez Barthes, c’est une peur sans objet. « – … la peur… oui la peur, à laquelle atteint seul l’Illimité de la pensée… la peur, oui, mais la peur de quoi… ? », demande Bataille en introduction au Coupable. [On retrouve ici le début de « L’image » : « À l’origine de tout, la Peur. (de quoi ?…) »]. « La réponse emplit l’univers, elle emplit l’univers en moi : – … évidemment la peur de Rien [20]… » Qui est sans doute encore quelque chose. Ce qui distingue Barthes ici, c’est qu’il n’en explore pas, ou seulement partiellement, la dimension anthropologique. Il en retient la dimension affective, le trouble, l’indépassable, la puissance sur le je. C’est pour cela qu’il ne cherche pas à lui donner des équivalents, ou à la rapprocher d’autres notions pour la caractériser, comme le fait Bataille avec l’Impossible. C’est la peur toute nue, le mot seul, sans complément, sans équivalent. D’où l’oubli de Bataille dans la réflexion sur la peur, d’où la nécessité de traduire. Mais ce que l’on comprend dès lors, à propos du fragment « Bataille, la peur », c’est que la traduction ne va pas dans le sens que l’on avait cru au départ. Ce n’est pas Barthes qui retraduit l’impossible et le sacré par la peur. C’est parce que Bataille avait traduit qu’il faut le retraduire. Le ramener à l’origine, la peur. Alors reste le nom polémique de Bataille comme un équivalent de la peur…
C’est aussi parce Barthes s’intéresse moins à ce que la peur fait à l’homme qu’à ce que la peur fait à soi qu’il choisir la phrase de Hobbes qu’il place en exergue au Plaisir du texte et dont il est devenu un marronnier critique que de dire qu’elle était énigmatique depuis que Françoise Gaillard l’a dit dans son intervention de Cerisy et qu’Éric Marty a enfoncé le clou dans sa préface au tome IV des Œuvres complètes en évoquant le « mot “peur”, qui figure si étrangement dans la mystérieuse épigraphe de Hobbes » et qui parle de « fragment sybillin » à propos du paragraphe du Plaisir du texte sur la peur [21]. La phrase de Hobbes se trouve dans l’autobiographie en prose que Hobbes commence en 1650 (il a soixante-deux ans) et qu’il retouche en 1679 à quelques années de sa mort, et qui est un texte distinct de l’autobiographie en vers latin évoquée auparavant pour le distique des origines. Même si Barthes ne l’a pas lue directement dans le texte, il est probable qu’il la trouve chez Hobbes ou dans les parages de Hobbes, et sans doute dans la première traduction complète du Léviathan en français, par François Tricaud, qui paraît chez Sirey en 1971 et qui fait événement dans les milieux philosophiques et littéraires du fait d’être la première traduction intégrale du texte [22]. Il se trouve que Tricaud cite cette phrase dans son introduction pour expliquer que le fait que l’anthropologie politique de Hobbes soit dominée par la peur repose sur des causes profondes d’une vie entièrement régie par la peur : peur en naissant, peur dans l’enfance lorsque son père prend la fuite et abandonne femme et enfant, peur de l’assassinat après la chute de Charles Ier qui le conduit en exil : « il fut le premier de ceux qui prirent la fuite » comme il l’écrivit rétrospectivement. « Ce qui l’avait poussé sur la route de l’exil, c’était la peur d’encourir des représailles pour avoir exalté l’autorité monarchique dans les Elements of Law, ce livre qui avait commencé à circuler sous forme manuscrite avant d’être diffusé en éditions médiocres et incomplètes publiées sans que l’auteur n’en sût rien. [23] » Mais comme l’écrit Carlo Ginzburg dans « Peur, révérence, terreur », on se tromperait « si l’on voyait dans cette évocation de la peur la confession d’une faiblesse personnelle. Hobbes fut un penseur audacieux jusqu’à l’insolence, enclin à la provocation et à la dispute. Par cette remarque, il entendait plutôt revendiquer avec orgueil sa décision de mettre la peur au centre de sa philosophie politique [24]. » Ces causes profondes le convainquent en effet que l’affect qui explique la formation du pacte social, c’est la peur. C’est parce que les hommes ont peur qu’ils confient l’autorité souveraine au Léviathan qui aura le monopole de la violence pour les protéger contre la peur.
Barthes n’en fait pas plus une politique qu’une anthropologie, mais il accompagne sa citation d’une même audace provocatrice. D’un orgueil comparable aussi, de mettre la peur au centre, alors qu’elle est la clandestinité absolue, que « j’ai peur » est une phrase que personne n’est prêt à avouer ou à reconnaître et qu’elle fait l’objet d’une censure. La proximité de la jouissance et de la peur, avec, dans une parenthèse, la suggestion d’une identité possible entre les deux. Elle détermine l’écriture, elle coexiste avec elle, mais elle ne peut pas s’écrire. « Mais qui pourrait dire : “J’écris pour ne pas avoir peur ?” Qui pourrait écrire la peur (ce qui ne voudrait pas dire la raconter) ? La peur ne chasse, ni ne contraint, ni n’accomplit l’écriture : par la plus immobile des contradictions, toutes deux coexistent – séparées [25]. » Le tremblement qu’ouvre la peur enjoint l’écriture mais ne la produit pas, pas plus que l’écriture n’apaise le tremblement. Seul le plaisir, par sa modestie, peut provoquer des formes d’apaisement. « Il s’accompagne toujours ou est défini par un sentiment de sécurité profonde, me semble-t-il. La condition première du plaisir, c’est la sécurité [26]. » D’où la tension qui existe entre la peur et la langue maternelle
Peur et langue maternelle
On l’a vu avec Hobbes en particulier, mais c’est vrai au-delà de lui, la mère, en libérant l’enfant, le jette dans la peur ; mais elle est aussi, par son affection, sa protection, le seul remède à cette grande peur, la seule à pouvoir protéger de ce qu’elle a, malgré elle, infligé. « J’ai peur donc je vis. » C’est pourquoi la peur est au centre de la relation à la mère, même si la retraite avec la mère, la vie avec la mère reste le seul antidote à la peur. Cette note du Journal de deuil : « PEUR : toujours affirmée – et écrite – comme centrale chez moi. Avant la mort de mam., cette Peur : peur de la perdre. Et maintenant que je l’ai perdue ? J’ai toujours PEUR, et peut-être plus encore, car, paradoxalement, encore plus fragile (d’où mon acharnement à la retraite, c’est-à-dire à joindre un lieu intégralement à l’abri de la peur) [27]. » Le mot « peur » est en capitales, deux fois. L’utopie d’un lieu « intégralement à l’abri de la peur » est en partie réalisée avec la mère, même si reste en lui une peur de la peur qui ne peut s’extirper (en ce sens on pourrait dire que Barthes est phobophobique) ; elle est en partie réalisée aussi – sans doute dans une moindre mesure, dans le texte de plaisir et en ce sens, Le Plaisir du texte, met en œuvre à son tour cette langue protectrice et voluptueuse. Mais la plupart du temps, la peur est la plus forte. Peur d’être en vue, peur que la protection disparaisse, peur de la perdre et maintenant, peur de quoi ? demande Barthes. De mourir, oui sans doute, mais moins, car c’est ce que la mère a fait. Donc ce qui est toujours là, c’est la grande peur originaire que rien ne vient plus apaiser. Seul des rituels, dont on espère une force magique, peuvent permettre d’avancer. Dans la même entrée du Journal de deuil (6 octobre 1978) : « – exorciser cette Peur, en allant là où j’ai peur (lieux faciles à repérer, grâce au signal d’émotivité [28]. » Et pour finir, cette idée que l’œuvre ne pourra se finir que sur l’ouverture, le dépli, la saisie de la peur. En bas de la fiche, entre crochets : « [Texte qui devrait finir sur cette fiche, sur cette ouverture (accouchement, défection) de la Peur.] » Le terme d’accouchement permet évidemment de lire ce qui relie la peur à la mère, comme si l’on n’accouchait, toujours, que de la peur.
Mais derrière cette note se lit aussi le projet de l’œuvre conduite par une écriture non séparée du monde (celle du haïku notamment), débarrassé du code et des mètres scolaires, toujours désirable et en mouvement, et qui, je l’ai montré ailleurs [29], peut rejoindre l’idée de langue maternelle, telle que Barthes peut l’imaginer, porteuse de la bienveillante neutralité de la mère, jamais oppressante, de sa noblesse aussi. L’œuvre n’a de sens qu’à instruire une forme de non-appartenance tout en renouant avec l’espace de la non-séparation, du dé-sevrer, qui n’est pas l’absence d’œuvre du « désœuvrer », mais l’absence de sevrage, l’absence de coupure et qui, par là, peut rejoindre le désœuvrement de l’écriture. C’est l’analyse de cette phrase de La Préparation du roman que je donne dans « Les langues étrangères de Roland Barthes » : « Tout rythme a pour fonction d’exciter ou d’apaiser le corps, ce qui, à un certain niveau, à un point éloigné, profond, primitif, du corps, est la même chose : exciter ou apaiser le corps, par la formule, c’est intégrer le corps à une nature, le réconcilier, faire cesser sa séparation, le dé-sevrer [30]. » Ce qui nous fait trouver, en fin de parcours la liaison de la peur et du Neutre qui est peut-être exactement l’incompris de la biographie. Comment se formule-t-il et pourquoi ne pouvais-je pas le comprendre ?
Il faut s’arrêter sur un dernier passage, emprunté cette fois au cours sur le Neutre. En apparence, le cours sur le Neutre privilégie les termes d’effroi et de terreur à celui de peur. J’avais d’ailleurs le projet de distinguer l’emploi de ces différents termes (la peur avec l’angoisse (« la peur n’est pas l’angoisse », dans Le Plaisir du texte), l’effroi, qui est plus proche du phobos antique et de la terreur. Ce pourrait être un autre projet, avec pour ligne directrice la distinction que Carlo Ginzburg repère chez Hobbes entre « fear » (peur), « anxiety » (inquiétude) et « awe » (crainte, terreur), qu’il relie au présent et au nom donné au bombardement de 2003 sur Bagdad, opération « shock and awe », expression empruntée à Hobbes, pour parler d’« un monde où les États font peser la menace de la terreur, l’exercent et la subissent parfois [31]. » Chez Barthes, la distinction est aussi très sensible, même si elle est moins formalisée, et elle peut aussi aider à penser la violence de notre présent. L’effroi, c’est la peur dite, à laquelle on reconnaît sa part d’imaginaire. C’est très clair dans le cours sur le Neutre. Et puis il y a cette phrase, dans un paragraphe intitulé « la prière » et qui suit juste la distinction proposée par Barthes entre angoisse et effroi : « Peut-être fait-il partie du Neutre de reconnaître la peur : ne pas la censurer verbalement, très rare chez nous : civilisation “machiste” : point d’honneur à ne pas montrer sa peur. Moi-même, je ne montre pas mon effroi : j’ai l’air calme et on m’en fait parfois une sorte de reproche : on ne sait pas quel pathos il peut y avoir derrière une voix (par ce sombre dimanche, 21 août 1977 émotion aux larmes d’écouter le IVe acte de Pelléas). Peut-être le fantasme persistant du roman-à-écrire implique-t-il ceci : puisque sans carapace, invisible à quiconque, envie d’un espace d’écriture où ce pathos cesserait d’être clandestin : le roman le mettrait entre guillemets [32]. » Le Neutre et la peur ont partie liée comme la peur et la mère, le neutre et la mère. Or c’est un phénomène très étrange que cette liaison peur/mère/neutre. Quelque chose reste énigmatique et incompris. L’intuition de cette conférence m’est venue lorsque j’écrivais en août dernier sur les deux derniers livres de Guyotat, Joyeux animaux de la misère II. Par la main dans les enfers et Humains par hasard. Il m’a fallu le détour par Guyotat pour comprendre que je pouvais tenter de comprendre cela chez Barthes parce qu’il met aussi la peur au principe de son œuvre, et que celle-ci est faite et qu’il a pu répondre à l’interrogation de Barthes sur la possibilité d’écrire la peur. La peur est aussi chez Guyotat le lieu même de la contradiction. Elle met en marche le langage ; elle promet l’alliance d’une extrême sensibilité, d’une très grande empathie et d’une intelligence bâtisseuse qui est au fond de toute vraie création. L’empathie, on la lit clairement dans Humains par hasard, le recueil d’entretien, par exemple lorsque Guyotat parle de la vie intérieure des êtres qu’il croise dans le métro, de la rapidité extrême avec laquelle il vit ce qu’il voit et qu’il appelle « la vrille », ou encore de sa sensibilité à la nature dans toutes ses manifestations, tremblements, paysages, fourmis et oiseaux, propices à relativiser l’idée de l’homme. « Je vis la vie de ce qui est en face de moi. Il peut s’agir d’un chien, d’un animal, d’une chose. Je vois une phrase dans un journal et aussitôt je fais en quelques secondes une trajectoire. C’est ma vie et cela ne se voit pas forcément [33]. » Mais cette empathie, on la sent par tous les pores de la peau lorsqu’on fait l’expérience de Par la main dans les enfers. Les formes de la souffrance n’y sont pas analysées, mais transcendées, dépassées par le théâtre d’un autre monde où un ordre tout différent est proposé. « Je ne peux pas laisser quelqu’un en dehors du monde, c’est impossible. Je veux que tout le monde soit réuni dans le même espace de miséricorde [34]. » Inversement, c’est parce que Pierre Guyotat ne s’assigne aucune place qu’il peut devenir lui-même ce théâtre et en faire le don. Il peut à la fois le créer devant lui et en être, inventer un peuple et en être, lui appartenir [35]. C’est aussi ce qu’éprouve Barthes dans le Journal de deuil : le moment exact où se relient la peur et l’empathie, version moderne, désacralisée du couple terreur et pitié de l’Antiquité, qui permet d’établir la liaison entre la peur, la mère et le neutre et d’en faire quelque chose.
[1] Olivier Cadiot, dans le tome II de son Histoire de la littérature récente (P.O.L, 2017) reprend ceci dans un fragment intitulé « César » : « On ne lui rendra rien. Pas question. Je ne vous dirai pas, par exemple, qui a dit cette phrase étrange : Si je devais créer un Dieu, je le doterais d’une comprenette lente : sorte de goutte-à-goutte du problème. Les gens qui comprennent vite me font peur, explique-t-il. J’ai une envie folle de vous dire son nom, parce que celui qui le dit, ce n’est pas son genre d’employer le mot comprenette, c’est énorme – un peu comme si Hegel disait Salut vieux à un copain. » (p. 240)
[2] « Apparemment, la peur a toujours un objet, on a toujours peur de quelque chose… », « Entre le plaisir du texte et l’utopie de la pensée », entretien avec Abdallah Bensmaïn, L’Opinion (Rabat, Maroc), 6 février 1978, t. v, p. 534.
[3] Voir Françoise Gaillard, « Qui a peur de la bêtise ? », Prétexte : Roland Barthes. Cerisy 1977, Christian Bourgois, 2003 [1978], p. 305-324. Voir aussi Claude Coste, Bêtise de Barthes, Klincksieck, « Hourvari », 2011.
[4] « Texte à deux (parties) », Wunderblock, 1977, OC V., p. 389.
[5] Prétexte : Roland Barthes. Cerisy 1977, op. cit., p. 326.
[6] « Texte à deux (parties) », art. cit., p. 383.
[7] Prétexte : Roland Barthes. Cerisy 1977, op. cit., p. 332.
[8] Prétexte : Roland Barthes. Cerisy 1977, op. cit., p. 333 et OC V, p. 512.
[9] Le Plaisir du texte, OC IV, p. 249.
[10] « Entre le plaisir du texte et l’utopie de la pensée », art. cit., t. v, p. 534.
[11] Das Problem des Menschwerdung, 1926.
[12] Desmond Morris, Le Singe nu, trad. de l’anglais par Jean Rosenthal, Grasset, 1968.
[13] « Entre le plaisir du texte et l’utopie de la pensée », art. cit., t. v, p. 535.
[14] Sur Racine, OC II, p. 102.
[15] Roland Barthes par Roland Barthes, OC IV, p. 690.
[16] L’anthropologie de l’homme racinien est aussi analytique (et pas seulement structurale), « parce que seul un langage prêt à recueillir la peur du monde, comme l’est, je crois, la psychanalyse, m’a paru convenir à la rencontre d’un homme enfermé. » Sur Racine, OC ii, p. 53.
[17] Roland Barthes par Roland Barthes, OC IV, p. 718.
[18] Georges Bataille, Le Coupable, Gallimard, 1961, p. 12.
[19] Jean-Christophe Goddard, « Absence de dieu et anthropologie de la peur chez Georges Bataille », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2010 (3), p. 371-380. URL : http://www.cairn.info/revue-philosophique-2010-3-page-371.htm
[20] Georges Bataille, Le Coupable, op. cit., p. 13.
[21] Eric Marty, « Présentation », OC IV, p. 13.
[22] Thomas Hobbes, Léviathan, traduction de l’anglais et notes par François Tricaud, Paris, Sirey, 1971.
[23] Carlo Ginzburg, « Peur, révérence, terreur. Une approche oblique du présent », trad. Martin Rueff.
[24] Ibidem.
[25] Le Plaisir du texte, OC IV, p. 249.
[26] « Entre le plaisir du texte et l’utopie de la pensée », art. cit., t. v, p. 535.
[27] Journal de deuil, p. 216.
[28] Ibid., p. 217.
[29] Tiphaine Samoyault, « Les langues étrangères de Roland Barthes », Littera. Revue de langue et littérature françaises de la Société japonaise de Langue et littérature française, Tokyo, 2016, p. 5-13.
[30] La préparation du roman, p. 56.
[31] Carlo Ginzburg, « Peur, révérence, terreur. Une approche oblique du présent », trad. Martin Rueff.
[32] Le Neutre, p. 259.
[33] Pierre Guyotat, Humains par hasard. Entretiens avec Donatien Grau, Gallimard, « Arcades », 2016, p. 31.
[34] Ibid., p. 63.
[35] Tiphaine Samoyault, « Subversion est raison », Artpress, octobre 2016.