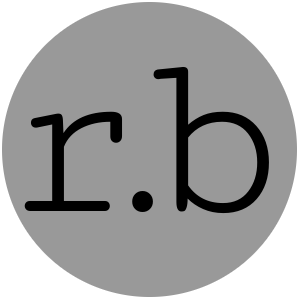« Je ne peux pas aller à ce vernissage ou à cette projection de film, excusez-moi, j’ai un roman à faire. »
Roland Barthes, La Préparation du roman
Temps du deuil, temps du récit
« Dès qu’un être est mort, construction affolée de l’avenir (changements de meubles, etc.) : aveniro-manie [1] ». Cette phrase que l’on trouve au début du Journal de deuil de Roland Barthes ne renvoie évidemment pas à n’importe quelle mort, mais à celle, encore inconcevable en ce 27 octobre 1977, de sa propre mère, qui l’a quitté deux jours plus tôt. Ce qui frappe l’auteur de ce journal, dans les premiers instants après la mort de l’autre, ce sont donc des considérations matérielles : il y a une gestion de la mort et de son après-coup, comme il y a une préparation de l’écriture. Gestion et préparation seront précisément des thèmes insistants de l’œuvre du dernier Barthes, en particulier lors de son ultime cours au Collège de France, La Préparation du roman [2], qui en souligne la dialectique : « Il faut, à un moment dans la vie lié au certain âge dont j’ai parlé, décider si on va se mettre dans la gestion ou dans la novation, dans la production » (PR, p. 45). Cet « âge » qui demande de choisir entre différents rythmes d’existence, Barthes le nomme le « “milieu” de la vie », en référence au célèbre mezzo del cammin di nostra vita de Dante. Moment non chronologique, mais symbolique, le milieu de la vie se caractérise donc par un désir de renouveau et par une urgence de redresser son quotidien. Pour Barthes, ce souhait d’une vie nouvelle se cristallise dans l’après-coup de la mort de sa mère, de même qu’il se traduit par la recherche d’une nouvelle forme d’écriture : ce « roman » dont il examinera les conditions de possibilité devant son auditoire au Collège de France.
Événement toujours unique et inattendu, la mort d’un être aimé produit ainsi un redoublement et une dramatisation des rapports du sujet avec le monde social. La gestion retrouve ici son sens premier et redevient un exercice de pouvoir : pouvoir de la norme sur le sujet et pouvoir du sujet sur son environnement. Comme l’évoque Barthes, il y a une gestion intime du deuil. Pour le moins concrète, celle-ci est reliée à l’ameublement, aux habitudes alimentaires, au rythme du sommeil, aux fréquentations, etc. Mais, dans le même temps, ce surplus de gestion que demande la disparition de l’autre peut aussi se transformer en quelque chose de complètement contraire, soit en la création d’une vie ou d’une œuvre nouvelle. La Préparation du roman est le signe de ce transfert : la gestion que la société impose au sujet peut servir de tremplin pour une nouvelle éthique de vie et de création. De manière générale, toute l’œuvre du dernier Barthes témoigne des bouleversements causés par le deuil sur notre expérience du temps et de l’avenir. D’une part, l’aveniro-manie prend la forme d’une angoisse de gestion. Comment réorganiser sa vie suite à un tel bouleversement ? Comment trouver le temps de continuer à écrire, d’assister à des réunions administratives, de donner ses cours, de planifier son prochain livre, etc. ? Comment continuer à dialoguer normalement avec les autres ? Bref, comment continuer à vivre sa vie, et, pour reprendre une expression de Barthes, comment continuer à « vivre-ensemble » ? C’est cet avenir-là qui fait pencher le sujet vers une paranoïa non productive : en repartant de zéro, il faut réapprendre à se gérer soi-même et à gérer les autres. D’autre part, cette angoisse face à la dimension la plus ordinaire de l’avenir se renverse en une démarche de création. Dans le Journal de deuil, celle-ci se remarque d’abord par une notation surprenante : « Qui sait ? Peut-être un peu d’or dans ces notes ? » (JD, p. 17). Quoi de plus curieux, en effet, qu’une telle question, d’autant plus que Barthes se la pose à peine quarante-huit heures après la mort de sa mère, alors que son journal ne compte même pas encore cent mots ? Quel est le but de cet écrivain endeuillé qui se compare lui-même à un chercheur d’or, sinon de transformer son deuil en quelque chose d’autre ? Et qu’y a-t-il d’autre pour un écrivain que la littérature ? Ces questions viennent cercler la dimension paradoxale du Journal de deuil et, par là, celle de l’œuvre du dernier Barthes : il faut vivre le deuil au présent, tout en le projetant dans l’avenir de l’écriture en espérant le transformer en or. L’aporie de cette démarche branlante n’échappera pas à l’auteur du journal, en ce même mois d’octobre 1977 : « Je ne veux pas en parler par peur de faire de la littérature – ou sans être sûr que c’en ne sera pas – bien qu’en fait la littérature s’origine dans ces vérités. » (JD, p. 33) Au même titre que la gestion peut se transformer en novation, l’œuvre du dernier Barthes réfléchit à la possibilité que le temps du deuil devienne le temps du récit [3].
Dans les deux séances qu’il consacra au Journal de deuil dans son cours « Écrire la vie » au Collège de France [4], Antoine Compagnon insiste longuement sur la dimension paradoxale de ce document, où il repérait une incompatibilité du deuil et des mots. Écrire son deuil est une tâche doublement impossible, soit par un blocage d’écriture, soit parce que la littérature viendra sublimer le deuil. Si jamais le deuil arrive à devenir littéraire, ce ne sera pas sous la forme d’un récit, mais par fragments. Or, cette vita nova à laquelle Barthes tentera de donner consistance dans La Préparation du roman passe justement par le dépassement de l’opposition classique entre forme brève et forme longue, continu et discontinu [5]. Le roman dont Barthes arpente la préparation devant son auditoire est pensé par lui comme une forme hybride qui, tout en ne niant pas complètement le fragment et la forme brève, vise une continuité nouvelle : « Ici, tout de suite un “problème” qui va orienter le cours de cette année : peut-on faire du Récit (ou du Roman) avec du Présent ? » (PR, p. 46). En d’autres mots, si l’on ramène la question au contexte biographique de Barthes, auquel il pensait sans doute lui-même : peut-on concilier l’écriture et le deuil, le récit et le néant ? C’est avec Proust – dont la mort de la mère est aussi l’élément déclencheur d’une écriture nouvelle – que Barthes essaiera de concilier le deuil et la littérature :
tout récit mythique récite (c’est-à-dire met en récit) que la mort sert à quelque chose. Et pour Proust, écrire veut dire aussi que la mort sert à quelque chose, écrire le Vouloir-Écrire dit cela, que la mort sert à quelque chose, et que le Vouloir-Écrire et l’écrire servent à sauver, à vaincre la Mort ; non pas la sienne, encore qu’il ait lutté avec elle, mais celle de ceux qu’il a aimés, pour lesquels il a porté témoignage en écrivant, en les perpétuant, en les érigeant hors de la non-Mémoire » (PR, p. 30 ; l’auteur souligne)
Que la mort serve à quelque chose, cela ne peut se produire pour Barthes que par le recours à l’écriture. De la mort de sa mère, Proust tirera le courage de commencer à écrire À la recherche du temps perdu. Aux côtés de celle d’Albertine, centre névralgique des réflexions de Proust sur le deuil, cette mort sera transposée dans le roman par celle de la grand-mère du héros, dont le deuil sera vécu différemment par ce dernier et par sa mère. Pour Barthes, si or il y a à trouver dans les notes du Journal de deuil, c’est dans cette révélation de l’importance du livre sur la photographie, qui deviendra La Chambre claire [6], dont la préparation est directement associée à celle du roman de la vie nouvelle :
J’écris mon cours et en viens à écrire Mon Roman. Je pense alors avec déchirement à l’un des derniers mots de mam. : Mon Roland ! Mon Roland ! J’ai envie de pleurer.
[Sans doute je serai mal, tant que je n’aurai pas écrit quelque chose à partir d’elle (Photo, ou autre chose).] (JD, p. 228 ; l’auteur souligne)
C’est donc dans ce mélange temporel extrême, caractérisé par une volonté de sauter dans l’avenir tandis que le présent ne cesse de multiplier les accidents qui nous font replonger dans le deuil, qu’il nous semble intéressant d’aborder l’œuvre du dernier Barthes, en tentant de souligner l’homogénéité de ses derniers textes : l’un intime, avec le Journal de deuil et l’autre destiné à être lu et performé en public, avec La Préparation du roman [7].
L’hypothèse qui sera défendue ici est que c’est en passant par une réflexion sur les images – et particulièrement les images cinématographiques, dans leur rapport à la photographie – que Barthes arrive à investir de manière originale le paradoxe d’une écriture de vie qui, à même le deuil, trouve un second souffle pour fabuler l’avenir : ce « Roman-Fragments » (PR, p. 48), dont le devenir serait fondé sur l’expérience achoppée du présent. Par sa sensibilité envers les images, Barthes saura renouveler sa vision de l’écriture. Celle-ci s’en trouvera projetée dans un vaste récit aux temporalités multiples dont le sujet premier, justement, n’est nul autre que le Temps en personne.
La Préparation du roman : haïku, nostalgie cinématographique et biographèmes
De manière générale, Barthes oppose l’unicité du « ça a été » de la photographie au flux continu des images cinématographiques [8]. Toutefois, il arrive également que cette dialectique se peaufine : le cinéma devient alors porteur du temps suspendu d’un moment passé, contredisant ainsi le « ronron » du défilement pelliculaire. Deux exemples de ce renversement du référent cinématographique sont particulièrement évocateurs.
D’abord, on note ce passage de La Préparation du roman où la référence cinématographique est utilisée par Barthes pour illustrer « la technique du “son coupé” » propre à certains haïkus :
Premier traitement parmi d’autres, c’est ce que j’appellerais la technique du « son coupé ». Le haïku a en principe une force de vision (de tableau), c’est une hypotypose. Et on pourrait souvent penser à de courtes séquences filmées ; mais il y a parfois un charme supplémentaire et surprenant, si on a la sensation qu’il s’agit d’une séance filmée mais dont le son a été coupé et alors, à ce moment-là, dans la vision, il y a quelque chose de bizarrement gommé, interrompu et incomplet. […] Je sens une sorte de silence. Ce n’est pas dit bien sûr, mais personnellement j’entends le haïku comme ça, comme s’il y avait une sorte de perception globale mais sans son. Une sorte de surdité mystérieuse de l’image, qui est rendue mate. (PR, p. 132)
Ce qui est développé ici à titre de comparaison, c’est bien l’horizon médiatique du haïku, de même que sa valeur canonique. Dans La Préparation du roman, les longues analyses consacrées au haïku servent d’abord à le présenter comme manifestation exemplaire d’une forme brève pouvant mener au « roman-fragments » dont Barthes étudie l’avènement. Or, pour brève qu’elle soit, la forme haïku ne se limite pas à une expérience instantanée du temps. Au contraire, Barthes insiste sur la sensation de durée et de mouvement qu’arrivent à créer en lui les images du haïku – d’où la référence au cinéma, art par excellence du récit visuel. Aussi, par sa capacité d’évoquer de courtes séquences filmées, le haïku ne répond plus seulement de l’imaginaire de la photographie, comme ce sera le cas dans La Chambre claire. Rappelant le renversement de la gestion en création, le haïku ne saurait se limiter à n’être que photographique, à n’explorer que le « ça a été ». Au contraire, il est amené à déborder sur d’autres formes et sur d’autres temps : cinéma et récit.
Et voici comment Barthes poursuit son analyse « filmique » de certains haïkus :
Là le son coupé est noté et il la pointe (le satori). De là à imaginer une fois de plus tout ce que nous a fait perdre l’abandon du cinéma muet […] ; le progrès peut se tromper et l’avant-garde aussi peut se tromper, et quand on a abandonné le cinéma muet, on a peut-être abandonné quelque chose d’important, quelque chose de spécifique, d’éidétique […]). Le son coupé, c’est-à-dire quelque chose qui n’est pas le silence, qui ne signifie pas le silence (car le silence est toujours lui-même très signifiant), mais justement – différence subtile – le son coupé, la parole au loin, présente et effacée, qui est là sous le gommage, inaudible sans que ce soit par confusion, brouillage ou brouhaha ; c’est-à-dire l’inaudible pur, qui ne provient pas d’un bruit ; l’inaudible qu’on entend. (PR, p. 132-133 ; l’auteur souligne)
Le satori – la vérité, la quiddité – du haïku ne se trouve donc nulle part dans le texte, n’est réductible à aucun mot, mais émane d’une présence d’absence, du sentiment que quelque chose se cache en creux : le son coupé, entre les lignes du haïku, plus parlant que tout dialogue [9]. Cette richesse du silence participe évidemment au problème de faire du roman avec le présent qui occupe Barthes dans toute La Préparation du roman. Forme brève par excellence, c’est pourtant à même ce qui ne montre pas et ne dit pas que le haïku est le plus évocateur, qu’il atteint la vérité propre au roman dont Barthes rêve devant son auditoire. Véritable mystère, opacité impénétrable, ce silence est aussi déjà un récit, et même un récit en mouvement, comme le rappellent les constants renvois au cinéma muet : « L’Image est toujours muette mais elle est muette avec force. Ça ne sert à rien de dire qu’elle est muette, il faut dire qu’elle l’est avec force » (PR, p. 133). Barthes ne s’oppose donc pas seulement au cinéma dans un dualisme qui l’opposerait à la photographie, mais, de manière plus complexe, il résiste aux progrès techniques et aux mutations identitaires du cinéma moderne pour se réfugier dans l’aura d’une époque révolue du média, celle du cinéma muet [10]. Pour que le cinéma – le plus moderne des arts, comme le veut la doxa [11] – fasse sens, il doit devenir art du passé. Ainsi, Barthes ne pense pas le cinéma sous le mode de la seule négation, mais aussi sous celui de la soustraction. Il faut fragmenter le cinéma, faire l’ablation du son, puisque le son tue la dimension auratique de l’image cinématographique, lui enlève son authenticité [12]. Imaginer les paroles et les bruits d’une scène demande une participation active et personnelle de la part du spectateur, à l’image de la photographie (qui, par nature, est différente pour chacun, là où le film est uniforme pour tous).
« Un art pour un autre. […] [L]e haïku peut faire des détournements de circuits, des branchements “fautifs” – c’est-à-dire qu’un son va amener, par exemple, une sensation de tact ; […] c’est une sorte de métonymie hétérogène et “hérétique” » (PR, p. 133). À l’instar du « roman-fragments », le haïku est ainsi une forme d’écriture hybride aux temporalités variées : passé pur d’un moment photographique, passé nostalgique du cinéma muet, présent de l’image en mouvement et futur d’un roman à écrire. Art de la composition, le haïku est à la fois gestion du temps passé et exercice de novation pour faire entrer ce temps dans un devenir. Hétérogène, il moule les contours de l’œuvre fantasmée dans La Préparation du roman.
Or, ce n’est pas la première fois que Barthes provoque une réflexion ambiguë sur le cinéma – parlant, en particulier –, où un élément spécifique du média s’oppose à la logique générale de celui-ci en venant l’habiter tel un corps étranger. Rappelons rapidement l’article « Le troisième sens » (1970), dans lequel se trouve l’hypothèse du sens obtus – « supplément que mon intellection ne parvient pas bien à aborder, à la fois têtu et fuyant, lisse et échappé [13] » – comme anticipation du punctum photographique de La Chambre claire. On peut évoquer ces longues phrases vers la fin de l’article, où Barthes identifie deux types simultanés de récit et de temporalité dans le cinéma de Sergueï M. Eisenstein :
S.M.E., opère, me semble-t-il, cette distinction : la présence d’un troisième sens supplémentaire, obtus […], [qui] remodèle profondément le statut théorique de l’anecdote : l’histoire (la diégèse) n’est plus seulement un système fort (système narratif millénaire), mais aussi et contradictoirement un simple espace, un champ de permanences et de permutations ; […] elle est cet ordre faux qui permet de tourner la pure série, la combinaison aléatoire […], et d’atteindre une structuration qui fuit de l’intérieur. Aussi peut-on dire qu’avec S.M.E., il faut inverser le cliché qui veut que, plus le seul est gratuit, plus il apparaît comme un simple parasite de l’histoire racontée : c’est au contraire cette histoire qui devient en quelque sorte paramétrique au signifiant, dont elle n’est plus que le champ de déplacement, la négativité constitutive, ou encore : la compagne de route [14].
Beaucoup de choses dans ce passage, mais qui convergent toutes vers l’idée d’une hétérogénéité inhérente au média cinématographique : certains photogrammes – images fixes, donc – possèdent une manière alternative de « faire récit », sorte de « film dans le film ». Il est aussi intéressant de noter que le photogramme est au déroulement du film ce que le film muet est au film parlant : une involution dotée d’une plus-value esthétique et narrative. Pour Barthes, si le cinéma possède une profondeur temporelle, ce n’est pas dans le déroulement inéluctable du film, mais dans cette durée flottante du détail, photogramme arrêtant le geste au moment où sa vérité empathique et subjective est la plus grande. De même, on a vu que c’est lorsqu’il est privé de l’un de ses principaux moyens d’expression – le son – que le cinéma peut réellement dialoguer avec la littérature. À la recherche de nouveaux moyens pour dire le temps, le dernier Barthes est amené à fabuler l’origine et le devenir des médias pour retrouver les questions de gestion et de renouveau auxquelles il consacre l’essentiel de ses réflexions.
Cette même idée du hiatus entre le cinéma muet et le cinéma parlant sera reprise dans un ouvrage dont la rédaction est contemporaine de celle du l’article « Le troisième sens », soit le Sade, Fourier, Loyola [15], dont deux passages doivent nous intéresser. Le premier se trouve dès la préface :
si j’étais écrivain, et mort, comme j’aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d’un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons : des « biographèmes », dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la façon des atomes épicuriens, quelque corps futur, promis à la même dispersion ; une vie trouée, en somme, comme Proust a su écrire la sienne dans son œuvre, ou encore un film, à l’ancienne manière, duquel toute parole est absente et dont le flot d’images (ce flumen orationis en quoi consiste peut-être la « cochonnerie » de l’écriture) est entrecoupé, à la façon de hoquets salutaires, par le noir à peine écrit de l’intertitre, l’irruption désinvolte d’un autre signifiant : le manchon blanc de Sade, les pots de fleurs de Fourier, les yeux espagnols d’Ignace [16].
Au système unique et général de la vie, celui de la biographie, Barthes oppose une sorte d’anti système, entité multiple et variable, qu’il qualifie du nom de « biographème » : vie fragmentée, trouée, dont le destin est de se diviser davantage, de voyager, de se greffer temporairement à d’autres morceaux de vie, avant de se disperser à nouveau. Là où la biographie se comprend obligatoirement au passé, en tentant d’expliquer la vie de la personne par son enfance ou par sa mort, le biographème n’est pensable qu’au futur, puisque aucun sens n’y est d’emblée donné. Le paradoxe du biographème, c’est d’être à la fois aléatoire et nécessaire. Sorte de punctum sans cliché photographique, le manchon blanc de Sade ne se réduit pas à signifier quelque chose de particulier, mais il permet néanmoins d’atteindre une compréhension ténue de la personne de l’écrivain. « [P]ourquoi cette histoire-là parmi tant d’autres ? J’ai aussi souvent cette réaction devant des films. […] Pour moi, le grand critère pour reconnaître une œuvre, ce serait qu’elle dégage un sentiment de nécessité. Devant Guerre et Paix, je ne me dis pas : Pourquoi cette histoire plutôt qu’une autre ? Devant la Recherche non plus » (PR, p. 39 ; l’auteur souligne), dira Barthes quelques années plus tard, développant la même intuition. Seul ce qui est nécessaire a un avenir, car la nécessité, pour Barthes, est précisément ce qui ne s’explique pas, ce qui ne se résume pas : « La nécessité, ce n’est pas qu’une œuvre ait un sens (c’est-à-dire un signifié, ce qui n’a aucun intérêt et fait souvent de mauvaises œuvres), mais qu’il y ait du sens, une prolifération du sens, qu’il y ait une énergie polysémique » (PR, p. 39). Ce qui fait histoire – fait sens – pour Barthes, ce n’est pas le flux continu d’anecdotes et de péripéties, mais le détail si vrai qu’il en demeure multiple et éternellement signifiant.
C’est bien vers cette forme de nécessité qu’est orienté le passage de la préface du Sade, Fourier, Loyola, où la notion de biographème est développée pour la première fois. Lorsqu’il est question de cette nouvelle manière de ramener la notion d’auteur sur la sellette – « un retour amical de l’auteur [17] » – Proust est toujours convoqué par Barthes. Comme il le répétera souvent dans La Préparation du roman, « [l]a seule chose que raconte la Recherche du temps perdu, c’est le Vouloir-Écrire » (PR, p. 27) et, plus encore, car la vocation littéraire du héros-narrateur se structure autour de fragments aléatoires et involontaires, mais dont l’impact émotionnel n’est pas moins prégnant que celui des biographèmes : madeleine trempée dans une infusion, lacets que l’on attache, cuillère qui se cogne contre une tasse de thé, etc. La vie que raconte Proust est ainsi « trouée » par ces épisodes à la fois nécessaires et interchangeables, dans lesquels le récit de vie est indissociable de l’exaltation littéraire. Or, quoi de plus évocateur que la métaphore utilisée par Barthes pour expliquer la spécificité du récit de vie proustien (qui, lui-même, sert à expliquer la notion de biographème et le projet général du Sade, Fourier, Loyola) : un film muet, « à l’ancienne manière », à la parole absente et dont la continuité du flux visuel est interrompue par les intertitres (les « cartons »), vestiges d’écriture sur fond noir. Barthes propose ici une nouvelle involution dans son utilisation métaphorique du cinéma pour illustrer certains aspects de l’écriture de la vie : non seulement le film est muet, ce qui pousse le spectateur à être inventif et à entendre l’épaisseur proprement narrative du silence, non seulement, aussi, certains photogrammes au sens obtus sont-ils porteurs d’une vérité essentielle qui rend encore plus arbitraire l’histoire que le film raconte, mais, enfin, cette histoire n’est jamais aussi nécessaire et intéressante que lorsqu’elle achoppe, qu’elle bloque, qu’elle se fait envahir par cet étranger qu’est le mot (l’intertitre). À la recherche d’une manière trouée de raconter une vie – d’abord, celle des écrivains, puis, la sienne et, finalement, celle de l’être aimé disparu – Barthes renvoie ainsi aux intertitres cinématographiques, mais, la nuance est importante, il ne s’y réfère pas pour leur qualité proprement narrative, c’est-à-dire non pas pour leur message explicite, mais pour l’effet indirect d’étrangeté qu’il provoque, pour la vérité que l’apparition même du carton possède a contrario. Au-delà de la signification de l’écriture, c’est par le carton que le cinéma muet gagne une épaisseur. C’est lorsque le flux des images s’entrecoupe que le récit filmique atteint véritablement une forme de devenir. Grâce à une recherche de ce qui accroche le spectateur et brise l’illusion filmique, Barthes offre une identité nouvelle au cinéma [18]. Retourner le cinéma sur lui-même permet d’offrir un tel avenir au média : en faisant dérailler le cours normal de la projection et du récit filmique, il insiste sur des détails non d’emblée signifiants de l’image qui, tout en fragmentant le film, le propulsent dans un avenir par nature indiscernable, car en perpétuelle transformation de soi. « Écrire, pour moi, se constitue à partir de l’avenir, et cet avenir est sans contenu, il ne se remplit jamais, sa nature est en quelque sorte hémorragique, puisqu’il remet sans cesse le temps en marche » (PR, p. 281). C’est là le véritable récit de l’image.
Journal de deuil : réminiscence, contre-culture, nuance
« Il ne serait pas impossible de théoriser une lecture […] qui partirait des moments de l’œuvre, c’est-à-dire que l’on pourrait imaginer un second souffle à l’analyse structurale, par exemple des récits, qui, au lieu d’essayer de découper en unités sémantiques […], partirait à neuf, d’une façon très différente, de la notion de moment, des moments de l’œuvre, des moments forts, des moments de vérité ou, si l’on ne craint pas le mot, des moments pathétiques » (PR, p. 231-232). Centrale pour les questions qui occupent directement Barthes durant les deux années de La Préparation du roman, cette idée du fragment comme unité privilégiée et anarchique – puisqu’il s’agit bien de repartir à neuf et de proposer une nouvelle histoire de la littérature – se trouve déjà dans certains moments antérieurs de son œuvre, dont, encore une fois, dans le Sade, Fourier, Loyola. Plus précisément, elle est développée dans un passage qui reprend la discussion sur le cinéma que Barthes avait amorcée dans l’introduction de l’essai. Cette réflexion apparaît lorsque Barthes évoque la représentation des groupes de personnages chez Sade, que ce dernier traite en tant que tableaux vivants, « cette forme de spectacle a été peu étudiée, sans doute parce que personne n’en fait plus [19] » précise Barthes (nous faisant déjà retrouver ce goût nostalgique pour les formes d’expression révolues). Voici :
le photogramme filmique s’oppose au film lui-même par un clivage qui n’est pas celui du prélèvement (on immobilise et on publie une scène tirée d’un grand film), mais, si l’on peut dire, de la perversion : le tableau vivant, en dépit du caractère apparemment total de la figuration, est un objet fétiche (immobiliser, éclairer, encadrer, reviennent à morceler), tandis que le film, comme fonctionnement, serait une activité hystérique (le cinéma ne consiste pas à animer des images ; l’opposition de la photographie et du film n’est pas celle de l’image fixe et de l’image mobile ; le cinéma consiste, non à figurer, mais à faire fonctionner un système) [20].
Le morcellement dont rêve ici Barthes ne revient donc pas à prélever des photogrammes pour ensuite les assembler dans un livre de salon. Dans ce passage, l’auteur va très loin dans son idée que le film est un flux, un récit continu, autonome et, par là même, hystérique, au sens de coma, paralysie, dépression (et non au sens de mouvements convulsifs, dont le caractère achoppé viendrait contredire l’argumentaire). À l’inverse, le photogramme semble nier le récit, mais, en revanche, révèle une nouvelle dimension de l’image – non fonctionnelle – qui donne accès à une autre forme de vérité. En son sein, le film porte le poison pour l’anéantir : le photogramme, c’est-à-dire l’image qui se donne à voir pour elle-même. Pervertir le film par le photogramme revient à en détourner le fonctionnement. Cependant, comme on l’a souligné, ce geste n’est pas nihiliste – il ne s’agit pas de détruire le cinéma sans rien reconstruire sur ses ruines –, mais répond d’un projet autre : celui, précisément, d’une histoire, des images et des récits dont l’unité de mesure serait le moment pathétique (histoire utopique, certes, puisqu’elle serait à refaire d’individu en individu). Ainsi, le photogramme s’oppose au film comme le moment nécessaire s’oppose à l’histoire contingente. Cela veut donc dire que, pour Barthes, le photogramme n’est pas tant une unité métrique, qu’une donnée essentiellement personnelle. Le photogramme, c’est ce qui dans le film fait sens, au point de nous faire oublier le film. C’est cette « cime du particulier » dont parle Proust – et à laquelle se référera maintes fois Barthes dans La Préparation du roman –qui, seule, sera nécessaire, et dont la littérature, attentive à l’avenir de l’émotion, devra trouver le moyen de témoigner.
C’est là, aussi, qu’entre en jeu le Journal de deuil, qui peut se lire comme l’aboutissement et l’expérimentation intime de cette théorie du fragment en tant que nouvelle forme de récit :
Urt. Film de Wyler, La Vipère (The Little Foxes) avec Bette Davis.
— La fille parle à un moment de « poudre de riz ».
— Toute ma petite enfance me revient. Maman. La boîte à poudre de riz. Tout est là, présent. Je suis là.
→ Le Moi ne vieillit pas.
(Je suis aussi « frais » que du temps de la Poudre de riz) (JD, p. 123)
Avant de le commenter, rappelons que ce passage sur la réminiscence cinématographique de la poudre de riz trouve son exact équivalent photographique dans La Chambre claire :
Le temps où ma mère a vécu avant moi, c’est ça, pour moi l’Histoire (c’est d’ailleurs cette époque qui m’intéresse le plus, historiquement). Aucune anamnèse ne pourra jamais me faire entrevoir ce temps à partir de moi-même […] – alors que, contemplant une photo où elle me serre, enfant, contre elle, je puis réveiller en moi la douceur froissée du crêpe de Chine et le parfum de la poudre de riz [21].
Aucun passage ne participe autant à notre hypothèse que celui-là : la photographie donne accès à tout un pan nouveau du passé, elle permet au sujet – en psychologie, l’anamnèse signifie la biographie du sujet – de vivre un moment du passé, comme si celui-ci advenait pour la première fois. Sorte d’équivalent visuel de la madeleine proustienne, la poudre de riz ne fait pas que rappeler au héros son enfance à Combray, mais, bien plus, elle fournit au narrateur une image nouvelle, plongée dans un devenir, sur laquelle pourra se construire tout un roman [22]. La photographie n’est donc pas qu’une prothèse pour retrouver le temps perdu : elle est une matrice narrative à haute intensité. De même, non sans surprise, pour le film, auquel Barthes confère dans ce passage de la poudre de riz du Journal de deuil une dignité nouvelle. Mais, en même temps, à relire des textes comme « Le troisième sens » et le Sade, Fourier, Loyola, on comprend que Barthes, en fait, poursuit un filon qu’il n’a jamais vraiment abandonné : celui du cinéma contre le cinéma, nostalgie d’une forme primitive du média qui, par effet de retournement, est porteur de l’avenir le plus rayonnant. D’ailleurs, on peut également noter une évolution de renversement cinématographique : contrairement au passage de La Chambre claire qui identifie une photographie où la poudre de riz est visible, celui du Journal de deuil renvoie à une parole du film de Wyler (dans lequel la poudre de riz n’est même pas montrée…). Cette réminiscence sonore a tout d’une surprise, car elle vient souligner les valeurs affectives et pathétiques du cinéma parlant, jusque-là complètement récusées par Barthes. Finalement, tout le film, et non plus seulement son silence ou ses intertitres, a su gagner en puissance la dignité d’une œuvre d’art : chaque photogramme, chaque parole, chaque grain de pellicule a le potentiel de devenir le moment privilégié qui soulignera la contingence du film en entier au profit de la nécessité absolue d’un fragment tourné à la fois vers la redécouverte du passé et l’exploration d’une vie autre.
Certes, placé dans un état de sensibilité extrême suite à la mort de sa mère, l’auteur du Journal de deuil a tendance à faire flèche de tout bois : les réminiscences ne cessent de se multiplier, et pas seulement grâce aux médiations des images techniques. Néanmoins, on sait que la grande découverte du journal sera la nécessité de faire un livre sur la photographie [23], de même que, par leur insistance, les références cinématographiques viennent à incarner un trait essentiel de l’entreprise barthésienne. Bref, elles ne sont pas contingentes. En effet, tout le Journal de deuil est tourné vers des moments d’extraction d’un détail dans le flux apathique de la vie, et ce, jusqu’à la révélation que la seule façon de transcender le deuil sera de retrouver l’origine de l’amour de l’être aimé, c’est-à-dire la photographie de la mère lorsqu’elle était encore un enfant, fragment le plus intense qui soit, sur lequel ne cesse de buter la littérature – mais, ce faisant, elle tissera un roman autour de ce centre absent. Ainsi, cet autre exemple cinématographique, visuel cette fois, peut-être encore plus évocateur que celui de la poudre de riz :
Hier soir, film stupide et grossier, One Two Two. Cela se passe à l’époque de l’affaire Stavisky, que j’ai vécue. En général, cela ne me rappelle rien. Mais tout d’un coup, un détail de décor me bouleverse : simplement une lampe à abat-jour plissé, cordelière pendant. Mam. en faisait – comme elle avait fait du batik. Tout elle me saute au visage. (JD, p. 136)
Que le film soit « stupide et grossier » ajoute évidemment beaucoup à l’effet que provoquera la découverte du détail transcendant. Plus encore, ce passage est particulièrement évocateur car il illustre le projet général du Journal de deuil, qui est, comme nous l’avons souligné d’entrée de jeu, de réconcilier le temps du deuil et le temps du récit, ou, pour le dire autrement, de faire poindre la cime du deuil à même le théâtre du langage et de la culture. Rédigée dans une forme voisine du haïku, cette note le résume bien :
Désespoir : le mot est trop théâtral, il fait partie du langage.
Une pierre. (JD, p. 122; l’auteur souligne)
Comme le souligne justement Éric Marty dans Roland Barthes, la littérature et le droit à la mort [24], le Journal de deuil se caractérise en effet par une forme de rébellion contre la culture, la science et l’intellectualisme, bref, contre tout ce qui prétend savoir nommer le deuil (l’inscrivant par là dans un faux récit). Cette lutte contre le classement et la désignation du deuil se fait de manière globale par une critique des systèmes et des discours savants, mais aussi de manière locale, tandis que Barthes évoque certaines oppositions qui l’éloignent de ses proches. Par exemple ici, où derrière ce « AC » se trouve bien sûr Antoine Compagnon :
Expliqué à AC, dans un monologue, comment mon chagrin est chaotique, erratique, ce en quoi il résiste à l’idée courante – et psychanalytique – d’un deuil soumis au temps, qui se dialectise, s’use, « s’arrange ». Le chagrin n’a rien emporté tout de suite – mais en contrepartie, il ne s’use pas.
— À quoi AC répond : c’est ça, le deuil. (Il se constitue ainsi en sujet du Savoir, de la Réduction)
— j’en souffre. Je ne puis supporter qu’on réduise – qu’on généralise […]. (JD, p. 81 ; l’auteur souligne)
Réduire, généraliser c’est précisément ce que tend à faire le film aux images et aux sons, mais c’est aussi ce à quoi le sujet en deuil s’oppose, en multipliant les réminiscences où se mélangent un passé pur et l’espoir d’un temps autre. Ici, encore :
(Vu un film de Hitchcock, Les Amants du Capricorne)
Ingrid Bergman (c’était vers 1946) : je ne sais pourquoi, je ne sais comment le dire, cette actrice, le corps de cette actrice m’émeut, vient toucher en moi quelque chose qui me rappelle mam. : sa carnation, ses belles mains si simples, une impression de fraîcheur, une féminité non narcissique… (JD, p. 184 ; nous soulignons)
Je ne sais comment le dire…, c’est là tout le projet du livre sur la photographie, dont la naissance accompagne l’enquête sur les images cinématographiques que mène parallèlement Barthes : « Photo du Jardin d’Hiver : je cherche éperdument à dire le sens évident. (Photo : impuissance à dire ce qui est évident. Naissance de la littérature) » (JD, p. 180). Grâce à la dimension a-culturelle de certaines images qui s’imposent au sujet comme autant de vérités, la littérature, pourtant impuissante devant le deuil, va renaître de ses cendres.
Néanmoins, ce phénomène est loin d’être réservé à la photographie du Jardin d’Hiver. Dans le Journal de deuil, il apparaît au contraire chaque fois qu’il est question de cinéma. Au même titre que, contre les normes générales de la société, le deuil impose à la littérature une recherche impossible du mot juste, de la conjoncture narrative qui permettrait de dire l’émotion du deuil, son moment, face au film, Barthes cherche les images nécessaires : mention de la poudre de riz, la cordelière d’un abat-jour, les mains d’une actrice. Opposées à la fois au théâtre des mots et au flux ordinaire des images, les réminiscences visuelles permettent à Barthes de sortir le deuil de la culture. Dans cette optique, le cas du cinéma est peut-être encore plus intéressant que celui de la photographie, puisque le film, plus que la photo de famille, appartient à la culture, voire à la culture de masse. Contrairement à plusieurs pages de La Chambre claire, le Journal de deuil ne va ainsi jamais opposer cinéma et photographie, préférant placer toutes les images sur le même plan. Même si l’enquête avorte rapidement et qu’elle ne mène à aucune théorie ontologique sur la nature des images cinématographiques, on peut tout de même défendre l’idée que, aux côtés des passages de La Préparation du roman que nous avons relevés, le Journal de deuil va sans doute plus loin que La Chambre claire dans sa considération du potentiel émotif et des courts-circuits temporels propres au film. Pour faire son deuil, il faut être capable non pas de revivre encore et toujours le même passé, mais d’atteindre une image qui soit à la fois complètement neuve et pourtant déjà vécue, un « ça-a-été » tourné vers l’avenir.
Dans l’écriture de vie qui caractérise l’œuvre du dernier Barthes, les médias, leurs images et leurs sons peuvent devenir synonymes d’une nouvelle anamnèse : une nouvelle biographie du sujet. Écrire la vie, et, en particulier, écrire le pathétique d’une vie après la mort d’un être cher, est nécessairement un geste subversif qui demande de se positionner contre la gestion que demandent la culture et la société suite à un tel événement. Plus encore, le chagrin de la disparition demande au sujet de revoir ses habitudes et de repenser ses propres idées reçues. C’est ainsi que, en plaçant plusieurs des plus beaux moments du Journal de deuil sous le signe du cinéma, Barthes se fait violence et fait violence à l’écrit. À quelques exceptions près, la littérature ne permet pas d’emblée de vivre son deuil et encore moins de transformer la répétition du passé en possibilité d’avenir. Pour qu’elle y arrive, il faut passer par le détour et la médiation des images. Si omniprésentes qu’elles finissent presque par devenir invisibles, les images photographiques et cinématographiques peuplent nos existences sans même que nous y pensions. La plupart du temps, nous vivons nos vies à l’instar de la succession monotone des scènes d’un film ou du défilement des pages d’un album. « Je dirai, selon ma sensibilité en tout cas, que la civilisation des médias, des mass media, se définit à mes yeux par le rejet (agressif) de la nuance » (PR, p. 107) dira d’ailleurs Barthes dans La Préparation du roman. Les médias, dans leur usage habituel, sont à l’image de ce tout monotone, homogène. Cette monotonie n’est pas sans rappeler le temps du deuil, « durée, tassée, insignifiante, non narrée, morne, sans recours : vrai deuil insusceptible d’aucune dialectique narrative » (JD, p. 60). Un des premiers pas pour sortir de la mauvaise répétition – « stase, engorgement, récurrences répétitives de l’identique » (JD, p. 154) – consiste justement à faire de ces images omniprésentes et obsédantes qui nous entourent des leviers pour atteindre une autre sphère de l’existence et de l’attention au monde, pour nous faire entrer dans un récit fait de suspense, de retournements et de révélations. Ce que suggère Barthes avec les expériences filmiques et photographiques du Journal de deuil, c’est qu’il faut détourner de manière personnelle et intempestive cette continuité absolue qu’est le temps des médias, temps de la culture – et, enfin, temps du deuil –, pour ensuite utiliser cette sensibilité nouvelle que le sujet aura gagnée au passage afin de mettre au défi la littérature et ainsi la forcer à réconcilier deuil et récit, passé et futur, écriture et vie. L’histoire de ce que l’on aime – et de ceux que l’on aime [25] – se fait toujours au futur, même si elle demande une reprise intégrale des moments du passé qui, pour nous, ont fait sens. Le récit cinématographique permettant d’offrir au deuil une dialectique narrative n’est pas à trouver dans le mouvement continu des images : tel l’éclair du punctum photographique, il crève l’écran pour nous sauter au visage et éblouir notre sensibilité par sa nuance, dont l’explication nécessitera tout un roman.
Les intermittences de l’avenir
« Telle est la plage étroite – du moins pour le sujet qui parle ici – où se joue la sidération filmique, l’hypnose cinématographique : il me faut être dans l’histoire (le vraisemblable me requiert), mais il me faut aussi être ailleurs : un imaginaire légèrement décollé, voilà ce que […] j’exige du film et de la situation où je vais le chercher [26] ». Dans ces lignes de « En sortant du cinéma », l’auteur semble anticiper la figure spectatorielle qu’il dessinera ensuite dans le Journal de deuil. Pour Barthes, le spectateur ne doit pas « coller » au film, au récit continu, vraisemblable. Plutôt, il doit arriver à s’inscrire dans un régime d’attention flottante et achoppée, un mode de perception fait d’aller-retour entre différentes strates de l’existence.
Barthes sera d’ailleurs amené à revivre en tant qu’acteur ce sentiment qu’il a d’abord expérimenté à titre de spectateur. Dans La Préparation du roman, il reviendra sur sa participation au tournage du film Les Sœurs Brontë (André Téchiné, 1979) : « Je savais vaguement comment on tournait un film mais je ne savais pas réellement et là j’ai vu l’espèce de distance absolument astronomique qui existe entre les opérations de prises de vue et le résultat final […]. Il faudrait parler longuement de cela » (PR, p. 161). Ce que Barthes découvre, c’est la discontinuité absolue et le constant mélange des temporalités dans lesquels le film se réalise. En somme, rien n’est plus achoppé qu’un film. Et, pourtant, rien n’est plus égal que son résultat final. Si la production du film est un casse-tête, le résultat, lui, est lisse comme un miroir. Construit sur un éclectisme de durées et d’espaces, le film donne l’illusion d’un récit plein et constant, dans lequel tout est également présent. L’exemple choisi par Barthes pour soutenir cette idée est des plus intéressants :
Lorsque le cinéma photographie un personnage, il ne peut pas ne pas faire que nous connaissions la façon dont ce personnage se coupe les ongles de la main par exemple. Tandis que si on nous parle de la vie de Hölderlin, il faut que le texte biographique prenne sur lui, assume de dire que dans la période finale de sa folie il portait des ongles exagérément longs. Si nous devions filmer la vie de Hölderlin, nous serions absolument obligés de le dire, nous ne pourrions pas choisir de le dire ou de ne pas le dire. (PR, p. 165)
C’est bien là un paradoxe fécond : reprenant le noème photographique du « ça-a-été », le cinéma est condamné à tout dire, mais, en même temps – ou, pour être exact : dans un autre rapport au temps –, il s’agit d’un art qui repose entièrement sur la discontinuité. Lors de la projection, le film semble se gérer lui-même, car tout est sur le même plan. Tout est là, sous nos yeux. Mais, en fait, il y a bel et bien une folie de gestion – une aveniro-manie – qui est à l’œuvre « derrière » les images du cinéma. Fait de strates de temps hétérogènes, réalisé au jour le jour mais dans un désordre temporel savamment orchestré, le film demande une gestion de l’avenir analogue à celle de l’écrivain qui travaille à son roman et qui doit sans cesse lutter contre la société pour gérer son avenir – à l’image, d’ailleurs, du sujet en deuil qui se rebelle contre la société et la culture.
« “Je ne peux pas aller à ce vernissage ou à cette projection de film, excusez-moi, j’ai un roman à faire.” […] Il faut une société, ou un milieu qui reconnaisse l’œuvre comme importante, vitale » (PR, p. 402). Au-delà de l’opposition entre le photographe et le film, du silence plein propre au cinéma muet, du rapport entre le biographème et le film troué par l’écriture, au-delà, aussi, des réminiscences visuelles ou sonores du spectateur, de son décollement de la lettre du récit pour atteindre un détournement personnel des codes de l’image, le cinéma, dans l’œuvre du dernier Barthes, est donc aussi le synonyme d’une forme privilégiée de gestion, dans laquelle le romancier retrouve les spécificités et les accrocs de son propre travail. Art collectif, art de la gestion, le cinéma, contrairement au roman, vient d’emblée avec un emploi du temps. Chaotique, son rapport à l’avenir n’en est pas moins rythmé. D’emblée, ses fragments font sens, s’inscrivent dans une structure générale, un plan d’ensemble. Oui, le romancier en devenir qu’est le dernier Barthes a besoin du cinéma, non seulement pour les moments pathétiques que le film lui procure afin de commencer à transformer son deuil en œuvre d’art, mais, surtout, pour comprendre que l’œuvre, par essence asociale, est tout de même possible dans la société, que le temps, par nature fuyant et axé sur la répétition, peut être géré, conquis. À la fois par son détournement et dans sa fabrique, le cinéma, contre toute attente, montre à Barthes – et à nous tous – que l’avenir est encore possible, dans un mélange de folie, de gestion et de création.
[1] Roland Barthes, Journal de deuil, texte établi et annoté par Nathalie Léger, Paris, Seuil, coll. « Point : Essais », 2009, p. 16. Dorénavant « JD ».
[2] Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-79 et 1979-80), texte annoté par Nathalie Léger, transcription des enregistrements par Nathalie Lacroix, avant-propos de Bernard Comment, Paris, Seuil, 2015. Dorénavant « PR ». On soulignera aussi l’existence d’une version antérieure du cours, basée sur les notes manuscrites de l’auteur : La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Seuil-IMEC, coll. « Traces écrites », 2003.
[3] On pourrait noter que ce renversement se traduit aussi par le refus chez Barthes d’utiliser systématiquement le terme de « deuil », qu’il juge ancré dans les codes et les rituels de la société. Au « deuil », il préférera le mot « chagrin » : « Ne pas dire Deuil. C’est trop psychanalytique, ne suis pas en deuil. J’ai du chagrin ». (JD, 83). Le passage du deuil au chagrin répond d’un processus similaire à celui qui transforme la gestion de la disparition en préparation du roman.
[4] Le cours est consultable ici : https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2009-01-06-16h30.htm. De Compagnon sur l’œuvre du dernier Barthes, voir également « Le Roman de Roland Barthes », Revue des sciences humaines, nos 266-267, 2003, p. 203-231, de même que le dernier chapitre de Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 2005.
[5] Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à nos articles « “J’ai un livre en désir”. Les chemins proustiens de l’Œuvre à faire dans La Préparation du roman de Roland Barthes », Revue d’études proustiennes, no 6, 2017, p. 491-520 et « “De grands deuils momentanés”. Les fragments du sujet écrivant dans La Fugitive et La Préparation du roman », Revue d’études proustiennes, no 8, 2018 (à paraître).
[6] Roland Barthes, La Chambre claire, dans Œuvres complètes V. Livres, textes, entretiens (1977-1980), nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, p. 785-892.
[7] Nous mettons ainsi volontairement de côté La Chambre claire, qui, évidemment, comporte son lot d’analyses sur le cinéma, la photographie et le temps des images. Précisément, nous avons préféré une réflexion plus indirecte, pour voir en quoi les autres écrits de Barthes, contemporains de la rédaction de son dernier ouvrage, offraient des voies analogues mais en même temps différentes de celui-ci. Avec le Journal de deuil et La Préparation du roman, nous nous positionnons dans les marges de La Chambre claire, sans pour autant nous contenter de redites ou de variantes moins étoffées des mêmes propos. Surtout, la mise en comparaison de ces deux textes permet de faire le pont entre deux modes bien distincts d’écriture – journal et cours –, qui, pourtant, s’occupent des mêmes préoccupations par rapport à l’avenir et aux images qui permettent de l’habiter.
[8] Mentionnons d’emblée notre dette à l’égard de l’essai important de Philip Watts, Le cinéma de Roland Barthes, suivi d’un entretien avec Jacques Rancière, traduit de l’américain par Sophie Queuniet, Saint-Vincent-de-Mercuze, De l’incidence éditeur, 2015. On peut néanmoins souligner que, contrairement à Watts, nous ne tentons pas de relire toute l’œuvre de Barthes depuis les questions qu’elle pose au cinéma – ou que le cinéma lui pose –, mais, modestement, de suivre le mouvement cinématographique des images pour éclairer l’opposition du deuil et du récit sur laquelle reposent les derniers écrits de Barthes (auxquels Watts n’avait pas accès). Voir aussi Jean Narboni, La nuit sera noire et blanche. Barthes, La Chambre claire, le cinéma, Paris/Nantes, Les Prairies ordinaires/Capricci, 2015.
[9] Du point de vue de l’histoire littéraire, il est à noter que Barthes pense sans doute ici à La Vie de Rancé, texte souvent évoqué dans La Préparation du roman et qu’il a déjà préfacé. Sur le silence de Rancé et sa fascination pour Chateaubriand, voir également Alain Corbin, Histoire du silence. De la Renaissance à nos jours, Paris, Albin Michel, 2016.
[10] D’un point de vue historique, on pourrait d’ailleurs nuancer cette position, en défendant au contraire l’idée que le cinéma n’a jamais vraiment été muet. Sur ce sujet, voir Martin Barnier, Bruits, cris, musiques de film. Les projections avant 1914, préface de Rick Altman, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire : Cinéma », 2010.
[11] Ce mythe est bien analysé par Jacques Aumont dans Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « 21esiècle », 2007.
[12] Bien que cela ne soit pas notre propos, notons qu’il est possible de rapprocher la pensée cinématographique de Barthes de celle de Walter Benjamin avec son célèbre article « L’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique », auquel nous empruntons le terme d’« aura ». Voir Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », dans Œuvres III, traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rush, Paris, Gallimard, coll. « Folio : Essai », 2000, p. 269-316.
[13] Roland Barthes, « Le troisième sens », dans Œuvres complètes III. Livres, textes, entretiens (1968-1971), nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, p. 488.
[14] Ibid., p. 502.
[15] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, dans Œuvres complètes III. Livres, textes, entretiens (1968-1971), op. cit., p. 699-868.
[16] Ibid., p. 706. L’auteur souligne.
[17] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, dans Œuvres complètes III. Livres, textes, entretiens (1968-1971), op. cit., p. 705.
[18] Dans cette réflexion, Barthes anticipe certains aspects de ce que l’on nomme aujourd’hui l’« archéologie des médias ». Voir entre autres Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, trad. Frédérique Vargoz, Dijon, Presses du réel, coll. « Médias/Théories », 2018 et André Gaudreault et Philippe Marion, La fin du cinéma ? Un média en crise à l’ère du numérique, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/Arts visuels », 2013.
[19] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, dans Œuvres complètes III. Livres, textes, entretiens (1968-1971), op. cit., p. 835.
[20] Id.
[21] Roland Barthes, La Chambre claire,dans Œuvres complètes V. Livres, textes, entretiens (1977-1980), op. cit., p. 842. L’auteur souligne.
[22] Ce paradoxe de la réminiscence proustienne qui serait à la fois le « en soi » de Combray et une image nouvelle de l’enfance est analysé par Gilles Deleuze dans Proust et les signes, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige : Grands Textes », 1995. Soulignons par ailleurs que, sur la question du devenir, Barthes lisait aussi régulièrement un autre ouvrage de Deleuze, soit Nietzche et la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige : Grands Textes », 1983.
[23] Nécessité paradoxale, puisque La Chambre claire est aussi une commande. Voir Jean Narboni, La Nuit sera noire et blanche, op. cit.
[24] Éric Marty, Roland Barthes. La littérature et le droit à la mort, Paris, Seuil, 2010.
[25] Sur ce sujet, voir, bien sûr, « On échoue toujours à parler de ce qu’on aime » dans Œuvres complètes V. Livres, textes, entretiens (1977-1980), op. cit., p. 906-914.
[26] Roland Barthes, « En sortant du cinéma », dans Œuvres complètes IV. Livres, textes, entretiens (1972-1976), nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, p. 780.