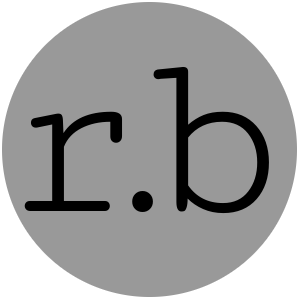À Geneviève, chez qui j’ai écrit les premières pages de cet article.
Et merci à Adrien Chassain.
« Heureux les fous car ils sont modernes »
Roland Barthes
Une table ronde et une controverse au carré
La pensée de Roland Barthes était tellement ondoyante, comme un tissu diapré virevoltant autour d’une danseuse andalouse, ou comme les camaïeux qu’il a évoqués dans son cours sur le Neutre, qu’il est loisible de tenir à son sujet des propos tout à fait contradictoires sans pour autant se fourvoyer. Soit deux lecteurs s’opposant frontalement quant à leur interprétation de son œuvre : il se peut qu’ils aient tous deux raison. Aussi, comme le note Claudia Amigo Pino : « Il est possible de classer l’œuvre de Barthes en mille parties : on peut parler du Barthes sémiologue, du Barthes hédoniste, du Barthes critique… Mais il est également possible de classer ses lecteurs […]. » [1]
Tentons l’expérience avec la table ronde qui s’est tenue, lors du colloque « Avec Roland Barthes », au Collège de France, le 13 novembre 2015, et qui réunissait Alain Finkielkraut et Marc Fumaroli ainsi que les trois organisateurs, Antoine Compagnon, Éric Marty et Philippe Roger [2]. Bien que le ton des échanges y soit tout à fait affable, des points de vue contradictoires s’y exposent et chacun trouve des arguments pour défendre habilement sa position, force citations à l’appui. Il est vrai qu’il en va ainsi de toute interprétation, qui consiste toujours d’abord à couper dans un texte, comme le souligne Pierre Bayard :
Théoriser à propos d’un texte, c’est y relever un certain nombre d’éléments qui ne coïncideront jamais exactement avec ceux qu’aura choisis une autre approche critique. Ce n’est donc pas avoir affaire avec la totalité du texte, mais avec une partie de celui-ci, déjà hautement personnalisée par les découpes dont elle est le produit. [3]
Il n’empêche que certaines pensées semblent se prêter mieux que d’autres à la polysémie exégétique. À ce propos, les mots que Barthes a employés au sujet de Racine s’appliquent sans doute à lui-même mieux qu’à la plupart de ses contemporains :
Son génie […] ne serait alors situé spécialement dans aucune des vertus qui ont fait successivement sa fortune […], mais plutôt dans un art inégalé de la disponibilité, qui lui permet de se maintenir éternellement dans le champ de n’importe quel langage critique. [4]
En vertu de la « disponibilité » de Barthes, l’auditeur de la table ronde du Collège de France, après chaque prise de parole, a envie de se dire : « Ce n’est pas faux… »
De quoi est-il question ? Le débat s’y construit spontanément autour d’une double antonymie – c’est-à-dire de deux questions qui ont suscité des réponses diamétralement opposées. Ces questions implicites pourraient être, me semble-t-il, formulées ainsi : d’une part, « Roland Barthes est-il toujours resté fidèle à lui-même ou a-t-il changé son fusil d’épaule à la fin de sa vie ? » Et, d’autre part, « Roland Barthes est-il moderne ou antimoderne ? » Alain Finkielkraut considère qu’un second Barthes, tourné vers le passé, « a trahi » le premier Barthes, « porte-drapeau » des modernes croyant au « progrès péremptoire » : en conclusion, déclare Alain Finkielkraut en usant d’une jolie formule, Barthes est donc passé du « progrès » au « regret » et de Prométhée à Orphée. Marc Fumaroli défend un point de vue similaire : à un premier Barthes, moderne, marxiste et scientiste, a succédé un second Barthes qui laissait libre cours à sa subjectivité. En face, Antoine Compagnon et Éric Marty plaident pour l’unité de l’œuvre : il n’y a qu’un seul Barthes, qui tourne parfois sur lui-même au gré de la fameuse spirale de Vico, et qui, depuis toujours, a éprouvé une vive tension entre le passé et le présent. Cependant, quant à la modernité de Barthes, Compagnon et Marty ne semblent pas être tout à fait d’accord entre eux. Compagnon, contraint de jouer en même temps le rôle de participant et de modérateur, a la courtoisie de très peu se donner la parole, mais on comprend à demi-mot qu’il considère Barthes comme un éternel antimoderne : il fait d’ailleurs pudiquement référence à son ouvrage sur le sujet (dont nous reparlerons). Commentant le propos de Finkielkraut, il déclare en effet : « J’y reconnaissais le Barthes que j’ai eu le malheur de qualifier, jadis ou naguère, d’“antimoderne”. » [5] Selon Éric Marty, au contraire, Roland Barthes est demeuré jusqu’au bout fidèle à la modernité : même dans ses derniers écrits, l’auteur de La Chambre claire a cherché la nouveauté, ne fût-ce qu’à travers le fameux motif de la « Vita Nova » ou par le biais du désir d’un nouveau type d’écriture qui ouvre le cours consacré à La Préparation du roman. Et si, par ailleurs, déclare encore Marty, il se met soudain, à la fin de sa vie, à défendre les classiques, c’est parce que son « hypersensibilité au présent » lui a fait comprendre, avant tout le monde, que les temps changeaient, à tel point que les classiques devenaient fragiles et, donc, neufs. Barthes, d’après Marty, est fidèle à lui-même : c’est la société qui mute et non lui.
Il me reste à évoquer la position de Philippe Roger, plus difficile à circonscrire dans la mesure où le directeur de Critique, qui semble détester la polémique, préfère demeurer en retrait durant le débat. Il semble néanmoins penser l’œuvre de Barthes comme un tout, ce que confirment ses écrits. Dans son principal ouvrage, nous pouvons en effet lire cette déclaration : « Il apparaît en effet bien peu pertinent de prétendre isoler un Barthes de la nomenclature, un Barthes de la déconstruction, un Barthes de la phénoménologie ; et assez vain de vouloir repérer la trace de coupures épistémologiques supposées […]. » [6] Ailleurs, il tient des propos nuancés allant dans le même sens : « Sans rupture, ni coupures, les dernières années marquent pourtant un subtil et très prudent déplacement : un changement moins d’intentions que d’intentionnalité. »[7] Quant à la seconde question, celle de la modernité de Barthes, Roger se montre tout à fait irénique durant le débat et évite de prendre position. Mais, dans un de ses articles, que nous évoquerons plusieurs fois, « Barthes post-classique », il se range du même côté que Marty, même si c’est, à nouveau, de façon très nuancée. Nous y lisons ceci : « Barthes n’a pas toujours eu la modernité malheureuse, tant s’en faut, et c’est sans peine, le plus souvent qu’il s’en montre “solidaire”. » [8] Ou : « Car s’il est “tout d’un coup”, comme il le dit en 1979, “devenu indifférent” à Barthes de “ne pas être moderne” […] il n’a jamais cessé de tenir la modernité pour une valeur, en tant que rapport vivant, “brûlant” à la littérature. » [9] Et surtout, Roger donne des positions du dernier Barthes une justification qui ressemble à celle de Marty durant le débat :
L’ennemi, désormais, en cette extrême fin des années 1970, ce n’est plus la sorcière Doxa, ni le « monstre de la tautologie »: c’est la « marée de merde » – dixit Flaubert – qui pollue la parole et menace de submerger l’écriture ; c’est, politiquement parlant (car Barthes en février 1980 n’a nullement renoncé à penser politiquement et historiquement la vie de la langue et le sort de l’écriture), la nouvelle alliance, inverse de celle ébauchée avant 1848 entre le prolétariat et la petite bourgeoisie républicaine : la malsaine alliance de la grande bourgeoisie et de la petite, la première déléguant à la seconde le pouvoir culturel pour mieux conserver le pouvoir économique et politique. [10]
Les différentes prises de position des uns et des autres peuvent être formalisées en un « inévitable » (comme aurait dit Genette) tableau à double entrée – que voici :
| Le dernier Barthes est antimoderne | Le dernier Barthes est moderne | |
| Barthes a changé de position | Finkielkraut, Fumaroli | / |
| Barthes n’a pas changé de position | Compagnon | Marty, Roger |
Il serait loisible de compléter ce tableau par la lecture des multiples commentateurs de Barthes. Sans être exhaustif, j’évoquerais rapidement deux prises de position intéressantes : celle de Jean-Marie Schaeffer et celle de Tiphaine Samoyault. Le premier déclare qu’à ses yeux, Barthes a toujours été structuraliste, il l’était déjà dans les Mythologies et le sera encore dans La Chambre claire : « Rien dans vos écrits tardifs ne témoigne à mon sens de rupture avec le moment “structural” qui n’aurait été en somme qu’un moment d’égarement. » [11] Quant à Tiphaine Samoyault, elle souligne une forme de cohérence dans la « disposition au changement » qui s’exprime plus au gré d’un « mouvement de reprise / déprise » que par des fractures [12].
Toujours est-il qu’une case reste vide : celle selon laquelle Barthes aurait évolué en quittant une position antimoderne pour devenir le chantre de la modernité. La disponibilité de Barthes est telle qu’il n’est pas tout à fait impossible de défendre cette position : il suffirait d’opposer le texte intitulé « Plaisir aux classiques » de 1944 à Sollers écrivain paru en 1979, soit un an avant sa mort, et le tour serait joué !
Mais telle n’est pas mon opinion : il ne me reviendra pas l’honneur de remplir la case vide, bien qu’un tel comblement est toujours satisfaisant pour l’esprit. Pire : ma proposition ne correspond à aucune case du tableau. Pourtant, s’il fallait l’y faire entrer de force, c’est bien aux antipodes de celle de Compagnon qu’elle devrait se situer. Je crois, en effet, d’une part, que Barthes a quelque peu changé de positions et que, d’autre part, il était, durant la majeure partie de sa carrière, fondamentalement moderne. Avant de m’en expliquer, peut-être est-il utile de commenter la position inverse de la mienne, c’est-à-dire précisément celle d’Antoine Compagnon, qui est développée dans son ouvrage de 2005, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes.
Antoine Compagnon et le fantôme de Roland Barthes
Pourquoi diable, quand il s’agit d’un grand contemporain, prend-on plus souvent la parole en cas de désaccord que d’accord ? Antoine Compagnon est lucide, intelligent, cultivé, perspicace, il a lu et relu Barthes – que, de surcroît, il a connu personnellement. Dans mon petit parcours de lectures personnel, ce penseur a compté énormément : j’ai lu, à l’époque, Les Cinq Paradoxes de la modernité et Le Démon de la théorie comme des ouvrages relançant, grâce à une synthèse éclairante, une discipline qui avait déjà tendance, durant les années 1990, à se replier sur son glorieux passé. Je continue à lire ses livres avec grand intérêt et je podcaste assidûment ses cours au Collège de France. Compagnon, dis-je souvent à mes étudiants, c’est le patron ! Sur quelle légitimité pourrais-je m’appuyer pour me permettre de le contredire ? Je ne me crois certes pas plus malin que lui ! D’ordinaire, qu’il parle de Montaigne, de Proust, de Baudelaire, de l’année 1966 ou de Joseph de Maistre, Compagnon me convainc tout à fait. J’adore sa façon de voir la théorie « non pas comme système de réponses, mais comme cadre de questions »[13]. Il n’y a que lorsqu’il évoque Roland Barthes que je lui résiste. Et cela à tous les coups : que Compagnon réfute la notion du fascisme de la langue [14], qu’il défende, même si c’est de façon très nuancée, Picard dans la fameuse polémique sur Racine et la Nouvelle Critique [15], qu’il fasse le bilan de l’œuvre dans son livre de souvenirs [16] et dans ses entretiens avec Amadieu [17] ou qu’il classe son ancien professeur parmi les antimodernes. D’où vient cette résistance ? Je devine là une piste de réflexion féconde, mais qui me mènerait trop loin, assurément. Notons seulement que, dans un très beau passage de L’Âge des lettres, Compagnon raconte plusieurs rêves mettant en scène le fantôme de Barthes et se pose cette question hugolienne : « Est-ce lui qui m’a trahi ou bien est-ce moi qui l’ai trahi ? » [18] Il y répond, avec honnêteté, en fin de paragraphe, passant du rêve à la réalité : « Mes travaux ont aussi pris une tournure plus académique comme j’avançais dans la carrière. Pourtant je suis persuadé que nul ne lui a été plus fidèle. »[19]
Barthes antimoderne ?
Mais revenons aux Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Bien que je le trouve, une fois de plus, passionnant et hautement instructif, cet ouvrage me pose deux problèmes.
Le premier, qui a déjà été souligné à plusieurs reprises par ses lecteurs, a trait à la grande extension de sens que présentent les différentes acceptions que Compagnon donne au terme « antimoderne », comme le note Yael Dagan : « Une définition aussi large de l’antimoderne permet de considérer presque chaque écrivain sous cette étiquette, et ainsi de vider la catégorie de sa substance. Compagnon ne le nie pas. »[20]
Le second problème est plus profond : les définitions en question ne sont pas seulement trop larges, elles se veulent, au départ, paradoxales, sans pour autant se donner par la suite les moyens de le demeurer. Dès la page 8, Compagnon note en effet : « Les antimodernes – non les traditionalistes donc, mais les antimodernes authentiques – ne seraient autres que les modernes, les vrais modernes, non dupes du moderne, déniaisés. »[21] Les antimodernes sont les modernes : pur paradoxe. Pourquoi les appeler ainsi, alors ? Pourquoi contredire le sens du préfixe « anti- » ? Pourquoi pas, après tout ? A priori, je veux bien suivre ce type de pensée, souvent stimulant, et m’y perdre avec délectation, mais je m’en étonne quelque peu : ce n’est pas le genre de la maison. Compagnon n’est pas Blanchot [22]. D’ailleurs, l’auteur d’Une question de discipline ne s’installe guère durablement dans l’orbe du paradoxe. Celui-ci se résout en effet au fil de l’ouvrage : l’antimoderne ne reste pas longtemps le moderne déniaisé, il devient bientôt une sorte d’intermédiaire entre le moderne et le traditionaliste pur : « La distinction entre le moderne et l’antimoderne étant par définition relative, on est toujours le moderne de l’un et l’antimoderne de l’autre. Chateaubriand, le premier des antimodernes à nos yeux, est le pire des modernes aux yeux de Maurras […]. »[23] Mais si l’antimoderne est un chaînon manquant, un moderne soft, il est également, peut-on inférer, un traditionaliste tout aussi soft. La pente est alors savonnée : à la façon dont le bon sens, comme Compagnon l’a si bien expliqué, a repoussé au loin, au cours des années 1980, dans les études littéraires, le fameux « démon de la théorie » des années 1960, le sens premier du terme reprend sa place dans le texte, l’antimoderne étant simplement contre le moderne, c’est-à-dire réactionnaire. Ainsi, Balzac, qui, à la première page du livre, fait partie de la longue liste des antimodernes, ne semble nullement nuancé dans le portrait qu’en brosse Compagnon : pour la religion, pour la famille, pour la monarchie, contre la démocratie, etc. L’auteur de la Comédie humaine est ensuite rapproché de Bourget, qui lui-même est alors comparé à… Maurras [24]. La boucle est bouclée : Maurras le réactionnaire qui s’opposait à l’antimoderne Chateaubriand est donc l’égal de Balzac l’antimoderne. Les deux catégories finissent donc par se recouvrir, l’antimoderne ayant glissé du poste de vrai moderne à celui du moderne nuancé avant de finir dans la peau du vrai réactionnaire.
Et si l’on acceptait au départ de rapprocher Barthes de Chateaubriand, on se demande tout de même, à ce stade, pourquoi un homme de gauche, qui a flirté avec le marxisme et pourfendu la petite bourgeoisie, serait rangé parmi les royalistes et les antidémocrates de la droite dure.
Le même parcours terminologique descendant reprend dans le chapitre consacré à Barthes. Le propos s’ouvre sur le même paradoxe de principe : « Barthes a toujours été un antimoderne, comme tous les vrais modernes. »[25] Mais, très vite, il est question d’une attitude franchement réactionnaire du dernier Barthes : « on se croirait dans Le Figaro »[26], s’exclame Compagnon en commentant un propos, il est vrai, clairement passéiste de La Préparation du roman. Ne finassons pas : Le Figaro ne représente pas pour Compagnon une paradoxale antimodernité qui, à force d’ambiguïté dans le clair-obscur, atteindrait la lumière de la seule vraie modernité qui vaille. Non, dans ce segment de phrase, Le Figaro, pour Compagnon comme pour tout le monde, signifie bel et bien la droite réactionnaire par excellence. Donc de l’antimoderne moderne, le sens du terme a glissé, une nouvelle fois et très rapidement, vers l’antimoderne conservateur.
La thèse que défend Compagnon est in fine la suivante : le dernier Barthes serait antimoderne-réactionnaire-passéiste et là se cacherait la vérité de la pensée de toute une vie. Même si, on l’aura compris, je n’adhère pas à cette lecture, les arguments que Compagnon mobilise sont loin d’être nuls et méritent que l’on s’y attarde.
Antoine Compagnon sait évidemment que Barthes a pourfendu la Sorbonne et défendu Robbe-Grillet puis Sollers. Mais, d’une part, il s’inscrit en faux contre les positions de son ancien ami et, d’autre part, il les justifie par la logique de la polémique ou celle de l’époque :
[…] il a radicalisé au-delà du raisonnable ses positions théoriques en riposte au pamphlet de Raymond Picard contre son Sur Racine […]. Il propose désormais, fût-ce avec des circonvolutions, une sorte de manifeste antimoderne réhabilitant le « romantisme large », généreux, compassionnel et charitable, de Rousseau à Proust. Tournant le dos à la modernité, il redevient classique.
En vérité, le tempérament de Barthes l’a toujours poussé plus vers les œuvres classiques ou romantiques que modernes. Ses rapports avec les avant-gardes ont toujours été ambigus. Aussi son antimodernisme ultime paraît-il moins le produit d’une conversion tardive et d’une rupture tragique qu’un retour aux sources et la reconnaissance d’une ancienne fidélité, désignant après coup la période structuraliste et post-structuraliste, le cheminement avec Tel quel et l’apologie de la Textualité, comme un quiproquo prolongé. [27]
Antoine Compagnon ne manque pas d’arguments pour défendre son point de vue. D’abord, il se base sur les premiers textes de Barthes, écrits au sanatorium, qu’il lit d’une certaine façon et que je lirai, plus loin, d’une autre. Ensuite, il relève la fameuse série des petites phrases de la seconde moitié des années 1970 par lesquelles Barthes exprime ses doutes vis-à-vis de la modernité et de l’avant-garde :
Comment faire route avec l’avant-garde et avec ses parrains quand on a le goût irénique de la dérive ? [28]
Ses idées ont quelque rapport avec la modernité voire avec ce qu’on appelle l’avant-garde […] ; mais il résiste à ces idées. [29]
Et puis, vient peut-être un jour, dans la vie d’un intellectuel, d’un écrivain, où il lui est indifférent d’être d’avant-garde ou pas. [30]
Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne […] rien ne dit que l’avant-garde qui vient […] ne doive réoccuper des positions apparemment anciennes. [31]
[…] je reviens avec soulagement aux Mémoires d’outre-tombe, le vrai livre. Toujours cette pensée : et si les modernes se trompaient ? S’ils n’avaient pas de talent ?[32]
Je commenterai à nouveaux frais certaines de ces assertions infra. Mais précisons déjà que l’inventaire n’est pas complet. Aux remarques énumérées par Compagnon, on peut d’abord ajouter celle-ci, de la même eau : « […] peu à peu en moi s’affirme le désir croissant de lisibilité. J’ai envie que le texte que je reçois me soient “lisibles”, j’ai envie que les textes que j’écris soient eux-mêmes lisibles. »[33] Il s’agit d’un propos tenu à Cerisy en 1977 lors du colloque organisé à son sujet précisément par le jeune Antoine et qui semble prendre l’exact contre-pied de prises de position antérieures telles que celle-ci, qui date de 1973 : « pour que l’écriture soit manifestée dans sa vérité (et non dans son instrumentalité), il faut qu’elle soit illisible »[34].
Mais surtout, je vais me montrer beau joueur en citant un passage du Journal d’Urt de 1977 qui semble donner raison de façon définitive à l’auteur du Démon de la théorie. Il s’agit d’un inédit, que Compagnon ne devait pas connaître en 2005 au moment de publier ses Antimodernes et que Tiphaine Samoyault a transcrit dans son indispensable biographie. Barthes s’y dépeint comme un homme « du XIXe siècle » et il souligne ses divisions intimes entre, d’une part, son « excessive sensibilité », son « imaginaire affectif » porté par une « éthique de la délicatesse » et, de l’autre, « la modernité, le XXe siècle, les avant-gardes, mon “œuvre” […] certaines pratiques de mes amis → condamné à une œuvre “hypocrite” (thème de l’imposture) ou au sabordage de cette œuvre (d’où l’espace de louvoiement désespéré tenté dans les derniers livres). »[35]
Avantage à Compagnon, donc. Mais on ne peut pas balayer toute l’œuvre avec cette seule citation : d’autres propos de la même époque iront dans un sens diamétralement opposé, comme nous le verrons. Peut-être ne s’agit-il que d’un état d’âme passager, d’une délibération intime, d’un moment de fatigue qui s’empare d’un guerrier d’ordinaire convaincu par la légitimité de son combat – ou du désespoir de l’amoureux abandonné doutant soudain des sentiments de celle qui l’a pourtant tant aimé – et non de la vérité ultime d’une vie et d’une œuvre. Il est clair, par exemple, que Barthes a été, selon le mot d’Éric Marty détournant une formule de Foucault, « un structuraliste positif et heureux »[36] !
Et s’il se tourne bel et bien ici vers le passé, il n’est pas pour autant antimoderne au sens dur du terme : aimer les classiques ne signifie pas être réactionnaire. Tout dépend des causes de cet amour : nul n’est obligé de chercher dans les œuvres du XVIIe siècle, comme le faisait Brasillach, l’ordre, la clarté et la preuve du génie français. Dans l’article déjà cité supra, qui étudie de près le rapport de Barthes aux classiques, Philippe Roger montre que Barthes, dès le fameux « Plaisir aux classiques » écrit au sanatorium, a toujours apprécié les classiques de façon paradoxale, pour leur obscurité et non leur clarté, par exemple. Et qu’en bon disciple de Gide et, plus secrètement, de Valéry, il a, d’emblée, refusé de les embaumer dans le passé. Au contraire, « [s]auver les classiques, pour Barthes, c’est […] les adouber modernes […]. Le mauvais classique est patrimonial […]. Le bon classique est résolument moderne […] »[37].
De toute façon, pour être un bon réactionnaire, il ne suffit pas d’aimer les classiques, il faut encore aux modernes préférer les néoclassiques et les académiques, c’est-à-dire, en usant d’un terme que l’on va souvent retrouver infra, les classiques « figés ». Les auteurs du passé appartiennent à tout le monde : Breton adorait Hugo, Ponge célébrait Malherbe, Beckett lisait Dante et Blanchot commentait Homère. Si être moderne signifie rejeter tout le patrimoine littéraire en bloc, aucun écrivain, jamais, n’a été moderne !
De façon plus générale se pose la question de savoir ce que prouve le questionnement du Journal d’Urt. Que Barthes était hypocrite ou, au contraire, que, jusqu’à la fin de sa vie, il a su se remettre en cause avec honnêteté, témoignant ainsi d’un esprit toujours en recherche ? Un véritable hypocrite est-il en mesure de s’avouer franchement son hypocrisie ? Bernard Comment considère que « l’être-moderne tient à l’interrogation, celle en particulier, chez Barthes, de l’imposture »[38]. Sophisme ? Peut-être. Il faudra par la suite montrer que le cheminement moderniste de Barthes obéit à une logique interne et que ce moment de doute, en 1977, est passager et non emblématique de toute une œuvre.
Antoine Compagnon relève par ailleurs, dans le cours consacré à La Préparation du roman, des propos qui ne m’avaient pas frappé et qui sont, il faut bien le reconnaître, clairement passéistes, notamment au sujet de la mort de la littérature et de l’évolution de la langue française, condamnée à disparaître. Sur ce point, Barthes, d’ordinaire si clairvoyant, se trompait du tout au tout : la France qui, selon lui, ne contenait plus d’écrivain nobélisable a obtenu depuis 1980 trois prix Nobel et l’on peut ajouter un quatrième nom à ceux de Claude Simon (1985), de Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008) et de Patrick Modiano (2104), si l’on compte Gao Xingjan (2000), Chinois qui a pris la nationalité française et dont le théâtre est rédigé dans la langue de Voltaire.
Ensuite, pour prouver que l’ambivalence de Barthes vis-à-vis des avant-gardes ne date pas de la fin de sa vie, Compagnon évoque ses réticences vis-à-vis du théâtre de Beckett et sa préférence pour Brecht, au gré de prises de position « classiquement marxiste » [39]. La démonstration de Compagnon, sur ce point, ne me convainc guère pour plusieurs raisons.
D’abord, Barthes n’est pas complètement passé à côté de Beckett [40]. Ensuite, quand bien même Barthes aurait soutenu Brecht contre Beckett, il n’aurait pas pour autant été antimoderne. Il s’agirait alors simplement de préférer une avant-garde ancienne (L’Opéra de quat’sous date de 1928) à une plus récente (En attendant Godot a été créé en 1952). Car s’il est moins radical que Beckett, Brecht est malgré tout moderne, dans la forme comme dans le propos : il ne faut pas le confondre avec Giraudoux ou avec Anouilh ! Et même si l’on est « classiquement » marxiste, on n’a pas pour autant les honneurs du Figaro ! Certes, Barthes n’a pas soutenu toutes les avant-gardes, il s’est très peu intéressé à Beckett et plus tard il est passé à côté de Perec (alors que celui-ci a suivi ses cours en 1964 [41]), mais il en va ainsi de tous les modernes, qui sont toujours, par nature, selon la logique partisane de l’avant-garde, extrêmement sélectifs. Ce n’est pas parce qu’il se défiait des surréalistes que Queneau pourrait mériter le titre d’antimoderne : il était d’une autre avant-garde que Breton, voilà tout [42] !
Enfin, Compagnon se livre à une très intéressante comparaison entre les figures de Barthes et de Paulhan, qu’il rapproche, au-delà de leurs différences, dans leur rapport à la langue. Le propos repose sur une caractérisation, venue de Paulhan, de l’avant-garde par une haine du langage. Sur ce point, là aussi, Barthes n’aurait été que passagèrement avant-gardiste, contre lui-même, contre son penchant naturel :
Si Barthes douta un temps de la langue au point de l’identifier au fascisme, s’il fut passagèrement alliance avec les misologues, […] il en était revenu à l’époque de son dernier cours […], dont toute la fin est inspirée par un amour ravivé de la langue. [43]
Là aussi, je résiste à Compagnon et, dans une moindre mesure, à Paulhan (auquel il est difficile de répondre, tant, dans Les Fleurs de Tarbes, la Terreur et la Maintenance participent à une ronde infernale et complexe en échangeant sans cesse leur place). L’avant-garde obéit certes à une logique de l’envers et contre tout, de la destruction et de la déconstruction, de la Terreur face à laquelle, d’accord, s’élève le parti de la Maintenance. Mais l’amour est-il nécessairement du côté de la Maintenance ? Rien n’est moins sûr. Les révolutionnaires du langage aiment peut-être celui-ci avec plus de ferveur que les zélés défenseurs de l’immobilité linguistique, même s’il s’agit peut-être d’amour-haine. De part et d’autre, nous avons affaire à des écrivains.
… Je ne vais pas conclure cette discussion impertinente avec le professeur du Collège de France de façon aussi ferme que Bernard Comment, qui déclare : « Rien surtout d’un retour à l’ancien pour se reposer des avant-gardes. Rien, absolument rien, d’un antimoderne (il faut l’affirmer et le rappeler, puisque ce contresens a été commis). » [44] Concédons tout de même à Compagnon la présence, sur la fin, d’un Barthes antimoderne, qui tient quelques propos passéistes au sujet de la langue française et qui met en doute sa propre honnêteté quant à ses combats modernistes, mais c’est à mes yeux un Barthes tout à fait périphérique et minoritaire, même dans La Préparation du roman. Les autres arguments avancés par Compagnon pour figer davantage Barthes dans l’antimodernisme me paraissent, on l’aura compris, tout à fait discutables.
Barthes, la spirale de Vico et la montagne zen
Que faire dès lors des différents propos, cités par Compagnon et ayant frappé plus d’un commentateur, par lesquels Barthes prend ses distances vis-à-vis de la modernité et de l’avant-garde ? Et quels liens ces remarques éparses entretiennent-elles éventuellement avec les fameux textes antérieurs au Degré zéro ?
Ces assertions, à mon humble avis, doivent être mises en relation avec d’autres de la même époque, qui cherchent non à s’écarter de la modernité, mais à trouver un troisième temps au-delà de l’opposition entre celle-ci et le classicisme [45]. Une des petites phrases que cite Compagnon peut sans doute déjà être lue en ce sens. Je la donne à nouveau de façon quelque peu plus large : « […] rien ne dit que l’avant-garde qui vient […] ne doive réoccuper des positions apparemment anciennes étant bien entendu que, sur la spirale de l’Histoire, ces positions reviennent à une autre place » [46]. On a vu que Compagnon y voyait non un dépassement dialectique, mais une trace patente d’antimodernité. Pourtant, il est bel et bien question de l’avant-garde « qui vient ». Et le futur (et non le passé) ne sera pas similaire à l’ancien, il n’en aura que l’apparence. Est-ce si réactionnaire ? Pourquoi ne s’agirait-il pas d’une forme de dépassement dialectique du paradigme ancien versus moderne [47] ? La « spirale de l’Histoire », qu’il appelle plus souvent « la spirale de Vico » (et que j’ai déjà citée ici dans mon compte rendu de la table ronde du Collège de France), ne plaide-t-elle pas en ce sens ? Compagnon juge celle-ci trop « commode : elle permet apparemment de ne renoncer à rien, ou de concilier la nostalgie de l’ancien avec la revendication du nouveau, d’avancer tout en conservant. Mais peut-on avoir le beurre et l’argent du beurre ? There is no free lunch, dit-on en anglais. » [48] Il est vrai que Barthes convoque la spirale de façon obsédante à partir du milieu des années 1970 jusqu’en 1980, mais Compagnon ici l’évacue un peu facilement (il ne donne pas d’autres arguments que ces deux proverbes) : son omniprésence ne traduit-elle pas un désir sincère de trouver un nouveau chemin ? S’agit-il de couvrir une forme de lâcheté (ne pas choisir entre l’ancien et le moderne alors qu’on préfère secrètement l’ancien, selon Compagnon) ou de s’enquérir d’une troisième voie, rendue nécessaire par le figement de l’avant-garde ?
Examinons quelques occurrences de l’usage de cette spirale. D’abord, dans Roland Barthes par Roland Barthes, en 1975, alors qu’elle n’est pas encore attribuée à Vico, elle est sous-entendue dans un fragment consacré à la « Transgression de la transgression »: il s’agit de réintroduire « un brin de sentimentalité » [49] dans le sexuel politiquement libéré : « en fin de compte ce serait l’amour : qui reviendrait mais à une autre place » [50].
Difficile de voir un refus de choisir ou une lâcheté dans ce désir de mâtiner le sexuel d’un brin de sentimentalité. S’il n’est pas encore question de troisième voie, on comprend bien en quoi la sentimentalité, honnie par la modernité depuis la fin du romantisme, peut être transgressive, mais elle l’est uniquement dans le milieu avant-gardiste (elle ne l’est guère dans le monde de la chanson populaire). Et en se réclamant de la transgression, Barthes fait montre d’un souci typique de l’avant-garde. Nous pouvons donc estimer qu’ici, il parle toujours du cœur de celle-ci et non de l’autre bord, celui de la réaction antimoderne. La spirale est nommée ensuite sous l’intitulé « Dialectiques » :
[…] la contradiction des termes cède à ses yeux par la découverte d’un troisième terme, qui n’est pas de synthèse mais de déport : toute chose revient, mais elle revient comme Fiction, c’est-à-dire à un autre tour de la spirale. [51]
Comme le remarque Andy Stafford, Barthes « hésite à proposer la spirale en tant que troisième terme de la dialectique qui manque chez lui, mais qui est maintenant non une synthèse mais un “déport”. » [52] Pourtant, dans les fragments inédits de l’autoportrait de 1975 que l’on trouve dans le Lexique de l’auteur, se lit ceci :
La spirale
Ce temps qui est nécessaire au mouvement de la dialectique peut être celui de toute une vie : il a commencé, adolescent, par subir toute la Doxa littéraire, qui faisait de la vie d’un auteur la matière originelle de son œuvre ; puis il lui a fallu élaborer, pratiquer le paradoxe de cette Doxa, liquider la Biographie ; et ce n’est qu’ensuite qu’il a pu revenir à l’auteur à une autre place, sous forme de traits discontinus de biographèmes : on tourne, en spirale, avec le même objet. [53]
Il s’agit donc tout de même peut-être bien d’une véritable dialectique ! Et la lecture de Compagnon s’évapore ici : nulle hésitation, mais des choix clairs, même s’ils sont dictés en partie par l’histoire. Point de nostalgie antimoderne ici : le biographème n’a en tout cas rien à voir avec l’Histoire de la littérature à la Lanson. Barthes ne veut pas le beurre et l’argent du beurre : le beurre de la Doxa est tout à fait rance sur ses lèvres et le demeurera à jamais. Cependant, le beurre du paradoxe peut rancir lui aussi. Revenons à Roland Barthes par Roland Barthes dans lequel se trouve un fragment comparable, qui retrace lui aussi le parcours rapide de son œuvre : la fausse nature a appelé la démystification des Mythologies, mais celle-ci s’est figée et, en réaction, Barthes a eu recours à la science sémiologique, qui s’est formalisée elle aussi. D’où le Texte. Mais « […] de nouveau le Texte risque de se figer : il se répète, se monnaye en textes mats, témoins d’une demande de lecture, non d’un désir de plaire : le Texte tend à dégénérer en Babil. Où aller ? J’en suis là. »[54]
À nouveau, il me semble que nous avons affaire là à une série d’engagements successifs motivés par une peur panique du figement. Celle-ci trahit une obsession du présent (nécessaire pour se rendre compte que la situation a évolué et que « ça a pris ») et un rejet de la « doxa ». Je pourrais là encore multiplier les citations. J’en retiens deux, une de 1975 puis une de 1977 : « la bêtise n’est pas l’erreur – du côté de l’erreur : la bêtise a besoin du thétique, c’est une vérité copiée, figée : une doxa, la doxa » [55] ; « la fonction de l’intellectuel étant toujours d’aller ailleurs quand “ça prend”. » [56]
En 1975, la spirale semble avoir bien fonctionné du point de vue du critique écrivant face à la question de l’auteur, si l’on en croit le fragment du Lexique : le biographème est un résultat satisfaisant. Mais du côté du Texte et des écrivains, c’est-à-dire de la littérature que Barthes défend et influence, point l’angoisse d’une impasse, d’un figement, d’une dégénérescence en Babil. Et Barthes ne cache pas son désarroi : « Où aller ? J’en suis là. »
Au cours de son cours sur la Préparation du roman, Roland Barthes raconte qu’il reçoit nombre de manuscrits illisibles et avant-gardistes que de jeunes auteurs inconnus lui demandent de lire (c’est ainsi que j’entends la « demande de lecture »).
Il semblerait que ces manuscrits soient évoqués, de façon un peu moins explicite, dans le fragment intitulé « Le chantage à la théorie » de Roland Barthes par Roland Barthes :
Beaucoup de textes d’avant-garde (encore impubliés) sont incertains : comment les juger, les retenir, comment leur prédire un avenir, immédiat ou lointain ? Plaisent-ils ? Ennuient-ils ? Leur qualité évidente est d’ordre intentionnel : ils s’empressent de servir la théorie. Cependant cette qualité est aussi un chantage (un chantage à la théorie) : aimez-moi, gardez-moi, défendez-moi, puisque je suis conforme à la théorie que vous réclamez ; est-ce que je ne fais pas ce qu’ont fait Artaud, Cage, etc. ? – Mais Artaud, ce n’est pas seulement de l’avant-garde, c’est aussi de l’écriture ; Cage a aussi du charme… [57]
Comment Barthes connaîtrait-il ces textes d’avant-garde s’ils sont « impubliés » ? Le « chantage à la théorie » ne signifie-t-il pas « chantage adressé au théoricien » ? En 1975, le théoricien en question commence peut-être déjà à en avoir assez de lire les textes dénués d’écriture et de charme qu’il reçoit pas la poste. Il en aura franchement marre quelques années plus tard.
Certes, Barthes défendra toujours Sollers, mais bientôt, comme le note Tiphaine Samoyault, l’auteur de Paradis et lui seront « convaincus que l’avant-garde est derrière eux et que ce n’est plus là que se poursuit le mouvement de la littérature en marche. » [58] Quoi d’étonnant à cela ? Déjà, en 1961, Barthes, dans un texte qui pourfendait par ailleurs sans cesse le conformisme et l’académisme, se disait que :
Pour être un phénomène régulier, l’avant-garde n’en est pas fatalement un phénomène éternel, ni même constant : il y a eu des époques sans avant-garde, il y aura peut-être de nouveau un jour un art libéré de provocation et d’académisme. […] l’avant-garde est fonctionnellement liée à une conformisme régnant mais non tyrannique. [59]
Toujours est-il que c’est dans le contexte d’une fin des avant-gardes que la spirale va encore être utile à Barthes : pour éviter le figement, pour trouver la troisième voie, la « littérature en marche », il va penser un dépassement dialectique entre le moderne et le classicisme-romantisme. Il sait désormais où aller : il suffit de suivre la spirale :
L’histoire marche en spirale, selon l’image de Vico, des choses anciennes reviennent, mais évidemment elles ne reviennent pas à la même place ; par conséquent il y a des goûts, des valeurs, des « écritures » du passé qui peuvent revenir mais à une place très moderne. [60]
Ou, en se passant cette fois de cette forme géométrique « commode » :
En avançant en âge, je prends plus de risque avec mon écriture et les risques que je prends avec mon écriture ne sont plus, ne peuvent pas être des risques dits d’avant-garde, justement. L’avant-garde me paraît moins risquée, en ce sens-là. Le risque pour moi maintenant, qui est de plus en plus grand, et que je voudrais assumer de plus en plus, c’est d’écrire fictivement classique. [61]
Barthes, insistons-y, n’est nullement dans le « regret » : il va de l’avant, même s’il n’est plus à proprement parler d’avant-garde. Il s’agit toujours de prendre un risque, comme doit le faire un avant-gardiste. Toutefois, le risque a changé de forme : il consiste non à écrire de façon classique (n’oublions pas que, quelle que soit l’époque, même à l’heure du triomphe du Nouveau Roman, la majorité des écrivains français écrivaient – et écrivent toujours aujourd’hui – de façon tout à fait conventionnelle), mais de façon « fictivement » classique.
Une autre métaphore vient, pour préciser cette position, prendre le relais de la spirale : le motif de la montagne, que Barthes emprunte à une parabole zen. Elle apparaît dans le cours sur Le Neutre et ressurgit dans La Préparation du roman [62] :
- « Les montagnes sont des montagnes » : c’est le temps de la bêtise, de la tautologie, du scientisme borné (dans Le Neutre), tautologie arrogante anti-intellectuelle (dans La Préparation du roman).
- « Les montagnes ne sont plus des montagnes » (après l’enseignement zen) : temps de l’interprétation, de l’intelligence et de la paranoïa (Le Neutre), interprétation (La Préparation du roman).
- « De nouveau, les montagnes sont des montagnes » (Neutre) ou « les montagnes redeviennent des montagnes → Cela revient en spirale » (Préparation du roman) (temps du repos), de l’innocence (mystique), de la sapience, « méthode » (Tao) (Neutre), naturalité (Préparation du roman).
Dans Le Neutre, Barthes observe que nous sommes dans le temps 2 : « tout objet est converti par l’analyse, par l’interprétation » [63] et il ajoute « Reste à savoir si l’insatisfaction de cet état 2, sensible à beaucoup, n’appellerait pas l’état dialectique de la lettre […] : semble se chercher maladroitement “une lettre du troisième type”. » [64]
Dans La Préparation du roman, la parabole est suivie du commentaire suivant : « Ce processus : en quelque sorte, le retour de la lettre : le haïku (la phrase bien faite, la poésie) serait le terme d’un cheminement, l’assomption vers la lettre à comme diction simple, la lettre est difficile. » [65] La référence de ce retour de la lettre est donc le haïku, forme traditionnelle, certes, mais selon un « déport » culturel et géographique. Il n’est pas question d’écrire comme l’antimoderne Balzac !
Enfin, citons, toujours dans La Préparation du roman, un dernier cas de recherche non pas seulement de la troisième mais, carrément, de la quatrième voie. Nous sommes le 15 décembre 1979, à Paris, en France : Barthes réfléchit à une question décisive, celle du « moi » et il se plaît à « esquisser une typologie historique des écritures en fonction du Je, pronom de l’Imaginaire » [66] :
- Le Je est haïssable →Classiques
- Le Je est adorable → Romantiques
- Le Je est démodé →« Modernes »
- J’imagine un « Classique moderne » → le Je est incertain, triché [67]
Nul retour au temps 1 du passé classique, mais un « Classique moderne » en position historique 4. Quant au « Je incertain », s’il pourrait définir la fin de la modernité et des textes comme Roland Barthes par Roland Barthes, Le Miroir qui revient de Robbe-Grillet ou Enfance de Nathalie Sarraute, il n’a rien à voir avec les temps forts de la modernité, de La Jalousie, de Drame, de Beckett ou de Blanchot. En revanche, il annonce l’extraordinaire développement de l’autofiction contemporaine. D’ailleurs, Tiphaine Samoyault n’est pas la seule à considérer Roland Barthes par Roland Barthes comme la « forme avancée » [68] de celle-ci. Le « Classique-moderne » caractérise, encore plus largement, tout un pan de la littérature française contemporaine depuis les années 1980, débordant de l’autofiction pour s’épandre sur le domaine de l’hétérobiographie ou de la microfiction, large territoire qui va de Guibert à Angot en passant par Laurens, Michon, Carrère ou Jauffret, sans oublier l’écriture minimaliste, infinitésimaliste, ironique ou poétique d’Echenoz, de Chevillard, de Toussaint ou de Montalbetti. Ces écrivains et ces écrivaines, chacun et chacune à leur façon, mêlent la modernité et le classicisme ! Tous et toutes, à des degrés divers, sont à la fois « lisibles » et « scriptibles », nourris par les avant-gardes sans y appartenir. Tous et toutes usent peu ou prou du fragment, dont l’origine barthésienne n’a pas besoin d’être soulignée. Tous et toutes sont « après-modernes »…
Foucault, pour convaincre ses collègues d’accueillir Barthes au Collège de France, a rédigé un rapport qui contenait cette remarque : « Barthes appartient à la littérature de ces vingt dernières années. Il en a fait la louange ou rendu possible la lecture. Oui, mais surtout, ce qu’il a dit sur elle a pris effet en elle. » [69] Influence sur les vingt années qui ont précédé son entrée dans la prestigieuse institution, d’accord, mais aussi sur les trente qui ont suivi sa mort !
Barthes hypocrite ?
Le dernier Barthes, dans ces différents passages, n’exprime donc nullement un « regret », antimoderne : il a deviné l’avenir – ou il l’a préparé.
Remontons à présent le temps. Il faudrait s’attarder sur le Barthes purement moderne qui précède ce Barthes de la troisième voie afin de voir s’il était honnête dans son engagement lorsqu’il faisait face à Picard, défendait Brecht, Robbe-Grillet et Sollers ou ouvrait la voie au structuralisme. On pourrait se contenter ici de dire qu’Antoine Compagnon fait à Barthes un procès d’intention et en rester au fait, que personne ne conteste : Barthes a bel et bien participé à cette modernité, il a même, comme le note Adrien Chassain, élaboré une série « d’antithèses ayant pu valoir comme les mots d’ordre mêmes de la modernité française des années 1960-1970 : écriture transitive / intransitive, écrivant / écrivain, lisible / scriptible, texte de plaisir / texte de jouissance » [70].
Compagnon n’est cependant pas le seul à s’être posé la question de la sincérité des combats modernistes de Barthes. On a vu, à travers une page du Journal d’Urt de 1977, que le premier à s’être interrogé à ce propos n’est autre que Barthes lui-même. Mais une déclaration faite la même année à Jacques Henric contredit son aveu d’hypocrisie : « […] pendant longtemps je me suis senti déchiré d’une façon presque inavouable entre certains de mes goûts, […] mes lectures du soir […] et qui sont toujours des livres classiques, et mon travail de la journée où, effectivement, sans aucune espèce d’hypocrisie, je me sentais extrêmement solidaire sur le plan théorique et critique de certains travaux de la modernité. » [71] Alors, hypocrite ou sincère, Roland ?
Fanny Lorent a montré que Barthes, sollicité par Lindon via Jean Piel, avait hésité avant d’écrire son premier article sur Robbe-Grillet et, par la suite, la relation qui s’est nouée entre l’écrivain et l’écrivant s’est avérée des plus complexes [72]. Mais c’est surtout à propos de Sollers écrivain, en raison des liens d’amitié revendiqués qui unissaient les deux hommes, que s’est posée la question de la sincérité de Barthes. Ainsi, Robbe-Grillet à Cerisy en 1977 a-t-il eu beau jeu d’ironiser au sujet de l’ouvrage : « Il y a eu Sollers, encore, mais c’est un peu condescendant : c’est “par-dessus l’épaule” et presque “par-dessous la jambe”. » [73] Analysant Sollers écrivain chacun de leur côté, Philippe Roger et Vincent Jouve voient dans la défense de Drame ou de Paradis de véritables enjeux, non seulement sincères, mais essentiels. Selon Philippe Roger, il existe une « “nécessité” de Sollers […] avérée par le couplage de sa posture d’écrivain avec et contre une autre posture et une autre écriture : celle, primordiale et incontournable, de Gide » [74]. Pour Jouve, il s’agit de défendre une nouvelle fois et avec vigueur la notion d’« engagement par la forme » qui obsède Barthes depuis Le Degré zéro : « C’est en retravaillant la langue que l’écrivain combat l’oppression de la façon la plus efficace. » [75] Ce dernier argument me paraît assez convaincant.
J’en arrive à ceci : Barthes a sans doute éprouvé, de temps en temps, surtout vers la fin, quelques résistances vis-à-vis de l’avant-garde, résistances qui l’ont amené, alors qu’il était en proie au vague à l’âme, à se prendre pour un imposteur ou un hypocrite. Mais il n’a nullement défendu la modernité par hasard ou par accident : le refus du figement qui l’a animé toute sa vie était, en lui-même, profondément moderne. Et sa défiance du sens univoque, typiquement avant-gardiste, le poussait à défendre un travail formel toujours plus exigeant, qui ne pouvait qu’aboutir à l’illisibilité. Ce n’est que lorsque l’avant-garde s’est elle-même figée, vers 1977, qu’il s’est senti dépassé, déprimé, insatisfait. Attentif au présent, Barthes a peut-être eu peur que celui-ci ne désavoue la modernité et, à travers elle, son propre travail.
Peu après, par bonheur, il a trouvé une issue dans la troisième voie et recouvré son enthousiasme. Un inconnu, toujours en 1977, lui envoie un texte qui, à ses yeux, tout en étant moderne, échappe au figement avant-gardiste grâce à sa lisibilité, il lui écrit : « Hervé, ton texte est très bon. Quelque chose qui n’appartient qu’à toi : des sentiments très modernes, très obscurs, avec une écriture très claire, dont la clarté les renforce. Talent, talent, talent… » [76] Or Hervé Guibert, puisqu’il s’agit de lui, aura, à mon avis, une grande influence sur la littérature contemporaine – et Barthes à travers lui.
Barthes et le progrès ?
Un mot encore, très brièvement, sur la modernité de Barthes pour répondre aux propos tenus par Finkielkraut lors de la table ronde évoquée au début de cet article. Il est temps de dire que le Barthes moderne, celui qui défendait Robbe-Grillet puis Sollers ou qui ferraillait avec la Sorbonne, n’a jamais cru naïvement au « progrès péremptoire ». Si certaines pratiques n’avaient plus cours, s’il était nécessaire à ses yeux de renouveler sans cesse l’écriture, fût-ce au détriment de la lisibilité, il n’a jamais prétendu que le présent avant-gardiste était supérieur au passé classique. Il s’agissait d’évolution et non de progrès. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, une note est très claire à cet égard : « Pas de progrès dans les plaisirs, rien que des mutations. » [77]
Et le Barthes des origines ?
En résumé, s’il fait un pas de côté par rapport aux avant-gardes, c’est parce qu’il voit que celles-ci se figent et qu’elles ne sont plus en accord avec le présent. Il pressent que la nouveauté vraie sera le fait d’une troisième voie, d’un classique moderne, d’un retour du classicisme à une autre place sur la spirale, etc. Malgré les moments de doute qui le taraudent, il ne sombre donc jamais dans l’antimodernité.
Qu’en est-il du Barthes des origines, que Compagnon compare, avec raison, au dernier Barthes. Les textes écrits dans les années 1940, à mon avis, ne contiennent guère de traces d’antimodernisme, mais on y voit déjà se construire une position d’équilibre. Car ce que Barthes loue, de son sanatorium, dans L’Étranger de Camus (en qui il s’identifie probablement), c’est non pas le classicisme tourné vers le passé, mais déjà une synthèse entre classicisme et modernité : « sur des données d’avant-garde, Camus a fait une œuvre qui a la musicale simplicité de Bérénice » [78]. Et il généralise en ces termes la leçon que donne le style de Camus : « Le plaisir du style, même dans les œuvres d’avant-garde, ne s’obtiendra jamais que par fidélité à certaines préoccupations classiques qui sont l’harmonie, la correction, la simplicité, la beauté, etc. bref, les éléments séculaires du goût. » [79] Si l’on excepte cette conception vieillotte des « éléments séculaires du goût », nous sommes en effet là très proche du dernier Barthes. Toutefois, l’on y voit déjà un souci de l’avant-garde. Le jeune Barthes ne connaît pas encore bien celle-ci, et n’a pas conscience à l’avance de l’usure à venir, d’un futur figement doxique, mais il la considère comme un objectif placé devant lui et ce qu’il imagine est bien un dépassement moderne de Camus :
[…] et l’on souhaite, comme le fanal de temps plus salubres, une œuvre qui soit gratuite jusqu’au bout, dont on ne puisse rien tirer, si ce n’est l’évidence et la description de l’absurde, une œuvre résistante, pure et solitaire, que personne – absolument personne, d’aucun bord qu’il vienne – ne puisse tirer à soi [80].
Même s’il vante une position de compromis avec le classicisme, il est donc déjà avant-gardiste en cela qu’il se tourne vers l’avenir, dans une perspective tout à fait moderne de dépassement, de comble. Et cette œuvre « gratuite » qu’il décrit là ne ressemble-t-elle pas… à un roman de Robbe-Grillet ?
Pourtant, il n’y est pas encore : dans Le Degré zéro de l’écriture, il est question, comme à la fin de sa vie, d’un « troisième terme, terme neutre ou terme-zéro » [81]. Il ne réagit alors pas non plus encore à un figement de l’avant-garde, mais à une forme d’« impasse » [82] de la modernité, condamnée à un perpétuel « suicide » [83] prolongé, ce qui lui fait écrire cette phrase sans appel : « On voit par là qu’un chef-d’œuvre moderne est impossible. » [84]
Cependant, le thème du figement est déjà présent : il est diagnostiqué non du côté de l’avant-garde, mais précisément de l’écriture blanche (sans doute à cause de la déception qu’a causée en lui la lecture de La Peste) : « Malheureusement, rien n’est plus infidèle qu’une écriture blanche ; les automatismes s’élaborent à l’endroit même où se trouvait d’abord une liberté, un réseau de formes durcies serre de plus en plus la fraîcheur première du discours […]. » [85]
Par ailleurs, les exemples de l’avant-garde suicidaire sont tous tirés de la poésie : quand il découvrira Robbe-Grillet, Barthes va s’apercevoir que la même entreprise suicidaire peut enfin s’opérer pour le roman.
Mon hypothèse n’est donc pas celle d’un goût permanent pour les seuls classiques dont les hasards du combat l’auraient détourné, mais bien celle d’un souci du présent, du futur de la modernité, et de la conscience de ses limites historiques. Cependant, en 1958, il pense que la troisième voie s’est déjà durcie et il va préférer, avec raison (car c’est là que va s’épanouir la création), encourager encore une avant-garde romanesque aussi courageuse et suicidaire que Mallarmé l’a été en poésie. Puis quand cette avant-garde se figera elle-même avec les disciples anonymes de Tel quel qui le bombardent de manuscrits, il sentira que le moment de la troisième voie est enfin venu et il tendra la main, avant de mourir, au bel Hervé Guibert, dont le second livre et le premier chef-d’œuvre, L’Image fantôme, est l’exact prolongement de La Chambre claire.
Postmoderne ?
Reste à nommer cette troisième voie, ce dépassement dialectique entre modernité et classicisme ? Philippe Roger, dans l’article que nous avons cités à plusieurs reprises, opte pour le terme « post-classique », qui lui donne son titre. Il justifie cette appellation frappante en s’appuyant sur le passage de La Préparation du roman que nous avons commenté supra. Il s’agit des derniers mots de l’article de Roger, que voici :
C’est dans ce contexte que le classicisme peut faire un retour amical, sans qu’il y ait pour autant « retour aux classiques » : il s’agit bien pour Barthes, depuis toujours, de les amener à nous. Barthes peut ainsi « imaginer », dans son dernier cours, un « Classique moderne » : celui chez qui « le Je est incertain, triché » un hybride heureux qui ne serait pas un post-moderne – catégorie qui lui fut toujours indifférente –, mais ce qu’on pourrait appeler un post-classique : celui qui vient après et qui se souvient. Qui n’oublie ni ne renie. [86]
Étant donné que cet article s’intéresse aux liens entretenus par Barthes avec les classiques, la formule fait mouche. Mais elle ne convient guère à la perspective défendue ici, car, au mieux, elle ne dit absolument rien du rapport de Barthes à la modernité, pourtant primordial et, au pire, elle prête, me semble-t-il, à confusion. En effet, non seulement le terme ne définit Barthes que par rapport aux classiques, mais en outre il pourrait être confondu avec « pré-moderne ». Or, de l’avis de Roger comme du nôtre, Barthes n’a rien d’un pré-moderne ! Le propos de « Barthes post-classique » tend à prouver, au contraire, que l’auteur du Degré zéro de l’écriture a toujours été moderne, dès ses écrits du sanatorium. Ce n’est d’ailleurs pas le dernier Barthes que Roger cherche à définir avec cette belle étiquette, mais un Barthes permanent. Certes, indubitablement, la chronologie permet de situer Barthes après le classicisme. Mais aussi après ce qui a précédé le XVIIe siècle : l’Antiquité (puisqu’il a écrit sur la tragédie antique) et la Renaissance (puisqu’il a écrit sur Shakespeare et évoqué Montaigne). Et surtout après ce qui a suivi le classicisme : après le Romantisme de Michelet et, j’y insiste, après les modernes. Barthes « n’oublie ni ne renie » la modernité dont il a fait lui-même partie.
Bien entendu, si l’on mélange « après-moderne » et « post-classique », on tombe soit sur « après-classique », qui ne nous sera d’aucune utilité, soit sur « postmoderne », terme que notre lecteur le plus patient attend sans doute au tournant depuis un moment déjà. Roger l’évacue prudemment en invoquant l’indifférence de Barthes à l’égard de cette « catégorie ». Je pourrais objecter que l’ouvrage principal en français sur la question, La Condition postmoderne de Lyotard, date de 1979 et que Barthes, décédé en 1980, n’a guère eu le temps de s’y intéresser. « Postmoderne » pourrait donc a priori nous convenir, mais seulement pour qualifier le dernier Barthes, qui ouvrirait en France, avant de mourir, les portes de la « postmodernité »[87]. Le mot se trouve d’ailleurs sous la plume de Jean-Pierre Bertrand, lorsqu’il évoque un « continuum dans la rupture » impliquant « tout un positionnement en regard des forces vives de la pensée de la seconde moitié du XXe siècle, de l’existentialisme au début de la postmodernité […] » [88].
Cependant, le terme a donné lieu à de très nombreux malentendus dans la mesure où son sens est multiple. Sa signification diffère en effet non seulement selon les disciplines (architecture, philosophie, sociologie, science politique, étude littéraire), mais aussi en fonction de l’espace : alors qu’aux États-Unis, il désigne les derniers modernes, c’est-à-dire les modernes les plus radicaux, depuis l’après-guerre jusqu’aux années 1990, en Europe, il sert à caractériser ce qui suit la modernité à partir des années 1980, c’est-à-dire la création postérieure à la mort des dernières avant-gardes. Du point de vue américain, d’ailleurs, Barthes est postmoderne, comme l’atteste la présence de son nom, aux côtés de ceux de Robbe-Grillet, de Sollers, de Lacan ou de Derrida, au sein d’une liste proposée par Ihab Hassan dans son célèbre ouvrage de 1987 sur la question, The Postmodern Turn. Traduite en termes européens, la présence de Barthes dans les rangs postmodernistes signifie que, selon Hassan, il est moderne – et non antimoderne.
Cette plurivocité n’est peut-être pas insurmontable : je pourrais peut-être m’en sortir en passant par de longues discussions terminologiques [89], en précisant que je parle en tant qu’Européen, du point de vue littéraire et en me distinguant des auteurs que j’ai lus jadis sur la question (Jean-François Lyotard, Michel Collomb, Angèle Kremer-Marietti, Brunella Eruli ou Slavoj Žižek). Mais cela ne suffirait pas. Les notions de « postmoderne », de « postmodernité » et de « postmodernisme » ne pêchent pas qu’en raison de leur fâcheuse polysémie ; comme l’a démontré Lionel Ruffel, de façon tout à fait irréfutable, dans un article éclairant sur la question, elles sont – pareilles au « je » pour les modernes – purement et simplement démodées. Ringardes. Mortes. Le suffixe « post- », explique Ruffel en conclusion de son article, « marque principalement un trouble dans la temporalité. C’est ce mouvement qu’a inauguré le postmoderne, mais qu’il n’a pu mener à terme, ce qui explique qu’il soit une catégorie appartenant désormais au passé. » [90]
Il y aurait beaucoup à dire sur ce discrédit, typique en lui-même de l’objet que le mot aurait dû désigner. Toujours est-il que, devant tant de défauts, je me vois contraint de renoncer à une notion, même si elle aurait pu, sur une autre planète, nous être utile. J’en reste donc à ma très prudente « après-modernité », que je peux du moins définir à ma guise.
De quoi s’agit-il ? L’après-modernité est ce qui vient après la modernité. Elle ne cherche ni à la dépasser ni à l’évacuer, mais à s’en nourrir sans vergogne. En somme, elle consiste à considérer la modernité comme une forme de classicisme. En littérature française, elle naît dans le courant des années 1980.
Afin d’être tout à fait clair sans prendre trop de place, je propose ici un double tableau mettant en regard les caractéristiques de la modernité littéraire ou artistique et celles de l’après-modernité telle que je l’entends (ou crois l’entendre). Libre à chacun de trouver que l’après-modernité en question ressemble (ou non) à la postmodernité.
|
Caractéristiques de la modernité
|
Caractéristiques de l’après-modernité |
| Primat de la forme sur le contenu. | Nouvel équilibre du contenu et de la forme, par exemple à travers l’humour. Ou : la forme prime toujours mais cela ne se voit guère. L’importance de la forme va de soi : point n’est besoin d’en faire la démonstration. |
| Recherche de nouveauté et d’originalité à tout prix. | Synthèse du classique et du moderne entraînant juxtapositions et ruptures… qui sont finalement originales, comme par accident. |
| Attirance pour l’expérimentation. | Recontextualisation des expérimentations modernes : un procédé formel qui valait pour lui-même, pour son originalité chez les modernes, n’est utilisé que pour les effets de sens qu’il produit chez les après-modernes. |
| Tendance à l’autotélisme : le texte parle de lui-même | Tendance à l’autoironie, dérision de soi-même et de son art. |
| Soupçon porté sur les formes classiques qui correspondaient, philosophiquement, à une conception fermée de l’individu. L’individu, pour les modernes, est divisé. | L’individu est pluriel. Le soupçon sur les formes classiques est transformé en jeu. |
| Rejet du sujet. | Retour du sujet mais à une autre place : il est incertain. |
| Concept prime sur le savoir-faire ou besoin de théorie accompagnant la création. | Nouvel accent sur le savoir-faire, recul des théories. |
| Tendance à former des groupes autour d’une idée commune de l’art. | Plus de groupes ni d’école. |
| Idéologie du combat. | Neutralité (neutre ?) et indépendance. |
| Tendance à la déconstruction (du langage, par exemple). | Reconstruction partielle du langage : phrase classique mais texte fragmenté. |
| Rejet des conventions (les rimes et le sens en poésie, le personnage, le récit, la ponctuation, la psychologie en ce qui concerne le roman). | Jeu avec les conventions. |
| Recherche de l’essence de chaque art débouchant souvent sur sa négation même et produisant le vertige du vide (Mallarmé, Beckett, Blanchot…). | Reconnaissance du caractère artificiel de l’art (le roman est littéraire et non un reflet du réel), mais jouissance de l’artificialité même. |
| Conscience de l’évolution historique des formes d’art s’usant les unes après les autres (conscience qui ne se confond que très rarement avec une foi naïve dans le progrès de l’art). | Conscience de la mondialisation de l’art qui prend le pas sur la conscience de son historicité. Encore moins de foi naïve vis-à-vis du progrès. |
| Accélération du principe d’opposition : l’art moderne s’oppose à l’art académique, à l’art commercial, à la génération moderne précédente, selon une logique du comble. | Fin du principe d’opposition et de la logique du comble au profit de l’éclectisme international et intemporel et de l’intertextualité généralisée. |
Il faudrait illustrer chaque case en se référant à Barthes, ce qui serait fastidieux. Je me conterais de répéter mon credo : Barthes serait passé à la fin de sa vie de la modernité à l’après-modernité. Et j’ajoute : il a eu raison de le faire. Il a eu raison d’être moderne puis raison de devenir, au bon moment, après-moderne.
Conclusion courte mais osée
Dès 1975, Roland Barthes avait exprimé sa méfiance vis-à-vis de la nostalgie du pur retour, du retour circulaire (et non spiralé) : celui-ci n’avait pas à ses yeux les traits d’Orphée, que lui prête joliment Finkielkraut, mais le visage de la Farce.
Sur le trajet de la spirale, toutes choses reviennent, mais à une autre place, supérieure : c’est alors le retour de la différence, le cheminement de la métaphore ; c’est la Fiction. La Farce, elle, revient plus bas ; c’est une métaphore qui penche, se fane et choit (qui débande). [91]
Même si la figure d’Orphée est omniprésente dans son œuvre, du Degré zéro de l’écriture au Lexique de l’auteur où lui est consacrée une entrée, Roland Barthes, à mon humble avis, de ce point de vue, à travers le roman contemporain qui le prolonge en faisant revenir, sous les auspices de la spirale de Vico, le classicisme ou la lisibilité à une autre place, dialectiquement mêlée à la modernité, est ithyphallique et non orphique : il bande encore.
[1] Claudia Amigo Pino, « Genèse d’une critique magique. Les grands projets de Roland Barthes dans les séminaires de l’ehess », dans Jean-Pierre Bertrand (dir.), Roland Barthes. Continuités. Colloque de Cerisy 2016, Paris, Christian Bourgois, 2017, p. 189.
[2] Ce colloque n’a pas fait l’objet d’une publication. Mais il est possible d’en télécharger les enregistrements sur le site du Collège de France : url : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-2015-11-13-17h00.htm. Les mots cités qui suivent sont donc issus de mes transcriptions.
[3] Pierre Bayard, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds, Paris, Minuit, coll. Paradoxe, 2002, p. 35-36
[4] Roland Barthes, Sur Racine [1963], dans Œuvres complètes. Nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, tome II, 1962-1967, Paris, Seuil, 2002, p. 54-55. Dorénavant, et sans souci d’originalité, chaque tome est abrégé O. C.
[5] Compagnon évoque là les reproches qui lui ont été adressés à la suite de la parution de son livre. Il s’en est expliqué lors d’un entretien : « Moi je le qualifie d’antimoderne ; à mes yeux, c’est une qualité, un compliment. Mais il est vrai qu’un certain nombre de mes lecteurs ont trouvé que cette qualification d’antimoderne était sacrilège, blasphématoire, pour celui en qui ils voyaient un héros de la modernité. » (Raphaël Enthoven (dir.), Barthes, Paris, Fayard/France Culture, coll. Les Nouveaux chemins de la connaissance, 2010, p. 71)
[6] Philippe Roger, Roland Barthes, roman, Paris, Grasset, coll. Figures, 1986, p. 17.
[7] Philippe Roger, « Contre le roman, tout contre… », dans Roland Barthes, Paris, Le Magazine littéraire, coll. Nouveaux regards, 2013, p. 80.
[8] Philippe Roger, « Barthes post-classique », dans Revue d’Histoire littéraire de La France, volume 107, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, p. 273-291, url : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2007-2-page-273.html
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse, 2015, p. 23.
[12] Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 264-267.
[13] Antoine Compagnon, Une question de discipline. Entretiens avec Jean-Baptiste Amadieu, Paris, Flammarion, 2013, p. 121.
[14] Antoine Compagnon, « Lequel est le bon ? », dans Marielle Macé et Alexandre Gefen (dir.), Barthes au lieu du roman, Paris, Desjonquères/Nota Bene, p. 17-21 et Antoine Compagnon, L’Âge des lettres, Paris, Gallimard, 2015, p. 113. Sur ce sujet, je me sens, en revanche, en phase avec le point de vue de Jean-Marie Schaeffer (voir Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, op. cit., p. 35 et suivantes). Voir aussi les arguments de Claude Coste, Bêtise de Barthes, Paris, Klincksieck, 2011, p. 33 et les éclairantes explications de Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 608-611.
[15] Dans Le Démon de la théorie, bien sûr, mais aussi dans son cours au Collège de France sur l’année 1966 et, de façon plus tranchée, dans son livre sur Barthes : « Par fidélité à Racine et par admiration de la tragédie, il est bien concevable que je me fusse rangé du côté de Picard. » (Antoine Compagnon, L’Âge des lettres, op. cit., p. 78)
[16] Il y joue au jeu du « J’aime » et « Je n’aime pas » avec les livres de Barthes, sauvant quelques articles de critique littéraire, le Michelet, les Mythologies, Roland Barthes par Roland Barthes (son préféré) et La Chambre claire, rejetant Le Degré zéro, L’Empire des signes et Les Fragments d’un discours amoureux (voir ibidem, p. 81-82). Auparavant, il a dénigré le schéma peu cohérent des « Éléments de sociologie » (ibidem, p. 27) et s’est dit moins convaincu par S/Z aujourd’hui qu’à l’époque de sa sortie (ibidem, p. 29). Quant à Sur Racine, il lui inspire ce propos sévère : « […] ce livre ne m’a jamais plu, m’a toujours semblé faux, aussi peu racinien que possible, peut-être le plus à côté de la plaque de tous ses livres » (ibidem, p. 75).
[17] Compagnon y note ainsi « […] la thèse du Degré zéro, cette écriture insérée entre la langue et le style, m’a paru d’emblée un peu forcée » (Antoine Compagnon, Une question de discipline. Entretiens avec Jean-Baptiste Amadieu, op. cit., p. 73) ; ou : « Regarder Barthes travailler fut pour moi une leçon qui a compté, comme un apprentissage manuel, puisque j’ai compris avec Barthes la dimension manuelle du travail intellectuel, sa dimension de bricolage, si vous voulez. J’ai parfois l’impression de lui être surtout redevable de cette dimension-là. » (ibidem, p. 78-79)
[18] Antoine Compagnon, L’Âge des lettres, op. cit., p. 107.
[19] Ibidem.
[20] Yaël Dagan, « Antoine Compagnon, Les Antimodernes », dans Mil neuf cent, n° 24, 2006, p. 210-212, compte rendu disponible à la page : http://www.revue1900.org/spip.php?article110.
[21] Antoine Compagnon, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèques des idées, 2005, p. 8. Autre exemple : « L’antimoderne […] a du mal à composer : son œuvre est toujours un peu monstrueuse. C’est aussi ce qui persiste à faire de lui un moderne. » (Ibidem, p. 28)
[22] Peut-être les grands penseurs pourraient-ils être classés en deux catégories : d’une part, ceux qui posent d’abord un concept solide puis qui le nuancent et ne cessent de le nuancer, quitte à aboutir à un plaisant paradoxe, et, d’autre part, ceux qui d’emblée s’appuient sur un concept paradoxal, comme s’ils intégraient la nuance dans l’œuf et la couvaient ensuite pour qu’elle ne cesse de croître, au risque de ne plus très bien savoir sous quelle forme elle éclot et à quoi elle s’applique au juste. À mes yeux, Compagnon appartient à la première famille. Barthes aussi, même s’il va plus loin dans la nuance ; Blanchot (et peut-être Lacan) à la seconde.
[23] Ibidem, p. 53.
[24] Ibidem, p. 74.
[25] Ibidem, p. 404.
[26] Ibidem, p. 411.
[27] Ibidem, p. 415.
[28] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes [1975], dans O. C., tome IV, op. cit., p. 678.
[29] Ibidem, p. 695.
[30] Roland Barthes, « Barthes en bouffées de langage » [dans Les Nouvelles littéraires, 21 avril 1977], dans O. C., tome V, op. cit., p. 397.
[31] Roland Barthes, « Délibération » [dans Tel quel, hiver 1979], dans O. C., tome V, op. cit., p. 676.
[32] Roland Barthes, Soirées de Paris, dans O. C., tome V, op. cit., p. 980.
[33] Roland Barthes, « L’image », dans O. C., tome V, op. cit., p. 514
[34] Roland Barthes, « Sémiographie d’André Masson », dans O. C., tome IV, op. cit., p. 347.
[35] Roland Barthes, extrait du Journal d’Urt. Été 1977, inédit, cité dans Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 32.
[36] Éric Marty, « Présentation », dans Roland Barthes, O. C., tome II, op. cit., p. 13.
[37] Philippe Roger, « Barthes post-classique », article cité.
[38] Bernard Comment, « De la pensée comme autofiction », dans Roland Barthes, Le Magazine littéraire, op. cit., p. 45.
[39] Antoine Compagnon, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, op. cit., p. 421.
[40] Dans un bref article de 1955, En attendant Godot sert de point de comparaison à l’ennuyeux Songe de prisonniers de Christopher Fry : la pièce de Beckett y représente la vraie avant-garde face à la fausse : « En ce sens et malgré le paradoxe apparent, l’anti-Songe, c’est certainement Godot, dont l’astuce est précisément d’avoir organisé, dirigé, évacué une attente de rien. » (Roland Barthes, « La vaccine de l’avant-garde » [dans Lettres nouvelles, mars 1955], dans O. C., tome i, op. cit., p. 564) Et, dans un article un peu plus long datant de 1961, Beckett est présenté, aux côtés d’Adamov et de Ionesco, comme un parangon du théâtre d’avant-garde français. Certes, cet article est assez ambigu, puisqu’il constate la mort de cette avant-garde, Ionesco ayant évolué vers « un théâtre à prétention humanisée » (Roland Barthes, « Le théâtre français d’avant-garde » [dans Le français dans le monde, juin-juillet 1961], dans O. C., tome i, op. cit., p. 1101), Adamov vers « un théâtre politique » (ibidem) et Beckett se taisant « semble-t-il »[40]. Mais le jugement global n’en demeure pas moins le suivant : « Un bilan ? Il serait incontestablement positif. » (Ibidem)
[41] Voir Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 382 et p. 548.
[42] Ailleurs, un peu plus tard, Antoine Compagnon ne met d’ailleurs pas du tout le moment brechtien de Barthes au crédit de son antimodernisme, bien au contraire : « Il y a eu un moment des années 50 où Barthes a été très marqué par le matérialisme historique, par le marxisme, par Brecht. À ce moment-là, il était en phase avec une certaine idéologie progressiste. » (Raphaël Enthoven (dir.), Barthes, op. cit., p. 71).
[43] Antoine Compagnon, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, op. cit., p. 432-433.
[44] Bernard Comment, « L’énergie du vivant », dans Roland Barthes l’inattendu. Le centenaire d’un révolutionnaire du langage, Paris, Hors-série Le Monde, juillet-août 2015, p. 9.
[45]J’ai déjà cité certains de ces passages dans un article intitulé « Barthes avant Guibert », dans Jean-Pierre Bertrand (dir.), Roland Barthes Continuités, op. cit., p. 505-525. Je m’en excuse auprès de mes fidèles lecteurs.
[46] Roland Barthes, « Délibération » [dans Tel quel, hiver 1979], dans O. C., tome V, op. cit., p. 676.
[47] Sur les rapports complexes de Barthes vis-à-vis de la dialectique, voir Andy Stafford, « Roland Barthes dialecticien ? En dernière instance ? », dans Jean-Pierre Bertrand (dir.), Roland Barthes Continuités, op. cit., p. 221-246. L’auteur relève une tendance à l’« indialectique » ou à une dialectique à deux termes, mais il finit, « en dernière instance », par diagnostiquer une « hyperdialectique » barthésienne.
[48] Antoine Compagnon, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, op. cit., p. 416.
[49] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, dans O. C., tome IV, p. 645.
[50] Ibidem.
[51] Ibidem, p. 647.
[52] Andy Stafford, « Roland Barthes dialecticien ? En dernière instance ? », article cité, p. 225.
[53] Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur. Séminaire à l’École pratique des hautes études 1973-1974, Paris, Seuil, coll. Traces écrites, 2010, p. 274.
[54] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes [1975], dans O. C., tome IV, op. cit., p. 650.
[55] Cité par Claude Coste, Bêtise de Barthes, op. cit., p. 63. Il s’agit d’un extrait des notes du séminaire de 1975 consacré à Bouvard et Pécuchet.
[56] Roland Barthes, « Entretien », [dans Art-Press, mai 1977], dans O. C., tome V, op. cit., p. 398.
[57] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes [1975], dans O. C., tome IV, op. cit., p. 633-634.
[58] Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 489-490.
[59] Roland Barthes, « Le théâtre français d’avant-garde », article cité, p. 1094.
[60] Roland Barthes, « Entretien » [dans Art-Press, mai 1977], dans O. C., tome V, op. cit., p. 399.
[61] Transcription personnelle.
[62] Je superpose les deux versions, dont voici les références : Roland Barthes, Le Neutre, Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Seuil/imec, 2002, p. 164-165 et Roland Barthes, La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), Paris, Seuil/imec, 2003, p. 126-127.
[63] Roland Barthes, Le Neutre, op. cit., p. 165.
[64] Ibidem.
[65] Roland Barthes, La Préparation du roman I et II, op. cit., p. 126
[66] Ibidem, p. 229.
[67] Ibidem.
[68] Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 583.
[69] Michel Foucault, « Rapport pour la présentation des candidats à la chaire intitulée sémiologie littéraire », cité dans Tiphaine Samoyault, Roland Barthes. Biographie, op. cit., p. 572.
[70] Adrien Chassain, « “La rhétorique est la dimension amoureuse de l’écriture” : communication ordinaire et conversion théorique des affects chez Roland Barthes », dans Revue Roland Barthes, nº 1, juin 2014 [en ligne]. url : http://www.roland-barthes.org/article_chassain.html [site consulté le 1er mars 2018].
[71] Roland Barthes, « Entretien » [dans Art-Press, mai 1977], dans O. C., tome V, op. cit., p. 399. Il avait d’ailleurs déjà avoué dans Roland Barthes par Roland Barthes : « […] je suis plus classique que la théorie du texte que je défends » (Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, dans O. C., tome IV, op. cit., p. 652).
[72] Voir Fanny Lorent, Barthes et Robbe-Grillet. Un dialogue critique, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015.
[73] Alain Robbe-Grillet, Pourquoi j’aime Barthes [1977], Paris, Christian Bourgois, coll. Titre, 2001, p. 40. « Par dessus l’épaule » est le titre d’une des sections de Sollers écrivain.
[74] Philippe Roger, Roland Barthes, roman, op. cit., p. 315.
[75] Vincent Jouve, La Littérature selon Barthes, Paris, Minuit, 1986, p. 86-87.
[76] Roland Barthes, « Roland Barthes à Hervé Guibert » [4 mars 1977], dans Album. Inédits, correspondances et varia, Paris, Seuil, 2015, p. 364.
[77] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, dans O. C., tome IV, p. 630.
[78] Roland Barthes, « Réflexion sur le style de L’Étranger » [dans Existences, juillet 1944], dans O. C., tome I, op. cit., p. 78.
[79] Ibidem, p. 75.
[80] Ibidem, p. 77.
[81] Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture [1953], dans O. C., tome I, op. cit., p. 217.
[82] Ibidem, p. 223.
[83] Ibidem, p. 217.
[84] Ibidem, p. 223.
[85] Ibidem, p. 218.
[86] Philippe Roger, « Barthes post-classique », article cité.
[87] Si j’avais à employer ces termes, je dirais « postmodernité » et non « postmodernisme » : le postmoderne n’est plus militant, puisqu’il n’est pas d’avant-garde, donc le suffixe en « -isme » ne lui convient guère.
[88] Jean-Pierre Bertrand, « Présentation. À propos d’“influence” », dans idem (dir.), Roland Barthes. Continuités, op. cit., p. 16.
[89] En d’autres temps, sur un tout autre sujet, je m’étais astreint à cette pénible tâche. Voir « Mourir à son postmoderne », dans Écritures, n° 5, Le dépli. Littérature et postmodernité, Université de Liège/Les Éperonniers, 1993, p. 22-29. Et « Génération innommable », dans Paul Aron et Jean-Pierre Bertrand (dir.), Textyles, n° 14, Lettres du jour (II), 1997, p. 7-17, url : https://journals.openedition.org/textyles/2152.
[90] Lionel Ruffel, « Postmoderne », dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le Lexique socius, url : http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/61-postmoderne.
[91] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, dans O. C., tome IV, op. cit., p. 666.