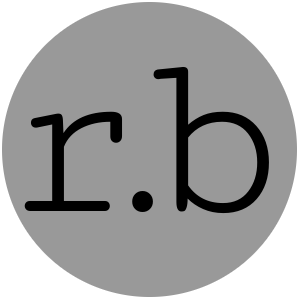C’est souvent avec inquiétude ou circonspection, aujourd’hui, que l’on évoque l’actualité, et a fortiori l’avenir de la théorie littéraire. Depuis le reflux du structuralisme vers le mitan des années 1970, l’heure du bilan n’a cessé de sonner. Antoine Compagnon, Tzvetan Todorov et d’autres [1] ont ainsi multiplié ces dernières années les témoignages et les synthèses, se retournant sur ce présumé « âge d’or » de la théorie littéraire, pour en dresser l’inventaire et en juger la postérité. Que certaines de ces interventions aient parfois été estimées sévères ou conservatrices, elles témoignent en tous les cas de la réelle difficulté, du trouble de notre époque à s’inscrire dans l’héritage des années 1960-1970 [2].
Chez les liquidateurs comme chez les continuateurs, la page semble bel et bien tournée, au point que l’enjeu n’est plus tant – pour les seconds du moins – « que faire ensuite ? » qu’« un avenir est-il possible ? ». Sont emblématiques à cet égard les questions adressées par Vincent Kaufmann à certaines actrices et acteurs importants de ces années théoriques, à l’occasion d’une série d’entretiens occupant la fin de son ouvrage La Faute à Mallarmé : « Voyez-vous une place et un avenir pour le théorique ? » demande-il à Élisabeth Roudinesco, « Pensez-vous que la théorie a encore sa place aujourd’hui, qu’elle a encore un avenir ? », à Karlheinz Stierle, « Un avenir ? Une chance de survie ? [3] », à Gérard Genette, etc.
Plutôt que de m’interroger sur les possibilités et les modalités actuelles d’un avenir pour la théorie littéraire, je voudrais dans cet article me pencher sur la façon dont celles et ceux qui la concevaient alors imaginaient l’avenir de leurs propositions théoriques, au moment même où ils les formulaient : quelle place occupait l’avenir dans leur activité théorique ? en cette période, les années 1960-1970, qui nous apparaît rétrospectivement comme euphorique, confiante, joyeuse, le futur était-il alors seulement rêvé sur le seul mode du progrès ? À l’heure où nous faisons également le constat d’un mal disciplinaire dans nos études littéraires [4], il m’a semblé utile d’aborder la question au prisme de deux disciplines, fondées dans ces décennies que nous regardons aujourd’hui parfois avec nostalgie : la sémiologie et la poétique (moderne) à travers, pour la première, le cas de Roland Barthes, et pour la seconde, celui de deux de ses disciples, Gérard Genette et Tzvetan Todorov [5].
Ayant marqué l’imaginaire de tous ceux et celles qui ont vécu ces années d’émulation théorique, ces deux étiquettes disciplinaires délimitent aujourd’hui des champs de recherche et d’enseignement institutionnalisés. Dès l’introduction du célèbre Démon de la théorie, on peut lire ainsi :
Vers 1970, la théorie littéraire battait son plein et elle exerçait un immense attrait sur les jeunes gens de ma génération. Sous diverses appellations – « nouvelle critique », « poétique », « structuralisme », « sémiologie », « narratologie » –, elle brillait de tous ses feux. Un courant puissant nous emportait tous. […]. En ce temps-là, l’image de l’étude littéraire, soutenue par la théorie, était séduisante, persuasive, triomphante. Ce n’est plus exactement le cas. La théorie s’est institutionnalisée, elle s’est transformée en méthode, elle est devenue une petite technique pédagogique souvent aussi desséchante que l’explication de texte à laquelle elle s’en prenait alors avec verve [6].
Quoi qu’il en soit ici du pessimisme de Compagnon, mon but ne sera pas de (ré)évaluer, du point de vue actuel, ce que sont devenues la sémiologie et la poétique, ni comment elles survivent à notre époque. Disons, plus modestement, que j’espère examiner dans cet article comment celles et ceux qui ont contribué à les fonder ont pensé le devenir de celles-ci, et comment cette pensée a évolué dans la durée.
Le discours savant me semble, à cet égard, constituer un terrain particulièrement favorable pour aborder la question du « souci de l’avenir [7] », surtout si l’on veut bien comprendre le savoir à la manière de Pierre Macherey, qui le définit comme « l’acte même de connaître en tant qu’il est entraîné dans la dynamique de son devenir en acte, dont les étapes ultérieures ne sont pas préfigurées dans son passé dont elles n’auraient qu’à être extraites [8] ». Un tel savoir porte ainsi toujours en lui « la promesse d’un avenir [9] », et c’est cette promesse qui me retiendra ici. Cette dimension intrinsèquement prospective de l’activité savante est, de plus, rendue tout particulièrement intense et sensible dans les cas des disciplines sémiologique et poétique car, comme je le suggérais plus haut, leur naissance s’inscrit dans les dernières décennies d’une époque dominée par un régime moderne d’historicité, selon le mot de François Hartog. Dans des analyses aujourd’hui classiques, l’historien fait débuter autour de 1789 cette perception moderne de l’ordre du temps, qui tend à se détacher de l’historia magistra vitae, pour accorder au futur une force d’attraction que le passé occupait jusqu’alors grâce à l’idée du « modèle à imiter » : « Avec le régime moderne, l’exemplaire, comme tel, disparaît pour faire place à ce qui ne se répète pas. Le passé est, par principe ou, ce qui revient au même, par position, dépassé [10] », résume l’historien. Ce régime, qui court selon Hartog jusqu’au tournant des années 1990, avant de céder la place au présentisme contemporain, a été celui des grandes avant-gardes littéraires et artistiques, qui « suppose[nt] une conscience historique du futur et la volonté d’être en avance sur son temps [11] », comme l’écrit Compagnon dans Les Cinq paradoxes de la modernité. C’est ainsi dans ce climat futuriste que Barthes, Genette et Todorov évoluent dans les années 1960-1970, climat dont témoignent, et auquel participent le groupe « Tel Quel », dont Barthes sera longtemps proche [12], ainsi que les Formalistes russes, eux-mêmes très liés au futurisme russe, et introduits en France par Ruwet et Todorov à partir de 1963 avec le succès que l’on connaît [13]. Paroxysme du moment « scientiste » dans les études littéraires, les années qui voient naître la sémiologie et la poétique moderne sont ainsi marquées par une vision progressiste du temps, et l’époque voit fleurir nombres d’énoncés programmatiques, dont on trouve trace dès 1945 avec l’article de Lévi-Strauss, « L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie » publié dans Word. Journal of the Linguistic Circle of New York.
Un élément contextuel, lié aussi au régime d’historicité décrit par Hartog, aide à comprendre l’euphorie scientifique évoquée ici : le lancement, en 1962, du quatrième Plan quinquennal, qui accorde à la science une confiance absolue en sa capacité d’œuvrer au progrès social et économique de l’État. Julie Bouchard s’est livrée à une analyse du discours des rapports de la Planification en France, voici ce qu’elle relève à propos des années 1960 :
La recherche est toujours vue, de manière générale, comme une ressource du dynamisme national, « un facteur essentiel de l’expansion et du progrès en général » [C4e, 1962-1965, p. 13], « un élément stratégique essentiel en matière d’économie, de défense et de progrès social » [C5e, 1966-1970, t. 1, p. 12], un élément qui influe sur « le rang qu’occupera le pays dans le concert des nations » [C4e, 1962-1965, p. 13], etc [14].
Contrairement aux années 1950, qui sont marquées par « un discours sur le retard [qui] renvoie à un imaginaire fondé sur la grandeur passée de la recherche française et son déclin dans le temps[15] », la décennie 1960 est emportée par une véritable foi dans le progrès scientifique et dans les avancées techniques. Les réflexions planificatrices concernent alors principalement le secteur industriel, dont on veut favoriser le potentiel innovant et compétitif, mais les sciences sociales et humaines sont également touchées. Elles sont en effet considérées par le Commissariat général du Plan comme un moyen « de mieux connaître la société, ce que les gens font, ce qu’ils dépensent et comment ils vivent[16] », comme le rappelle Edmond Lisle dans un entretien pour La Revue pour l’histoire du CNRS. C’est, en fait, toute une époque qui est prise dans ce bain progressiste, relayé par un imaginaire techniciste et moderniste, dont le structuralisme dans son ensemble témoigne à sa manière [17].
Temps 1 – Les années 1960 : programmer la science
Tant Barthes que Genette et Todorov s’illustrent dans ces discours qui entendent programmer la science, relayant un imaginaire conquérant, affichant une foi en l’avenir et une confiance dans la possibilité d’œuvrer collectivement à l’avènement de nouveaux paradigmes scientifiques. Bien que ces énoncés n’épuisent pas, loin s’en faut, le rapport que ces théoriciens entretiennent avec l’avenir, et qu’ils n’en révèlent de prime abord que la face heureuse, ils sont néanmoins très présents dans le temps de la genèse des disciplines sémiologique et poétique.
Faut-il ainsi rappeler que le projet sémiologique trouve son origine dans un projet de Saussure, dont il s’agit à la fois d’inverser le programme, et de programmer le renversement ? Barthes ne cessera ainsi, dès la parution de Mythologies en 1957, d’insister sur la nature spéculative de la sémiologie : « Comme étude d’une parole, la mythologie n’est en effet qu’un fragment de cette vaste science des signes que Saussure a postulée il y a une quarantaine d’année sous le nom de sémiologie. La sémiologie n’est pas encore constituée [18] ». Sur la prédiction de Saussure, Barthes postule lui-même une science, qui contrairement à la linguistique, n’a alors d’existence qu’au futur : « Il faut peut-être partir du projet sémiologique. Le terme et le projet viennent de Saussure : il prévoyait une science générale des signes dont la linguistique ne serait qu’un département, département évidemment très en avance puisque déjà constitué [19] », lit-on dans Sémiologie et cinéma en 1964. Sept ans après « Le mythe aujourd’hui », c’est toujours sous le signe de la prévision, du projet, de l’espoir que Barthes place la sémiologie, ce qu’il fait encore dans le numéro « Recherches sémiologiques » de la revue Communications. On peut y lire ainsi, dans la présentation signée par l’essayiste :
Sémiologie : le mot est proposé ici dans un esprit de confiance, mais aussi de retenue. Dans son sens actuel et du moins pour nous, européens, il date de Saussure […]. Prospectivement – puisqu’elle n’est pas encore constituée – la sémiologie a donc pour objet tout système de signes, quelle qu’en soit la substance, quelles qu’en soient les limites. […]. Il y a aujourd’hui une sollicitation sémiologique, issue non de la fantaisie de quelques chercheurs, mais l’histoire même du monde moderne.
Cependant, le mot n’est pas sans inconfort, celui-là même d’un projet qu’on affirme sans cesse et qu’on accomplit difficilement : il y a beaucoup de danger à programmer une science avant qu’elle soit constituée, c’est-à-dire en somme, enseignée ; et c’est un fait, la sémiologie se cherche lentement [20].
On le voit : c’est autant une volonté militante qu’un sens de la précaution qui guide ici Barthes. Celui-ci se montre en effet très conscient des dangers inhérents au coup de force consistant à prédire, non pas dans la science (toute science consiste à produire des énoncés prédictifs [21]), mais une science. Trait classique de l’éthos scientifique [22], cette prudence tient aussi, il faut le souligner, à la relative faiblesse institutionnelle dont cette science en prévision pâtit déjà. L’EPHE, où Barthes est directeur d’études depuis 1962, est une institution certes prestigieuse, mais néanmoins périphérique [23], et n’est en tous les cas pas le lieu à partir duquel il est le plus aisé de créer des disciplines qui feront l’objet d’un enseignement durable à l’université [24]. Barthes fait ainsi part de ces freins d’ordre institutionnel :
Nous sommes encore peu nombreux, nos moyens sont modestes, chacun doit souvent faire face à plusieurs tâches à la fois. En exposant nos difficultés et nos espoirs, en mettant la sémiologie à l’épreuve au moment même où nous acceptons son vocabulaire et ses méthodes, nous souhaitons mettre à jour les raisons de son retard et les voies de son progrès – voire, comme on l’a dit, de sa transformation [25].
Si l’on résume, la sémiologie, alors qu’elle n’est pas encore constituée, est ainsi déjà en retard. C’est qu’en fait, il me semble, l’ambition holiste et extensive dont se dote la sémiologie dès ses débuts ne peut que souffrir d’emblée du manque de moyens dont Barthes témoigne ici. Car dès 1964, l’horizon de la sémiologie est en effet sans cesse repoussé : « […], progressant désormais dans des travaux concrets, nous espérons élargir peu à peu l’étude des communications de masse, rejoindre d’autres recherches, contribuer avec elles à développer une analyse générale de l’intelligible humain [26] ». Ainsi cette nouvelle science, « restant à édifier [27] », comme le note Barthes en introduction de ses Éléments de sémiologie dans le même numéro de Communications, est légitimée par l’essayiste à la faveur, tout à la fois, de son inscription dans une actualité immédiate (elle est sollicitée par « l’histoire même du monde moderne ») ainsi que de son aspiration à rejoindre des questions fondamentales et universelles (« l’intelligible humain »). Barthes procède de la sorte à une double qualification de la sémiologie, la situant dans des temporalités différenciées mais complémentaires : d’une part, la sémiologie est éveillée par la modernité, postulée avant d’être illustrée, elle se veut toujours en avance, c’est-à-dire toujours éphémère car toujours en construction. D’autre part, cette même discipline est aimantée par des aspirations anthropologiques qui la placent, face à des exigences toujours plus importantes, toujours en retard.
La sémiologie n’en est donc qu’à ses balbutiements ; mais il faut aussi souligner que cela ne retient pas Barthes d’en penser déjà la fin et le dépassement. Dans ses Éléments de sémiologie, il affirme ainsi que tout méta-langage peut devenir à son tour un « langage-objet d’un nouveau méta-langage » :
Ce serait le cas de la sémiologie, par exemple, le jour où elle serait « parlée » par une autre science ; si l’on acceptait de définir les sciences humaines comme des langages cohérents, exhaustifs et simples (principe empirique de Hjelmslev), c’est-à-dire comme des opérations, chaque science nouvelle apparaîtrait alors comme un méta-langage nouveau qui prendrait pour objet le méta-langage qui la précède, tout en visant le réel-objet qui est au fond de ces « descriptions » ; l’histoire des sciences humaines serait ainsi, en un certain sens, une diachronie de méta-langages, et chaque science, y compris bien entendu la sémiologie, contiendrait sa propre mort, sous forme du langage qui la parlera [28].
Selon cette vision cyclique du temps qu’on trouve ici, les sciences succèdent aux sciences, c’est « l’histoire même [qui] renouvelle les méta-langages [29] ». La naissance des sciences ainsi que leur mort semblent ainsi, chez Barthes, avoir été pensées de façon concomitante, dans le même temps de la pensée et dans les mêmes gestes d’écriture : prédire l’apparition ne semble pas aller sans prédire l’achèvement. Chaque science porte en elle à la fois la promesse d’un avenir et celle de sa propre destruction, et l’on verra que les deux ne s’ordonnent pas toujours chez Barthes selon cette logique rappelant celle du temps biologique.
Mais reprenons. Toujours en avance, toujours en retard : cette tension temporelle – dont on peut se demander si elle ne témoigne pas aussi de la persistance de cette rhétorique du retard propre aux années 1950 évoquée plus haut –, n’empêche pas le projet sémiologique de se développer grâce aux efforts communs de chercheurs, notamment de l’EPHE, rassemblés autour du CECMAS et de la revue Communications [30]. On voit ainsi apparaître dans celle-ci la rubrique « Chroniques sémiologiques », dont le titre témoigne paradoxalement d’une tout autre relation au temps que celle décrite plus haut : inscrite dans un temps quotidien, ces chroniques se veulent le lieu de la recherche en marche, telle qu’elle se construit au présent, au jour le jour. Or, si cette recherche se développe incontestablement en produisant des résultats tangibles, un discours futuriste semble pourtant là encore dominer ces productions, à tel point que celui-ci commence à irriter certains « sémiologues » de l’époque, à l’instar de Todorov, qui y voit surtout une source de piétinement. Dans son article, « Perspectives sémiologiques » qui paraît dans la rubrique « Chroniques sémiologiques » du n° 7 de Communications (1966), le théoricien pose le constat réjoui que « la solitude en sémiologie n’existe plus [31] » et que le temps des pionniers est en quelque sorte révolu. Mais il conclut son texte par quelques propos moins enthousiastes. Aux yeux de Todorov, la sémiologie tarde à se constituer comme une discipline autonome car, d’une part, elle peine à « isoler un champ qui lui soit propre » et, d’autre part, elle se contente parfois « de nommer des phénomènes bien connus » avec les outils nouveaux de la linguistique, ce qui ne peut suffire « pour faire un pas en avant [32] ». Plus que comme une discipline, la sémiologie gagnerait à se penser, selon Todorov, comme une épistémologie :
Ces perspectives nous paraissent beaucoup plus prometteuses dans le cas où le rôle de la sémiologie se réduit à donner un cadre général ou quelques principes fondamentaux. Ces principes peuvent établir l’unité des sciences humaines actuelles, mais non pas prescrire la forme que prendront les recherches dans chaque domaine particulier. Unir la psychologie, la sociologie, la musicologie, la poétique en une seule science et l’appeler sémiologie n’est pas une condition nécessaire à leur progrès ; par contre, chacune de ces disciplines peut profiter d’une explication et d’une formulation plus précise de ses postulats dans le cadre sémiologique. […].
C’est peut-être ainsi qu’on arrivera à abandonner le conditionnel et les verbes modaux, en parlant de la sémiologie : on n’a que trop entendu ce qu’elle veut, peut ou doit nous faire connaître. Il est temps de commencer à employer l’indicatif et de dire ce qu’elle est [33].
Derrière cet appel à écrire la sémiologie au présent, il convient de souligner avant tout les traces d’un moment de concurrence disciplinaire. Je m’explique : Todorov qui, depuis en 1964, s’attachait à trouver chez les Formalistes les bases théoriques nécessaires à une science de la littérature baptisée ici du nom – à la fois ancien et moderne – de « Poétique », se montre soucieux de donner de l’espace à cette nouvelle doctrine. Comment ? Précisément en déniant à la sémiologie un statut disciplinaire au nom de son incapacité, en tant que telle, à cesser de se projeter dans le futur pour investir un présent et œuvrer au développement cumulatif des connaissances. Cette incapacité, pour Todorov, est ici moins une réelle inquiétude que le prétexte utile pour reléguer la sémiologie à un niveau certes plus haut (épistémologique), mais moins invasif, laissant du champ pour le développement d’autres sciences. C’est à l’occasion de la participation de Todorov, deux ans plus tard, à l’ouvrage Qu’est-ce que le structuralisme ? dirigé par François Wahl que l’on trouvera une première synthèse de cette « poétique structurale » en voie de constitution [34] – constitution dont dépend à nouveau, entre autres choses, une autonomisation par rapport à la sémiologie.
Ce présent de l’indicatif que Todorov appelle de ces vœux équivoques en 1966, ce n’est pas Barthes qui l’investira, malgré le chantier porteur qu’il ouvre la même année avec son « Introduction à l’analyse structurale des récits », article où il tâche de contribuer à la construction immédiate d’une linguistique des discours calquée sur la linguistique de la phrase. L’initiative lancera durablement les études narratologiques, desquelles, pour sa part, Barthes s’éloigne néanmoins rapidement. Cet investissement plein et concret sera en effet le dernier ; désormais Barthes s’écarte du projet sémiologique de la première heure. Ainsi, en 1967, il publie Le Système de la Mode, en prenant le soin de faire précéder l’ouvrage d’un avant-propos dans lequel il signale que « ce travail a été commencé en 1957 et terminé en en 1963 », c’est-à-dire qu’il a été rédigé à une époque où
[…] la sémiologie restait encore une discipline entièrement prospective ; tout travail de sémiologie appliquée devait donc prendre naturellement la forme d’une découverte, ou plus exactement d’une exploration, tant les résultats étaient incertains et les moyens élémentaires ; face à un objet précis (en l’occurrence le vêtement de Mode), muni seulement de quelques concepts opératoires, l’apprenti sémiologue partait à l’aventure [35].
Ainsi, « par rapport au nouvel art intellectuel qui est en train de s’ébaucher », la sémiologie du Système de la Mode, est « déjà datée », et l’ouvrage constitue « déjà une certaine histoire de la sémiologie [36] » affirme Barthes, assumant par là l’archaïsme théorique de sa méthode. Sans transition, l’exploration sémiologique du discours de mode et le programme méthodologique formulé à l’occasion passent du statut pionnier de projet à celui de ruine et de témoignage, tant le temps présent s’éprouve alors sous l’aspect continuel de l’ébauche et de la novation. Périmé sitôt qu’énoncé, le discours sémiologique, sous la plume de Barthes, ne peut s’inscrire dans un présent, aussi précaire et fugitif soit-il. C’est toujours à la fois sous le signe du retard et de l’esquisse que Barthes appréhende la sémiologie. Cette sorte d’impossibilité temporelle vient trouver, à l’époque de la rédaction du Système, une nouvelle forme d’expression dans l’idée d’utopie. Le sémiologue écrivait en effet en conclusion au chapitre « Signifiant, signifié » des Éléments de sémiologie :
[…] la tâche future de la sémiologie est beaucoup moins d’établir des lexiques d’objets que de retrouver les articulations que les hommes font subir au réel ; on dira utopiquement que sémiologie et taxinomie, bien qu’elles ne soient pas encore nées, sont peut-être appelées à s’absorber un jour dans une science nouvelle, l’arthrologie ou sciences des partages [37].
Le propos de Barthes est ici radical : la sémiologie n’est pas seulement déjà datée au moment où elle s’énonce, elle est déjà caduque avant même d’être née, et c’est l’énoncé projectif lui-même qui est dès lors touché par l’utopie. Si la figure de l’utopie (scientifique) marque surtout le discours de Barthes à partir du début des années 1970, avec L’Empire des signes et Sade, Fourier, Loyola, il est intéressant de la repérer ici au cœur des années sémiologiques, années aux ambitions scientistes desquelles Système de la Mode oppose une première prise de distance explicite [38]. Comme le dit Thiphaine Samoyault, la parution du Système de la Mode est aussi l’occasion pour Barthes de préciser, dans les entretiens qui suivent la sortie du livre, que « son objet principal est la littérature et que, pour cette raison, même s’il lui paraît intéressant d’éprouver des méthodes scientifiques, son but n’est pas la science elle-même [39] ». Le discours utopique de 1965 témoignait déjà, semble-t-il, des prodromes de ce phénomène de recul. Un tel discours place en effet la recherche dans un temps indéfini et suspendu, qui diffère de celui de la « science normale » selon l’expression de Kuhn, vectorisé, orienté vers la progression des savoirs, destinés à être repris, repensés, corrigés, par la communauté scientifique [40]. Bien que Barthes puisse produire des énoncés, à cette époque, allant dans ce sens, il me semble qu’il faut les comprendre plutôt comme des déclarations de principe que comme une réelle profession de foi dans le progrès de la science sémiologique, qu’il formulerait à son propre compte. Ainsi, par exemple, de la déclaration de l’essayiste en 1967, à propos de ces récents travaux, qu’ « il s’agit essentiellement de provoquer et d’aider des recherches [41] ». Concernant « L’analyse structurale des récits », Barthes affirme la nécessité que ce texte soit « suivi d’analyses concrètes qui le reprennent et le corrigent », mais force est de constater que ce n’est pourtant plus lui qui alimentera ce dialogue, s’engageant dans une voie plus singulière et plus solitaire dès 1970 avec S/Z – bien que cette nouvelle sémiologie soit à nouveau solidaire d’un mouvement théorique collectif, mais non savant cette fois : le textualisme.
Temps 2 – Les années 1970 : science versus théorie
De leurs côtés, tout au contraire, Todorov et Genette choisissent tous les deux la voie savante, en s’engageant dans la défense et l’illustration de la poétique moderne, dont la revue et la collection « Poétique », cofondée en 1970 avec Hélène Cixous, sera l’organe [42]. Portée par l’élan de la décennie précédente, cette discipline (re)naissante trouve l’une de ses premières applications dans le domaine de l’analyse du récit, qui avait été défriché quelques années plus tôt par Barthes. Avec Figures III, on voit Genette se placer tout entier dans le temps linéaire et progressiste du cours de la recherche, auquel, comme on l’a dit, Barthes se soustrait alors tout en encourageant d’autres que lui à poursuivre l’investigation. Dans l’après-propos à « Discours du récit », Genette écrit, à propos du catalogue de concepts qu’il vient d’exposer :
Cet arsenal, comme tout autre, sera inévitablement périmé avant quelques années, et d’autant plus vite qu’il sera davantage pris au sérieux, c’est-à-dire discuté, éprouvé, et révisé à l’usage. C’est un des traits de ce que l’on peut appeler l’effort scientifique que de se savoir essentiellement caduc et voué au dépérissement : marque toute négative, certes, et d’une considération plutôt mélancolique pour l’esprit « littéraire », toujours porté à escompter quelque gloire posthume, mais si le critique peut rêver d’une œuvre au second degré, le poéticien, lui, sait qu’il travaille dans – disons plutôt à – l’éphémère, ouvrier d’avance dés-œuvré [43].
À la tête de la revue et collection « Poétique », Genette s’engage très nettement dans cet « effort scientifique » collectif, et les propositions théoriques de « Discours du récit » seront durablement discutées, continuées, rectifiées au fil des années et des publications [44]. Le futur de la poétique est pensé, selon Genette à cette époque, non pas sur le mode de l’extension et de l’aventure comme c’était le cas pour la sémiologie du milieu des années 1960, mais sur celui du renouvellement et du perfectionnement. Le poéticien ne souhaite pas défricher sans cesse de nouveaux territoires armés de quelques outils rudimentaires mais plutôt affiner, en ouvrier appliqué, et avec l’aide d’autres manœuvres, ses instruments d’investigation, pour une connaissance toujours plus fine du domaine littéraire. Ainsi, Genette espère que « toute cette technologie […] – prolespes, analepses, itératif, focalisations, paralispses, métadiégétique, etc. […] – ira rejoindre d’autres emballages perdus dans les décharges de la Poétique [45] », pour être remplacés par des outils mieux dégrossis (une « technologie » plus performante). Or, dès le tout début des années 1970, cette vision est concurrencée par une vue davantage extensionniste, portée par Todorov qui écrit ainsi en 1973 :
La poétique est donc appelée à jouer un rôle éminemment transitoire : elle aura servi de « révélateur » des discours, puisque les espèces les moins transparentes de ceux-ci se rencontrent en poésie ; mais cette découverte étant faite, la science des discours étant inaugurée, son rôle propre se trouve réduit à peu de chose : à la recherche des raisons qui faisaient considérer, à telle ou à telle époque, certains textes comme « littérature ». À peine née, la poétique se voit appelée, par la force même de ses résultats mêmes, à se sacrifier sur l’autel de la connaissance générale. Et il n’est pas sûr que ce sort doive être regretté [46].
Il est ainsi tout particulièrement frappant de voir Todorov, qui s’était dans les années 1960 appliqué à rendre autonome la poétique face aux ambitions généralistes de la sémiologie, revenir à celle-ci (nommée plutôt désormais « symbolique ») sitôt la poétique dotée de sa revue et de sa collection. Ces déclarations influenceront la discipline poétique, qui se montera de plus en plus consciente de participer à sa mesure, c’est-à-dire de façon partielle, à une typologie générale des discours, mais elles n’affecteront pas le cœur du paradigme, condamnant dès lors Todorov à s’en éloigner peu à peu, jusqu’à la publication en 1984 de Critique de la critique, livre d’adieu à la poétique que suivra son départ de « Poétique » quelques années plus tard [47].
Au début des années 1970, Todorov accorde ainsi à la science littéraire une visée holiste tout comme Barthes le faisait dans la décennie précédente. Dès lors, qu’elle se projette, sous la plume de Genette, à la faveur un imaginaire techniciste ou, à la manière de Todorov, vers sa propre dilution (ou sacrifice) dans (pour) une science plus fondamentale, la poétique semble dominée dans les deux cas par un régime de futurité propre aux disciplines savantes (et propre au structuralisme dans le second cas [48]). Une petite nuance tout de même : Todorov, en effet, n’est pas loin de développer une vision utopique de la science proche du genre de celle que nous avions repérée, chez Barthes, dans Éléments de sémiologie. On peut le penser, par exemple, lorsqu’on lit le chapitre « Ouverture » de Théories du symbole publié en 1977. Se retournant sur son travail et se demandant si sa recherche a pris un tour classique (produisant dès lors un traité universel) ou romantique (produisant dès lors une histoire des différences), il écrit ainsi, en commentaire final à la troisième voie, « ni classique, ni romantique », qu’il espère avoir empruntée :
Histoire ou traité ? L’opposition historique des classiques et des romantiques nous a occupés autant que celle, systématique, entre signe et symbole ; il ne s’agit pourtant pas d’un simple alliage. Je n’en dis pas beaucoup, je le sais ; mais pour le faire, il faudrait s’essayer soi-même à une « théorie du symbole » – ce qu’il n’y avait pas lieu de commencer ici ; ce qui ne pourra se produire que par la construction d’une symbolique du langage [49].
Cette « symbolique du langage », laissé ici en suspens et sans éléments de détail, apparait donc comme une sorte d’horizon idéal, presque augural, pour Todorov [50], le situant alors quelque peu en dehors, ou au-delà, du rythme normal de la marche de la science qu’investi pour sa part pleinement Genette. On trouve ainsi, par exemple, dans Introduction à l’architexte, les linéaments de Palimpsestes et dans Palimpsestes l’annonce de Seuils [51], etc. : autant de prolepses qui mettent en scène une progression patiente dans la connaissance des relations transtextuelles, édifiées en tant qu’objets électifs de la poétique au milieu des années 1970, succédant dans ce rôle à la notion de littérarité réputée périmée. Notons enfin que ces relations transtextuelles sont aussi offertes à l’échange scientifique, au gré des numéros thématiques de Poétique, en amont ou en aval des ouvrages de la collection : « Intertextualités » (n° 27, 1976), « Paratexte » (n° 69, 1987), etc.
Genette, en tant qu’auteur et en tant qu’éditeur, participe dès lors aux développements d’une poétique que Barthes aurait qualifiée de « science positive », selon la définition qu’il donne à cette formule dans sa Leçon en 1978, en contraste de sa sémiologie « négative » et « active », qu’il construit solitairement, s’ « obligeant à taire […] toute la sémiologie, celle qui se cherche et s’impose déjà comme science positive des signes, et qui se développe dans des revues, des associations, des universités, et des centres d’études [52] ». Mais il ne faut pas attendre 1978 pour voir Barthes contester explicitement la science sous son jour institutionnalisé, disciplinaire ou collectif. À l’heure où Genette et Todorov fondaient, avec Cixous, la collection et la revue Poétique, Barthes s’éloignait déjà d’une conception traditionnelle de la science [53], comprise comme un corps de doctrines destiné à être communiqué à des pairs, et à des étudiants, dans le but d’œuvrer à l’accroissement des connaissances scientifiques elles-mêmes et pour elles-mêmes. En 1970, Barthes affirme ainsi, à l’occasion de la sortie de Sèméiotikè. Recherches pour une sémanalyse de Kristeva (1969), que « la science des langages ne peut être olympienne, positive (encore moins positiviste), indifférente, adiaphorique, comme dit Nietzsche [54] ». La science, dès lors, doit se réformer sous le signe de la théorie qui selon Barthes n’est
ni une abstraction, ni une généralisation, ni une spéculation, c’est une réflexivité ; c’est en quelque sorte le regard retourné d’un langage sur lui-même (ce pour quoi, dans une société privée de la pratique socialiste, condamnée par là à discourir, le discours théorique est transitoirement nécessaire) [55].
L’abstraction, la généralisation, la spéculation, c’est-à-dire autant de mouvements de l’esprit propres à une discipline telle que poétique, qui accorde un primat à une logique déductive pour rendre compte de la dimension abstraite ou virtuelle du fait littéraire plutôt que de ses réalisations singulières. À rebours des disciplines savantes de ce type, la réflexivité promue par Barthes institue la théorie en tant qu’écriture (ou Texte) et situe celle-ci dans un temps qui n’est plus celui, linéaire et indéfini, de la science en progrès. Barthes en dit plus dans un entretien « Sur la théorie », donné la même année, pour la revue VH 101. S’épanouissant dans des formes non transparentes, non dissertatives, non continues, la théorie est un « un discours complet, c’est-à-dire réflexif, mais en état de sursis permanent » : elle se dirige vers sa propre destruction, qui arrivera avec l’avènement d’une société désaliénée, auquel elle doit participer en se gardant d’être récupérée, réifiée, par la science. « Il faut donc mener cette activité théorique [56] », affirme Barthes, car c’est d’elle, aux côtés de la pratique sociale, que viendra la Révolution dans sa dimension négative ou négatrice : destruction de la société capitaliste, et destruction du discours intellectuel tel qu’il y circule, c’est-à-dire isolé de la pratique. Selon la vision eschatologique de Barthes (ou apocalyptique, car liée à la destruction de l’ancien monde), « l’homme n’aura plus besoin d’un discours de type réflexif ou intellectuel. La théorie sera entièrement politisée. Elle sera dans la révolution elle-même et donc, à ce moment-là, il n’y aura plus lieu d’opposer la théorie et la pratique [57] ». La théorie œuvre ainsi à sa propre mort, qui en sera l’épanouissement ultime, et elle constitue, en attendant, la seule voie possible pour faire « avancer le travail, la recherche, sans se laisser enfermer dans un signifié qu’on appelle maintenant “transcendantal”, que ce soit Dieu ou que soit la ratio, la raison, ou que ce soit la science [58] ». La théorie n’est pas ici transitoire au sens où la science l’est, sous la plume de Todorov à la même époque : elle n’est pas appelée à se sacrifier sur « l’autel de la connaissance générale », mais elle est vouée à œuvrer « transitoirement » pour la subversion de la société capitaliste occidentale, subversion qui précipitera sa propre fin. Nous sommes bien loin ici du mode de périssement des sciences « positives » que Barthes décrivait en 1964 dans ses Éléments de sémiologie. On pourrait ainsi être tentée d’opposer, d’un côté, une vision cyclique du temps, propre aux sciences « positives » (ou disciplines) et, de l’autre, une vision eschatologique propre à la théorie (ou sciences « négatives »). Mais sans doute cette distinction vaut-elle surtout pour cette courte période de la vie de Barthes, marquée par son adhésion fugace et distante à l’idéologie maoïste, médiatisée par ses amis de « Tel Quel » [59]. Très vite, Barthes prend en effet ses distances avec le maoïsme de la revue menée par Sollers, et plus largement avec le textualisme. De ce point de vue, l’année 1973 est une année décisive dans le rapport de Barthes à la théorie : de façon concomitante, il écrit pour l’Encyclopaedia Universalis un article sur la “Théorie du Texte» et il publie Le Plaisir du texte où apparaissent certaines réticences à l’encontre de celle-ci [60]. Ces critiques se feront plus nettes encore avec la publication, en 1975, de Roland Barthes par Barthes :
Refaisons ce parcours. À l’origine de l’œuvre, l’opacité des rapports sociaux, la fausse Nature ; la première secousse est donc de démystifier (Mythologies) ; puis la démystification s’immobilisant dans une répétition, c’est elle qu’il faut déplacer : la science sémiologique (postulée alors) tente d’ébranler, de vivifier, d’armer le geste, la pose mythologique, en lui donnant une méthode ; cette science à son tour s’embarrasse de tout un imaginaire : au vœu d’une science sémiologique succède la science (souvent fort triste) des sémiologues ; il faut donc s’en couper, introduire, dans cet imaginaire raisonnable, le grain du désir, la revendication du corps : c’est alors le Texte, la théorie du Texte. Mais de nouveau le Texte risque de se figer : il se répète, se monnaye en textes mats, témoins d’une demande de lecture, non d’un désir de plaire : le Texte tend à dégénérer en Babil. Où aller ? J’en suis là [61].
Aux yeux de l’autoportraitiste qui se retourne sur son parcours théorique (le terme est ici pris dans un sens courant), c’est d’un seul et même mouvement que participent le passage de la sémiologie vivifiante à la « science (souvent fort triste) des sémiologues » et celui du Texte désirant au Texte en train de se figer. Le Texte, dans lequel Barthes plaçait tous ses espoirs en 1970 est ainsi, quelques années plus tard, en proie au ressassement. Ainsi la théorie semble-t-elle reprise ici, au même titre que la science, dans une dynamique cyclique selon laquelle chaque paradigme se dégrade et laisse place à un autre, et ainsi de suite.
Dynamique cyclique, ou plutôt spiralique : c’est, en effet, le moment où l’on voit revenir chez Barthes des aspirations sémiologiques. Mais, alors déplacées, celles-ci s’éloignent franchement de la sémiologie scientiste de la première vague, incarnée par la figure du savant [62]. Il s’agit désormais d’une sémiologie personnelle, « négative », qui s’exprime surtout dans la leçon inaugurant la chaire de « Sémiologie littéraire ». Poursuivons la citation que j’en ai déjà donnée plus haut :
La sémiologie proposée ici est donc négative – ou mieux encore, quelle que soit la lourdeur du terme : apophatique : non en ce qu’elle nie le signe, mais en ce qu’elle nie qu’il soit possible de lui attribuer des caractères positifs, fixes, anhistoriques, acorporels, bref : scientifiques [63].
Qu’on ne s’y trompe pas, la négation évoquée dans ces lignes n’a rien de comparable au projet apocalyptique attribué à l’activité théorique en 1970. L’apophatisme, ici, confine directement à l’utopie, comme l’indique la proximité étymologique des deux termes. Barthes formule dans sa leçon les termes d’une nouvelle relation à la science, placée sous le signe du désir, de l’affect, du goût individuel, du plaisir, de l’invention, de la recréation, etc. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, de telles vues s’exprimaient déjà dans la série d’utopies scientifiques qui émaillent le livre. Citons quelques-unes de ces sciences qui ne sont en aucun lieu :
Science paradoxale de la différence :
Toujours penser à Nietzsche: nous sommes scientifiques par manque de subtilité. – J’imagine au contraire, par utopie, une science dramatique et subtile, tendue vers le renversement carnavalesque de la proposition aristotélicienne et qui oserait penser, au moins dans un éclair : il n’y a de science que de la différence [64].
Science inouïe des degrés :
Tout discours est pris dans le jeu des degrés. On peut appeler ce jeu : bathmologie. Un néologisme n’est pas de trop, si l’on en vient à l’idée d’une science nouvelle : celle des échelonnements de langage. Cette science sera inouïe, car elle ébranlera les instances habituelles de l’expression, de la lecture et de l’écoute (« vérité », « réalité », « sincérité » ; son principe sera une secousse : elle enjambera, comme on saute une marche, toute expression [65].
Science intégrative des effets de langage :
Nouveau sujet, nouvelle science
Il se sent solidaire de tout écrit dont le principe est que le sujet n’est qu’un effet de langage. Il imagine une science très vaste, dans l’énonciation de laquelle le savant s’inclurait enfin – qui serait la science des effets de langage [66].
Science regrettée du signal :
Au carrefour de toute l’œuvre, peut-être le Théâtre : il n’y a aucun de ses textes, en fait, qui ne traite d’un certain théâtre, et le spectacle est la catégorie universelle sous les espèces de laquelle le monde est vu. Le théâtre tient à tous les thèmes apparemment spéciaux qui passent et reviennent dans ce qu’il écrit : la connotation, l’hystérie, la fiction, l’imaginaire, la scène, la vénusté, le tableau, l’Orient, la violence, l’idéologie (que Bacon appelait un « fantôme de théâtre »). Ce qui l’a attiré, c’est moins le signe que le signal, l’affiche : la science qu’il désirait, ce n’était pas une sémiologie, c’était une signalétique [67].
Que ces énoncés soient ou non teintés d’ironie, ils ne témoignent pas moins du versant joyeux du rejet, chez Barthes, de la science instituée [68]. Ils sont autant de projections personnelles, utopiques, ludiques, subversives, de sciences qu’ils ne s’agit plus de programmer mais d’imaginer, de désirer, d’éprouver intérieurement. Tout se passe comme si Barthes ne projetait plus la science dans un temps social [69] (ou collectif, celui d’une communauté savante) mais, au contraire, en résorbait l’inscription en lui-même, dans le temps subjectif de sa conscience intérieure.
Relectures en guise de conclusion
Le milieu des années 1970, on l’a vu plus haut, correspond d’ailleurs au moment où Barthes se met à relire son parcours, à l’écrire et le réécrire : introspectif et rétrospectif, cet exercice l’amène à se pencher sur la sémiologie de la première heure, dont il se souvient du programme et des tâches. C’est à partir de ce regard en arrière que nous conclurons notre enquête sur les théoriciens et l’avenir.
Dans « L’aventure sémiologique », texte datant de 1974, Barthes revient sur son parcours sémiologique, qu’il découpe en trois temps (l’émerveillement, la science, le Texte) et il est intéressant de voir comment il relit la seconde période, le moment collectif, le moment scientiste :
Pour moi, ce qui domine cette période de mon travail, je crois, c’est moins le projet de fonder la sémiologie en science, que le plaisir d’exercer une Systématique : il y a, dans l’activité de classement, une sorte d’ivresse créative qui fut celle de grands classificateurs comme Sade et Fourier ; dans sa phase scientifique, la sémiologie fut pour moi cette ivresse : je reconstituais, je bricolais (en donnant un sens élevé à cette expression) des systèmes, des jeux ; je n’ai jamais écrit de livres que pour le plaisir : le plaisir du Système remplaçait en moi le surmoi de la Science […] [70].
Barthes s’emploie ici à faire coïncider son passé sémiologique avec le nouveau regard qu’il pose sur la science au moment où il écrit ses lignes. Lorsqu’en 1964, il énonçait, dans Communications, le programme d’une science sémiologique, c’était déjà, en fait, le plaisir, le goût du jeu et du bricolage qui le guidait… C’est alors aux autres qu’il fait porter entièrement le projet sémiologique dans sa version positive : la science s’élaborait « à côté de [lui] », selon « l’origine, le mouvement et l’indépendance propre à chaque chercheur » : « des jonctions sont faites avec de grands aînés, tels Jakobson et Benveniste, et des chercheurs plus jeunes tels que Bremond et Metz ; une Association et une Revue internationale de sémiologie sont créées [71] ». Alors que Barthes a participé pleinement, quoique brièvement, à ce projet collectif, il fait ici remonter sa bifurcation personnelle aux tous premiers temps de celui-ci. C’est donc sans rupture que Barthes présente l’évolution de son rapport à la sémiologie, qu’il vient alors à nouveau qualifier d’ « aventure », en affirmant cette fois le caractère singulier qu’il attache à ce terme : « Qu’est-ce donc pour moi, la sémiologie ? C’est une aventure, c’est-à-dire ce qu’il m’advient (ce qui me vient du Signifiant) [72] ». Si la sémiologie est une épopée, c’est donc une épopée intérieure, qui ne cesse d’advenir au sujet, qui s’écoule à un rythme hors du temps social, qui s’éprouve dans la durée « au-dedans de nous », selon le concept et les mots de Bergson dans son Essai sur les données immédiates de la conscience [73].
Pour toute personnelle que soit devenue la sémiologie littéraire de Barthes, le texte de « L’aventure sémiologique », avant d’être publié dans Le Monde du 7 juin 1974, avait pourtant été prononcé dans un cadre institutionnel, celui du premier congrès international de sémiologie, organisé à Milan. Dans les fragments inédits du Roland Barthes, on trouve un texte qui revient sur cet événement, sous le titre « Ce que devient la sémiologie ». Barthes se montre alors plus critique envers ce qu’il nomme « la sémiologie de masse », et ces critiques se cristallisent autour de l’influence montante de Peirce, au détriment de Saussure : « oublier Saussure, c’est renoncer à tout le social du signe ; s’enticher de Peirce, c’est réduire le monde à une logique : à partir de Peirce, la formalisation, véritable maladie infantile de la sémiologie, déferle sur les textes [74] ». On retrouve ici la « science (souvent fort triste) des sémiologues », selon la formule publiée dans le Roland Barthes. Cette critique était bien sûr imprononçable comme telle devant une assemblée où figuraient certains de ces anciens compagnons de route, dont Todorov qui intervient sur « La sémiotique de la littérature [75] ». Or l’image que Barthes reprend dans sa conférence pour rendre compte, de façon plus diplomatique, de son expérience sémiologique me semble tout à fait pertinente. Barthes se demande en effet : « Comment ces trois expériences sémiologiques, l’espoir, la Science, le Texte, sont-elles présentes en moi aujourd’hui ? » :
On dit que le roi Louis XVIII, fin gourmet, se faisait cuire par son cuisinier plusieurs côtelettes empilées les unes sur les autres, dont il ne mangeait que la plus basse, qui avait ainsi reçu le jus filtré des autres. De la même façon, je voudrais que le moment présent de mon aventure sémiologique reçoive le suc des premiers […] [76].
Si certains passages de « L’aventure sémiologique » peuvent peut-être relever de la mauvaise foi (ainsi lorsque Barthes semble laisser aux autres le lancement institutionnel du projet sémiologique), il n’en est rien ici. « La sémiologie littéraire » qu’il pratique dès lors au présent, sans plus la planifier, sera bel et bien nourrie de ces différentes strates sémiologiques. Comment le rapport à l’avenir en est-il alors affecté ? Comment Barthes exprime-t-il cette durée prospective intérieure, éprouvée « au-dedans » ? À la projection, au temps des programmes, succède celui de l’oubli. Dans la Leçon, l’essayiste dit parler à partir d’un « nouveau lieu », il est entré dans une vita nuova :
J’entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante : l’oubli. Il est un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; mais il en vient ensuite un autre où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas : cela s’appelle chercher. Vient peut-être maintenant l’âge d’une autre expérience : celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l’oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l’on a traversés [77].
La planification des années 1960 est loin, et c’est à la fois le fantasme et l’inattendu ou l’incident qui guident la recherche. La sémiologie est donc « ce qu’il m’advient », mais aussi, pourrait-on dire, « ce qui survient », ce qui arrive à l’improviste, sans s’être annoncé, et qui trouvera un Barthes disponible [78].
Qu’en est-il alors des savants à qui s’adresse Barthes à Milan en 1974 ? Qu’en est-il de Todorov, présent dans le public, et de Genette ? Qu’en est-il de la poétique ? Doit-on retenir seulement son inscription dans une temporalité progressiste et normée de la science ? Certes, on l’a vu (surtout avec Genette), cet imaginaire moderniste de l’obsolescence à la fois programmée et créatrice (car devant laisser place à un produit de meilleure qualité) est présente dans leur discours théorique. Reste que nous avons jusqu’ici laissé de côté un phénomène qui intervient lors des tout premiers temps de cette discipline. Il peut passer inaperçu, mais il est à mes yeux crucial car il me semble qu’il pèsera durablement sur le rapport à l’avenir propre aux poéticiens. Il s’agit d’une sorte d’hiatus : la poétique moderne, au moment de sa stabilisation, semble en effet se constituer en contradiction avec la modernité littéraire et savante, dans laquelle ses (re)fondateurs avaient pourtant été immergés et qui représente toujours pour eux le cadre de références légitime. Les déclarations militantes de Genette, par exemple, « la théorie littéraire, […], sera moderne, et liée à la modernité de la littérature, ou ne sera rien [79] », semblent alors entrer en opposition avec les problématiques dont cette poétique s’empare (les genres littéraires, les catégories du récit, etc.), et que la modernité s’attache précisément à révoquer (sous la notion de Texte, par exemple). Todorov s’interroge alors, dans son Introduction à la littérature fantastique, publié en 1971 : « Un livre n’appartient plus à un genre, tout livre relève de la seule littérature, comme si celle-ci détenait par avance, dans leur généralité, les secrets et les formules qui permettent seuls de donner à ce qui s’écrit réalité de livre » (Le livre à venir, p. 243-244). Pourquoi alors soulever ces problèmes périmés ? Gérard Genette y a bien répondu : « Le discours littéraire se produit et se développe selon ses structures qu’il ne peut même transgresser que parce qu’il les trouve, encore aujourd’hui, dans le champ de son langage et de son écriture » (Figures II, p. 15) [80].
Si la poétique est moderne, ce n’est donc qu’à rebours ou par la négative, en venant seulement nommer, montrer, décrire la norme à transgresser. Cette situation évoluera avec le temps, notamment lorsque la poétique s’ouvrira aux problématiques liées à l’intertextualité, à partir de Palimpsestes. Mais il me semble que ce trouble des débuts, qui a placé les poéticiens en contradiction avec eux-mêmes, a conditionné un regard prudent (ou sceptique) sur l’avenir, qui a contribué à la pérennité de la discipline [81]. De cette sorte de péremption originelle, de cette déception initiale qui les a tenus dans les franges de la modernité, la poétique et les poéticiens semblent avoir conservé une certaine tempérance, que l’on a déjà observée dans les prolepses genettiennes. Point de Plan quinquennal pour la poétique, c’est de livre en livre, pas à pas, qu’elle se projette et s’invente car, comme le dit Genette, « le temps est plus court en prolepse qu’en analepse [82] ». La temporalité de cette discipline pourrait en effet être décrite avec les termes du poéticien dans Épilogue :
Je ne savais trop ce qu’on pouvait entendre par le mot « avenir ». J’en dois à Talleyrand une définition prudente, quoique cynique, dont je vais désormais me contenter : c’est « la semaine prochaine » ; au-delà, c’est l’inconnu – à vrai dire, c’est parfois bien moins que cela : des souris et des hommes, les projets sont souvent à trop long terme pour aboutir à mieux qu’une déconvenue [83].
La poétique, en proie à un avenir à court terme, a ainsi trouvé à durer collectivement. Au modèle intime et singulier de la durée barthésienne, on pourrait alors opposer la métaphore des Argonautes et de leur vaisseau. Métaphore également fréquente sous la plume de Barthes, qui lui consacre un fragment de son autoportrait :
Image fréquente : celle du vaisseau Argo (lumineux et blanc), dont les Argonautes remplaçaient peu à peu chaque pièce, en sorte qu’ils eurent pour finir un vaisseau entièrement nouveau, sans avoir à en changer le nom ni la forme. […] à force de combiner à l’intérieur d’un même nom, il ne reste plus rien de l’origine : Argo est un objet sans autre cause que son nom, sans autre identité que sa forme [84].
La poétique, à l’instar d’Argo, a conservé son nom mais a renouvelé sans cesse ses objets et ses problématiques, si bien qu’aujourd’hui la collection « Poétique » s’est par exemple ouverte à la critique génétique, au cognitivisme, et à la philosophie analytique… autant de paradigmes qui n’existaient pas dans sa définition initiale, centrée sur la littérarité et une approche formaliste de la littérature [85]. Certains poéticiens ont, comme Todorov, quitté le navire, d’autres, comme Genette, se sont accrochés au mât, d’autres encore sont venus prendre la relève. Il y a fort à parier que ce roulement continu et mesuré des Argonautes de la théorie aura permis à la poétique d’être, elle aussi, disponible, ouverte à l’imprévu, prête à suivre dans ses louvoiements la pensée théorique de la littérature de notre temps. La théorie a-t-elle donc un avenir ? On ne sait ce que Barthes aurait répondu à Vincent Kaufmann, mais voici, en guise de dernier mot (suspensif), la réponse de Genette :
La poétique existe depuis plus de deux millénaires, avec des moments d’éclipse et des moments d’éclat, et je n’ai guère de doutes quant à sa survie, sinon ceux, à vrai dire beaucoup plus forts, que j’éprouve sur celle de l’espèce humaine. Je ressens « le théorique », dans mon domaine et dans d’autres, comme intemporellement nécessaire et donc comme virtuellement, si j’ose ce barbarisme, « irrévoluble » [86].
[1] Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Éditions du Seuil, 1998 et Tzvetan Todorov, La Littérature en péril, Paris, Éditions Flammarion, 2007. D’autres études prennent acte également du climat décliniste qui touche les lettres et la théorie littéraire aujourd’hui et multiplient les points de vue sur le débat, toujours actuel, concernant la survie ou l’effondrement de la littérature. On pense ainsi notamment à William Marx, L’Adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation, XVIIIe– XXe siècles, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxes », 2005 ; à Dominique Maingueneau, Contre Saint Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin, 2006, et aux deux tomes de Dominique Viart et Laurent Demanze (dir.), Fins de la littérature. Esthétique et discours de la fin, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2012.
[2] Voir sur ce point Lionel Ruffel, Le Dénouement, Lagrasse, Verdier, « Chaoïd », 2005.
[3] Vincent Kaufmann, La Faute à Mallarmé. L’aventure de la théorie littéraire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2001, p. 225-314.
[4] Voir à ce propos le n° 8 (2011) de la revue Fabula LhT consacré aux « Partages des disciplines » et plus particulièrement, dans celui-ci, l’article de Nathalie Kremer, « La littérature en mal de disciplines ? ». On pourra aussi consulter à ce propos les argumentaires de deux colloques, « Littérature : où allons-nous ? » (3-5 octobre 2012) et « Littéraires, de quoi sommes-nous les “spécialistes» ? » (25-28 juin 2014), disponibles tous les deux sur le site internet du Mouvement Transitions. URL : http://www.mouvement-transitions.fr. Page consultée le 17/02/2018.
[5] Connaissant Barthes depuis le milieu des années 1950, Genette incite Todorov à suivre le séminaire de ce dernier à l’École Pratique des Hautes Études dès l’année 1963. C’est ainsi auprès de Barthes, de son séminaire et de la revue que celui-ci cofonde, Communications, que le deux théoriciens trouvent un premier réseau de chercheurs dont l’influence sera déterminante pour le développement de leur pensée respective ainsi que pour la construction commune de la discipline poétique, telle qu’elle est refondée à la fin des années 1960. Concernant ces années, on se référera au livre d’entretien de Todorov avec Catherine Portevin (Tzvetan Todorov, Devoirs et Délices. Une vie de passeur, Paris, Éditions du Seuil, 2002) ainsi qu’à la série autobiographie de Genette inaugurée par Bardadrac en 2006 (Gérard Genette, Bardadrac, Paris, Seuil, coll. « Fictions & Cie », 2006).
[6] Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, op. cit., p. 10.
[7] Selon l’expression de Christophe Meurée dans le numéro des Lettres romanes qu’il a dirigé en 2013 sur « Le souci de l’avenir chez les écrivains francophones ».
[8] Pierre Macherey, « Histoire des savoirs et épistémologie », dans Revue d’histoire des sciences, tome 60, 2007/1 (Tome 60), § 6. URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2007-1-page-217.htm. Page consultée le 12/02/2018.
[9] Ibid., § 5.
[10] François Hartog, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2003, p. 117.
[11] Antoine Compagnon, Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 48.
[12] La revue et la collection « Tel Quel » accueillent également les premiers articles et ouvrages de Genette et Todorov. Ainsi, par exemple, de Théorie de la littérature (1965) de Todorov et de Figures I (1966) et de Figures II (1969).
[13] Il faut noter ici que la proximité de Barthes, Todorov et Genette avec certaines avant-gardes ne conditionnent pas tout de leur inscription dans la modernité. Les disciplines sémiologique et poétique se développent, en fait, en rupture avec la « conjonction » caractéristique de la modernité, c’est-à-dire le pacte entre « les pratiques de l’art, les illusions de l’absolu philosophique, les promesses de la communauté politique », tel que le décrit Rancière (Jacques Rancière, « La communauté esthétique », cité par Lionel Ruffel, « Le Temps des spectres », dans Bruno Blanckeman et Jean-Christophe Millois (dir.), Le Roman français aujourd’hui : transformations, perceptions, mythologies, Paris, Prétexte, coll. « Critique », 2004, p. 103).
[14] Julie Bouchard, Comment le retard vient au français. Analyse d’un discours sur la recherche, l’innovation et la compétitivité. 1940-1970, Villeneuve d’Acq, Presses Universitaires du Septentrion, 2008, p. 183.
[15] Ibid., p. 178.
[16] Edmond Lisle, « Les sciences sociales en France : développement et turbulences dans les années 1970 », dans La Revue pour l’histoire du CNRS, n° 7, 2002, § 11. URL : http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/543. Page consultée le 12/01/2018. Sur les politiques culturelle de la Planification à partir de 1961 et le rôle joué à cet égard par les enquêtes sociologiques, lire aussi Philippe Poirrier, « Les pratiques culturelles au cours des années 1960 et 1970 » dans Jean Claude Grohens et Jean-François Sirinelli (dir.), Culture et action chez Georges Pompidou, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 123-138.
[17] Voir, pour le structuralisme, Thomas Pavel, Le Mirage linguistique, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1988. Concernant l’histoire culturelle des années 1960-1970, on se pourra se référer à Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Histoire culturelle de la France. Le temps des masses. Le XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 2005 et Kristen Ross, Rouler plus vite, laver plus blanc, Paris, Abbeville, 1997.
[18] Roland Barthes, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Pierres Vives », 1957, repris dans Œuvres Complètes, éd. Éric Marty, Paris, Éditions du Seuil, 5 tomes, 2002 (désormais OC), t. I, p. 825. Je souligne.
[19] Roland Barthes, « Sémiologie et cinéma », dans Image et Son, juillet 1964, repris dans OC, t. II, p. 622.
[20] Roland Barthes, « Présentation », dans Communications, « Recherches sémiologiques », n° 4, 1964, repris dans OC, t. II, p. 567.
[21] À propos de la portée prédictive des sciences, voir notamment Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essai », 1990 [1976].
[22] Robert K. Merton s’est attaché à décrire l’éthos scientifique à partir de quatre normes : l’universalisme, le communalisme, le désintéressement, le scepticisme organisé (Robert K. Merton, The Sociology of Science. Theoretical and Empircal Investigations, Chicago, University of Chicago Press, 1973). On pourra lire aussi le n° 41 de la revue Lidil, dirigé en 2010 par Françoise Block et Fanny Rinck, « Pour une approche énonciative de l’écrit scientifique ».
[23] Pour un portrait du champ universitaire français de l’époque et l’analyse des oppositions qui le structure, je renvoie à Pierre Bourdieu, « Espèce de capital et formes de pouvoir », dans Homo academicus, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 99-167.
[24] Or la question de l’enseignement est centrale pour Barthes à cette époque, comme en témoigne les très pédagogiques Éléments de sémiologie.
[25] Roland Barthes, « Présentation », op. cit., p. 569.
[26] Ibid.
[27] Roland Barthes, « Éléments de sémiologie », dans Communications, « Recherches sémiologiques », n° 4, 1964, repris dans OC, t. II, p. 657.
[28] Ibid., p. 697.
[29] Ibid., p. 698.
[30] Concernant le parcours sémiologique de Barthes, je me permets de renvoyer Fanny Lorent et Thomas Franck, « Le projet sémiologie de Barthes dans la revue Communications », dans Revue Roland Barthes, n° 3, 2017. URL : http://www.roland-barthes.org/article_lorent_franck.html. Page consultée le 13/02/2018.
[31] Tzvetan Todorov, « Perspectives sémiologiques », dans Communications, « Radio-télévision : réflexions et recherches », n° 7, 1966, p. 139.
[32] Ibid., p. 145.
[33]Ibid.
[34] La définition qu’en livre Todorov doit alors beaucoup à la notion de « science de la littérature », telle qu’elle est détaillée par Barthes dans Critique et vérité en 1966 : « Cette science aura deux grands territoires, selon les signes dont elle traitera ; le premier comprendra les signes inférieurs à la phrase, tels les anciennes figures, les phénomènes de connotation, les « anomalies sémantiques », etc., bref tous les traits du langage littéraire dans son ensemble ; le second comprendra les signes supérieurs à la phrase, les parties du discours d’où l’on peut induire une structure du récit, du message poétique, du texte discursif, etc. » (Roland Barthes, Critique et vérité, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel Quel », 1966, repris dans OC, t. II, p. 790-791).
[35] Roland Barthes, Système de la Mode, Paris, Éditions du Seuil, 1967, repris dans OC, t. II, p. 897.
[36] Ibid.
[37] Roland Barthes, Éléments de sémiologie, op. cit., p. 671.
[38] L’année 1967 correspond également, selon François Dosse, au premier mouvement de reflux du structuralisme. Les recherches se poursuivent mais à un rythme moins soutenu et selon une dynamique moins spectaculaire. C’est l’heure où le structuralisme trouve enfin un certain succès institutionnel, qui se réalisera pleinement avec la création du Centre Expérimental de Vincennes en 1968, dans le sillage duquel la revue et la collection « Poétique » seront d’ailleurs fondées par Genette, Todorov et Hélène Cixous, qui est aux commandes du « noyau cooptant » chargé de recruter les nouvelles équipes de professeurs. À ce propos, voir François Dosse, Histoire du structuralisme. Tome 2 : Le chant du cygne, 1967 à nos jours, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte/Poche », 2012 [1991].
[39] Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fictions & Cie », 2015, p. 360-361.
[40] À propos de la « science normale », voir Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p. 17-71.
[41] Roland Barthes, « Sur le “Système de la Mode” et l’analyse structurale des récits », dans Les Lettres Françaises, 2 mars 1967, repris dans OC, t. II, p. 1300.
[42] Pour une présentation générale de la revue, on pourra se référer à Fanny Lorent, « La revue Poétique » dans La Revue des revues, n° 56, 2016, p. 10-33, ainsi qu’à la notice « Poétique » de Florian Pennanech dans Bruno Curatolo (dir.), Le Dictionnaire des revues littéraires au XXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2014. On pourra aussi consulter le n° 10 de la revue LhT Fabula consacré à « L’aventure poétique », paru en décembre 2012 et dirigé par Florian Pennanech.
[43] Gérard Genette, Figures III, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 269.
[44] Il serait vain ici de tenter d’indiquer toutes ces reprises et corrections mais notons qu’elles débutent dès l’année qui suit la parution de Figures III avec l’article de Gérald Prince, « Introduction à l’étude du narrataire », dans Poétique, n° 14, juin 1973, p. 178-198.
[45] Gérard Genette, Figures III, op. cit., p. 269.
[46] Tzvetan Todorov, La Poétique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Sciences Humaines », 1973 [1968], p. 109. On repère des déclarations similaires dès 1971 dans Tzvetan Todorov, « Introduction à la symbolique », dans Poétique, n° 11, septembre 1971.
[47] En 1979, Genette et Todorov, alors seuls à la tête de Poétique et « Poétique » depuis 1974, cédèrent la direction de la revue à Michel Charles, qui la dirige toujours à nos jours. En 1987, Todorov quitte ensuite la collection, en en laissant dès lors toute la responsabilité à Genette.
[48] Dans son chapitre sur « Les années 1960 et l’utopie », Jean Laurexois rappelle ainsi, à la suite de Thomas Pavel, la croyance du structuralisme en la capacité des « nouvelles formes conceptuelles » à « saisir la totalité de la connaissance et de rendre compte de la totalité du réel, selon les procédures d’une systématique nouvelle » (Jean Laurexois, L’utopie Beaubourg, Vingt ans après, Paris, Éditions de la BIP, 1996, p. 39).
[49] Tzvetan Todorov, Théories du symbole, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1977, p. 636.
[50] Rétrospectivement, on sait aujourd’hui que Todorov s’est lancé dans une exposition théorique du « symbolisme linguistique » avec Symbolisme et interprétation, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1978. Mais il demeure que ce type d’annonce est marqué par ce que l’on pourrait nommer un « ton utopique » qui diffère de la projection savante habituelle. De plus, on peut noter que le terme « symbolique » que Todorov souhaite substituer à celui de « sémiotique » (« La sémiotique n’est une discipline valable que si elle est synonyme de symbolique », ibid., p. 16) ne s’est pas imposé et que ses recherches sont restées plutôt solitaires.
[51] La voici, survenant lors d’un commentaire des différents types de relations transtextuelles : « Le second type est constitué́ par la relation, généralement moins explicite et plus distante, que, dans l’ensemble formé par une œuvre littéraire, le texte proprement dit entretient avec ce que l’on ne peut guère nommer que son paratexte […]. Je ne veux pas entamer ou déflorer ici l’étude, peut-être à venir, de ce champ de relations, que nous aurons d’ailleurs maintes occasions de rencontrer, et qui est sans doute un des lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l’œuvre, c’est-à-dire de son action sur le lecteur – lieu en particulier de ce que l’on nomme volontiers, depuis les études de Philippe Lejeune sur l’autobiographie, le contrat (ou pacte) générique » (Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1982, p. 13).
[52] Roland Barthes, Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France prononcée le 7 janvier 1977, Paris, Éditions du Seuil, 1978, repris dans OC, t. V, p. 440.
[53] L’article « Par où commencer ? » que donne Barthes pour le n° 1 de la revue Poétique peut ainsi être considéré comme la marque d’un patronage paradoxal. Très pédagogique, cet article prenant pour commencement le point de vue d’un étudiant voulant se lancer dans l’analyse structurale d’un roman de Jules Vernes n’est alors pas du tout représentatif du tournant textualiste que Barthes est alors en train d’engager. L’enseignement, qui était une préoccupation importante du Barthes sémiologue des années 1960, devient à cette époque l’objet d’une attention plus périphérique, alors que la revue et la collection « Poétique », profitant de l’institutionnalisation du structuralisme après mai 68, sont justement très soucieuses de se constituer avant tout comme des outils aux services des étudiants et des chercheurs en littérature.
[54] Roland Barthes, « L’Étrangère », dans La Quinzaine Littéraire, 1er mai 1970, repris dans OC, t. III, p. 478.
[55] Ibid., p. 477-478.
[56] Roland Barthes, « Sur la théorie », dans VH 101, été 1970, repris dans OC, t. III, p. 692.
[57] Ibid., p. 693.
[58] Ibid., p. 693.
[59] Pour l’histoire de la revue Tel Quel : Philippe Forest, Histoire de Tel Quel (1960-1982), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fictions & Cie », 1995. Sur la question du maoïsme du groupe « Tel Quel » : Ibid, p. 378 et suivantes.
[60] Pour une analyse plus détaillée, je renvoie à Adrien Chassain, « Théorie », dans Claude Coste (dir.), Dictionnaire Barthes, Paris, Honoré Champion, à paraître.
[61] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1975, repris dans OC, t. IV, p. 650.
[62] Concernant la sémiologie littéraire de Barthes au Collège de France, on pourra lire Sémir Badir et Dominique Ducart, Barthes en cours (1977-1980). Un style de vie, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, coll. « Écritures », 2009.
[63] Roland Barthes, Leçon, op. cit, p. 441.
[64] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 735.
[65] Ibid., p. 646.
[66] Ibid., p. 656.
[67] Ibid., p. 749.
[68] Ces gestes se rapprochent d’un autre, que Barthes placera sous le signe de la jouissance dans son cours Comment vivre ensemble : ouvrir un dossier : « Ouvrir un dossier : acte encyclopédique par excellence. Diderot a ouvert tous les dossiers de son époque. Mais en ce temps, acte effectif, car le savoir pouvait être maîtrisé, sinon par un homme (comme du temps d’Aristote ou de Leibniz), du moins par une équipe. ≠ Aujourd’hui : plus d’exhaustivité possible du savoir, entièrement pluralisé, diffracté en langages incommunicants. L’acte encyclopédique n’est plus possible (cf. échec des encyclopédies actuelles) – mais le geste encyclopédique a pour moi sa valeur de fiction, sa jouissance : son scandale (Roland Barthes, Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens. Notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1976-1977, Textes établi, annoté et présenté par Claude Coste, Paris, Éditions du Seuil/IMEC, 2002, p. 182).
[69] Pour une mise au point historique de la notion de « temps social », voir l’ouvrage de Thomas Hirsch, Le Temps des sociétés. D’Émile Durkheim à Marc Bloch, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. « En temps & lieux », 2016.
[70] Roland Barthes, « L’aventure sémiologique », dans Le Monde, 7 juin 1974 repris dans OC, t. IV., p. 523.
[71] Ibid.
[72] Ibid., p. 522.
[73] Sur l’idée de durée, voir plus particulièrement le chapitre « De la multiplicité des états de conscience » dans Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 6e édition, Paris, Alcan, 1908, p. 57-106.
[74] Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur. Séminaire à l’école pratique des hautes études. 1973-1974. Suivi de fragments inédits du Roland Barthes par Roland Barthes, Édition présentée et établie par Anne Herschberg Pierrot, Paris, Éditions du Seuil, 2010, p. 30.
[75] Voir Seymour Chatman, Umberto Eco et Jean-Marie Klinkenberg, A semiotic landscape/Panoramo sémiotique. Actes du premier congrès de l’Association internationale de sémiotique, Milan 1974, The Hague, Éditions Mouton, 1979.
[76]Roland Barthes, « L’aventure sémiologique », op. cit., p. 525.
[77] Roland Barthes, Leçon, op. cit, p. 446.
[78] Conformément à ces nouvelles conceptions, le geste électif de Barthes à cette époque s’épanouit, on l’a dit (voir note 69), dans « l’ouverture de dossiers », retrouvant par là une approche extensive proche de celle de la sémiologie des années 1960. Mais désormais cette activité est portée par une volonté, non plus savante, mais encyclopédique, au rythme des lectures et découvertes d’un Barthes aimant se penser comme un amateur. Amateur non plus seulement dans son sens étymologique, comme l’essayiste le mobilisait en 1967 (voir « Sémiologie et urbanisme », conférence organisée par l’Institut français de l’Institut d’histoire et d’architecture de l’Université de Naples, texte repris dans OC, t. II, p. 1277-1286), mais aussi avec l’idée que sa recherche n’est plus en rien celle d’un expert, d’un professionnel.
[79] Gérard Genette, Figures III, op. cit., p. 11.
[80] Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1970, p. 12.
[81] Le cadre de cet article ne le permet pas mais il serait tout à fait intéressant de se pencher sur la façon dont la sémiologie (ou plus tard, la sémiotique), telle qu’elle continue à vivre sans Barthes mais avec Greimas, Metz, Rastier, Klinkenberg et bien d’autres, a trouvé elle aussi à durer jusqu’à nos jours. Très organisée, dotée de plusieurs lieux de publications, de colloques et de réunions annuelles, elle est en quelque sorte moins centralisée et mieux institutionnalisée que la poétique, mais aussi plus diverse et multiple encore. Il semble aussi qu’elle ait conservé une part de la vision scientiste et progressiste qui a favorisé sa création et qu’elle est ainsi plus soucieuse que la poétique de fédérer autour d’elle des chercheurs et de rendre compte de leurs entreprises, sur le long terme. Sur le site des Actes Sémiotiques, on trouve par exemple une rubrique « Projets et programmes », dédiée à communiquer à la communauté savante les diverses initiatives collectives en cours.
[82] Gérard Genette, Épilogue, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fictions & Cie », 2014, p. 35.
[83] Ibid.
[84] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 626.
[85] Les questionnements initiaux n’ont pas été abandonnés mais, pour la plupart, mis entre parenthèses ou en sourdine, et certains trouveront à réapparaitre. Il en va ainsi de la problématique de la littérarité, qui sera explorée à nouveaux frais par Genette dans Fiction et Diction en 1991.
[86] Vincent Kaufmann, op. cit., p. 239-240.