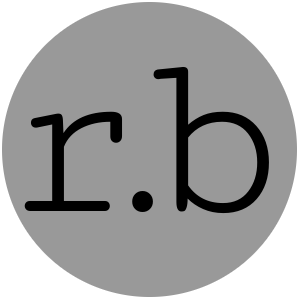[Cet article est issu d’une communication donnée à la journée d’études internationale « Que ferions-nous avec Roland Barthes ? » (Saint-Pétersbourg, décembre 2015). [1]]
Absente de l’index général des Œuvres complètes de Roland Barthes [2], la responsabilité n’en constitue pas moins une notion majeure, tant pour l’interprétation de ses textes, où elle a reçu des significations et des formes variées, que pour la compréhension générale de son parcours intellectuel ; autrement dit, c’est un élément du langage conceptuel de Barthes et aussi du métalangage critique qui permet de parler de lui. La responsabilité est l’un des principaux gestes prospectifs par lesquels l’homme engage son avenir, en assumant les conséquences de ce qu’il fait et dit. Il ne s’agit donc pas d’une anticipation proprement dite, mais d’un mouvement moral dirigé vers le futur, engageant différentes manières de construire l’avenir en répondant du monde actuel et en répondant à ses défis. Une grande leçon de Barthes est de savoir prendre et changer ses responsabilités : sans les renier ni les esquiver, se déplacer entre leurs différentes formes, se faire responsable autrement.
La langue est-elle responsable ?
« Je me suis toujours intéressé à ce que l’on pourrait appeler la responsabilité des formes » [3], disait Barthes en 1961, en dressant un premier bilan de sa carrière pour la revue Tel Quel. En effet, cet intérêt est évident au moins depuis son petit article « Responsabilité de la grammaire » publié dans Combat en 1947 sous le titre « Faut-il tuer la grammaire ? » La notion de responsabilité figure plus d’une fois dans Le Degré zéro de l’écriture (recueil d’articles d’abord publiés dans le même journal), dans les Mythologies et les Essais critiques ; par la suite, elle devient plus rare, pour réapparaître à la fin des années 1970, avec une ambiguïté surprenante. En effet, si la « responsabilité de la forme » est encore une fois affirmée dans la conférence inaugurale au Collège de France, en 1977 (nous y reviendrons) [4], un an plus tard, dans son cours sur le Neutre, Barthes semble faire une volte-face en répudiant l’idée même de « responsabilité ». Sans cesse pressé, en tant que vedette intellectuelle, de répondre à des enquêtes, il voudrait leur opposer une fin de non-recevoir :
Comment mettre sur ma demeure ou mon entreprise intellectuelle un écriteau : « Fermeture de jugement pour congé annuel » ? Qui accepterait de dire : « Je ne fais pas profession de responsabilité » – ou, parodiant M. Teste (en plus provocant) : « La responsabilité n’est pas mon fort » [5].
Barthes devait être vraiment irrité pour mettre la responsabilité, une notion si insistante et si chérie dans son œuvre, au même rang que la bêtise ! [6] Sans doute peut-on expliquer cette boutade psychologiquement, comme un simple effet de fatigue ; Barthes, lui-même, a quelquefois donné des explications de cette sorte, y compris à propos de l’(ir)responsabilité :
Aussi les situations sans responsabilité de conduite, si douloureuses soient-elles, sont vécues dans une sorte de paix. Le sujet, n’ayant rien à décider, se laisse couler, il rejoint une sorte de paresse[7].
Mais surtout, pour réduire la contradiction de ses propos, il faudrait tenir compte de la polyvalence syntaxique du mot [8] : tantôt il s’agit de la responsabilité de quelque chose (au sens objectif de la préposition : ce ne sont pas les formes elles-mêmes qui sont responsables, c’est l’homme qui l’est des formes linguistiques et culturelles qu’il emploie), et tantôt de la responsabilité devant quelqu’un (en l’occurrence, devant les journalistes importuns). Barthes joue ouvertement de cette polyvalence, mais en fin de compte son jeu s’avère sérieux, révélant une double orientation de la responsabilité comme relation morale. En effet, cette responsabilité barthésienne se déploie sur deux axes : sujet-sujet et sujet-objet. La responsabilité implique la présence d’un partenaire ou d’un juge (individuel ou collectif) à qui on répond de ce qu’on fait et dit, et d’un objet (être vivant, bien matériel, acte, énoncé, mission) considéré comme solidaire avec notre être et motivant des obligations ou le cas échéant des sanctions [9]. Chez Barthes, ces deux orientations en principe reliées de la responsabilité – vers l’objet et vers les autres hommes – sont en rapport instable, d’où l’ambiguïté de son idée de responsabilité des formes.
Déjà Saussure, dit Barthes en 1974, « responsabilisait l’étude du sens en lui donnant une portée politique » [10]. De même, on trouve dans les Mythologies une série de formules définissant la responsabilité sociopolitique, ou la responsabilité devant l’Histoire, comme Barthes préfère dire. Les deux mots, Histoire et responsabilité, vont souvent ensemble ; leurs antonymes sont nature et innocence, ce dernier mot désignant ironiquement l’irresponsabilité illusoire de la bourgeoisie :
L’Express glorifie la clôture du foyer, son introversion pantouflarde, tout ce qui l’occupe, l’infantilise, l’innocente et le coupe d’une responsabilité sociale élargie (« Conjugales » – OC I, 591).
Déchirement (cruel, douloureux). – Ce terme aide à accréditer l’idée d’une irresponsabilité de l’Histoire (« Grammaire africaine » – OC I, 647).
…le mythe central de l’art bourgeois : celui de l’irresponsabilité (« La Littérature selon Minou Drouet » – OC I, 657).
En somme l’exotisme révèle bien ici sa justification profonde, qui est de nier toute situation de l’Histoire. En affectant la réalité orientale de quelques bons signes indigènes, on la vaccine sûrement de tout contenu responsable (« Continent perdu » – OC I, 664).
Une formule antérieure du Degré zéro rend particulièrement clair, en termes sartriens, ce en quoi consiste la responsabilité historique en littérature : « Ainsi le choix, puis la responsabilité d’une écriture désignent une Liberté… » [11] On prend des responsabilités en faisant un choix, en se rangeant librement d’un côté plutôt que de l’autre dans les controverses de son temps, en privilégiant une forme, par exemple une écriture parmi d’autres (pour le premier Barthes, il y en a plusieurs). Quelques années plus tard, dans les Mythologies, cette responsabilité partiale et partielle, qui oblige l’homme et son discours à être ceci ou cela, à prendre un parti exclusif des autres, sera interprétée comme une option sémiotique :
Ce n’est certes pas qu’il n’y ait une responsabilité de la forme à l’égard du réel. Mais cette responsabilité ne peut se mesurer qu’en termes sémiologiques. Une forme ne peut se juger (puisque procès il y a) que comme signification, non comme expression (« Le mythe comme langage volé » – OC I, 703).
Or, cette dernière précision – « signification, non expression » – laisse entendre qu’il existe un code général par rapport auquel se forment et se lisent les significations particulières. On peut exprimer un mouvement isolé, ne se rapportant à aucun autre, mais seul un élément d’une opposition peut signifier : c’est ce que nous enseigne la sémiologie structurale. Le code général qui régit toutes les oppositions s’appelle la langue, s’il s’agit de communications verbales, ou la culture, si l’on y ajoute les communications non-verbales. La langue et la culture sont-elles responsables au même titre qu’une écriture particulière ?
Sur ce point-là, Barthes semble hésiter. D’une part, dans l’article déjà cité « Responsabilité de la grammaire », il répond positivement en évoquant la relativité des normes grammaticales – une relativité verticale, dépendant de la situation sociale des sujets et occultée par l’universalisme mythique du français qu’il critique :
…cette communicabilité tant vantée de la langue française n’a jamais été qu’horizontale ; elle n’a pas été verticale, elle ne s’est jamais profilée dans l’épaisseur du volume social. Le français classique […] c’est avant tout le langage d’un groupe puissant, ou bien oisif, ou bien pratiquant un travail spécial, qu’on pourrait appeler travail directorial (OC I, 79).
Parler une langue « correcte » et prétendument universelle, c’est se solidariser avec cette classe « directoriale ». La langue est politiquement appropriée, elle n’est pas une res nullius, et cette appropriation entraîne tout de suite sa stratification en plusieurs normes sociolinguistiques plus ou moins indépendantes. C’est ce qu’observe un linguiste ; mais les usagers de la langue sont enclins à l’ignorer :
On sait que la langue est un corps de prescriptions et d’habitudes, commun à tous les écrivains d’une époque. Cela veut dire que la langue est comme une Nature qui passe entièrement à travers la parole de l’écrivain, sans pourtant lui donner aucune forme […] La langue est donc en deçà de la Littérature [12].
Le langage fait faire un choix libre et par conséquent responsable entre ses formes sociopolitiques. Celles-ci ne s’appellent plus la « langue » ni la « grammaire » mais l’écriture. À la différence d’une écriture historiquement déterminée, une langue nationale comme un style individuel ne sont pas à choisir ; s’ils ne sont pas innocents, ils constituent bien une « nature » pour un homme de lettres, et Barthes reconnaît leur caractère naturel :
L’horizon de la langue et la verticalité du style dessinent donc pour l’écrivain une nature, car il ne choisit ni l’une ni l’autre (OC I, 147) [13].
La responsabilité étant liée à la liberté du choix, en l’absence de choix il ne pourrait donc pas y avoir de responsabilité de la langue, ni de la grammaire.
L’hésitation de Barthes sur la responsabilité de la langue pourrait s’expliquer par une circonstance contingente : entre 1947 et 1953, une célèbre discussion linguistique avait eu lieu en URSS, commencée par l’article de Staline « Le marxisme et les problèmes de linguistique » (1951), qui déclarait la langue nationale neutre par rapport à la division de classes. Barthes, à l’époque un homme de gauche non communiste, pouvait avoir eu vent de cette grande campagne idéologique répercutée par la presse communiste internationale, et elle pouvait infléchir son idée dans Le Degré zéro, même s’il a évité d’y faire référence. Il en fera mention (d’une façon critique) quelques années plus tard, dans la postface des Mythologies, où la langue-Nature, politiquement irresponsable et située en-deçà de la littérature, est à peu près la même chose que « le langage selon Staline » [14].
L’introduction d’une notion nouvelle, « l’écriture », destinée à saisir l’aspect responsable du langage, ne résout pas le problème de la responsabilité car cette notion-là est elle-même ambiguë. Définie au début de Degré zéro comme une option à choisir, l’écriture s’avère tout d’un coup, à la dernière page du même livre, imposée à l’écrivain par la tradition. Il est compromis avec cette écriture, autrement dit responsable de la pratiquer, et pourtant il ne la choisit pas, de même que sa langue et sa culture, donc il n’en pas responsable :
…entre ses doigts, l’Histoire place un instrument décoratif et compromettant, une écriture qu’il a héritée d’une Histoire antérieure et différente, dont il n’est pas responsable, et qui est pourtant la seule dont il puisse user (OC I, 185).
Le choix et le non-choisir
Pour résoudre la contradiction, il convient d’introduire une distinction entre deux formes de responsabilité, en partie correspondant à celle entre les deux valences syntaxiques du mot (responsabilité devant quelqu’un et responsabilité de quelque chose) : à côté d’une responsabilité partielle, résultant d’une décision plus ou moins consciente et impliquant un tri entre des formes particulières comme l’écriture – celle-ci, et pas celle-là, – il y a une responsabilité plus générale, l’acceptation (pas toujours consciente) de certaines grandes formes comme la langue. On assume ces deux responsabilités différentes par choix ou par assentiment : deux notions dont Barthes a ébauché la distinction dans sa critique théâtrale en 1956 [15], pour leur consacrer un fragment spécial de Roland Barthes par Roland Barthes (1975), « L’assentiment, non le choix ». Choisir est un acte « furieux et triomphant », « comme un taureau qui jaillit du toril dans l’arène comble », tandis qu’en donnant son assentiment on « acquiesce dans le silence » (OC III, 131), sans s’opposer aux autres options d’une manière négative et dramatique. Ces deux espèces de responsabilité s’opposent comme relative et absolue ; ou comme sélective et intégrale ; ou encore, comme sociopolitique et existentielle.
Le dernier terme fait allusion à une source probable de cette distinction : c’est la pensée de Sartre, dont on connaît l’influence sur Barthes après la guerre. La responsabilité partielle et sélective correspond de près à la notion sartrienne d’engagement. Or, il est curieux que précisément l’ouvrage théorique où Sartre traite de l’engagement en littérature ne comporte que peu d’occurrences du mot responsabilité, et pas dans le sens de l’engagement d’écrivain :
Mais dès à présent nous pouvons conclure que l’écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l’homme aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l’objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité [16].
Barthes semble partager cette idée dans les Mythologies, en chargeant la science sémiotique des mythes de dévoiler (le verbe est le même que chez Sartre) les mythes et la réalité sociale qu’ils dissimulent :
Le dévoilement qu’elle [la mythologie] opère est donc un acte politique : fondée sur une idée responsable du langage, elle en postule par là même la liberté (OC I, 717).
Il y a quand même une différence : chez Sartre, la responsabilité est attribuée moins à l’écrivain (ou au futur mythologue barthésien) qu’à ses lecteurs, qu’il doit responsabiliser par son écriture, et c’est dans cet acte de responsabilisation que consiste, en fin de compte, son engagement et son « acte politique » [17]. Il est responsable de se mettre et de mettre les autres « en face » du réel : une responsabilité qui relève d’une morale existentielle, de l’obligation d’être-devant-le-monde.
Cependant cette responsabilité universelle résulte elle-même d’un choix – d’un choix de carrière et de corporation. Sartre n’a pas négligé cet aspect de la responsabilité littéraire : écrire, dit-il,
c’est exercer un métier. Un métier qui exige un apprentissage, un travail soutenu, de la conscience professionnelle et le sens des responsabilités. Ces responsabilités, ce n’est pas nous qui les avons découvertes, bien au contraire : l’écrivain, depuis cent ans, rêve de se livrer à son art dans une espèce d’innocence, par-delà le Bien comme le Mal, et, pour ainsi dire, avant la faute [18].
Sartre dévoile l’innocence illusoire, issue d’une responsabilité trop restrictive, purement professionnelle. Barthes propose une approche plus objective, sociologique plutôt que morale, dans l’article « Écrivains et écrivants » (1960). On sait que l’opposition des deux notions éponymes y correspond à peu près à celle des écrivains purs et des intellectuels engagés : ceux-ci font un choix entre les « dialectes (par exemple marxiste, chrétien, existentialiste) » du langage social (OC I, 1280), que Barthes plus tard rebaptisera « sociolectes » et dont il décrira la « guerre » (« La guerre des langages », 1973). Les écrivants « sont des hommes “transitifs” » (OC I, 1280), des hommes du projet, dont ils sont responsables comme d’un parti pris. Il est d’autant plus remarquable que le terme de responsabilité soit employé, dans cet article, à propos de l’autre catégorie des gens de lettres : les « écrivains », pratiquant une écriture intransitive :
Ce qu’on peut demander à l’écrivain, c’est d’être responsable ; encore faut-il s’entendre : que l’écrivain soit responsable de ses opinions est insignifiant ; qu’il assume plus ou moins intelligemment les implications idéologiques de son œuvre, cela même est secondaire ; pour l’écrivain, la responsabilité véritable, c’est de supporter la littérature comme un engagement manqué, comme un regard moïséen sur la Terre Promise du réel (c’est la responsabilité de Kafka, par exemple) (OC I, 1279) [19].
La responsabilité de l’écrivain est donc un engagement manqué, c’est une responsabilité de ne pas être responsable : elle ne consiste pas à prendre position (par des « opinions » ou des « implications idéologiques ») mais précisément à ne pas le faire ; autrement dit, à saisir le monde et le langage dans leur ambiguïté, dans leur neutralité, qui sera une idée fixe de Barthes pour les années à venir. L’écriture littéraire est un art de ne pas prendre parti, de manquer son engagement, de le regarder à distance comme une terre inaccessible, et c’est à ce prix seulement (retournement dialectique) qu’elle peut répondre d’un monde qu’elle assume comme une liberté de l’homme. Cette idée de responsabilité intégrale prévaut de plus en plus chez le dernier Barthes, et c’est pourquoi il peut se permettre, en 1978, de refuser la responsabilité sélective de l’écrivant, sa disponibilité à répondre et à prendre position sans délai [20]. Mais n’oublions pas : la responsabilité de l’écrivain étant professionnelle (fondée sur le « métier », selon Sartre, ou sur « l’artisanat du style », selon Barthes – OC I, 172), elle s’appuie toujours sur un choix primordial, un choix de carrière. Son universalisme non-positionnel ne s’en base pas moins sur une position sociale.
Les avatars de la responsabilité
La double idée de responsabilité se décline à travers quelques grandes oppositions conceptuelles de Barthes, à plusieurs niveaux de sa pensée, et même au niveau de sa propre œuvre et des formes successives qu’elle a prises.
Au niveau sémiotique, c’est le couple dénotation/connotation, introduit dans les Mythologies. Si le langage dénotatif, « le langage réel du bûcheron » (OC I, 710 ; en fait, un langage plutôt utopique), se définit par l’action responsable et intégrale que le sujet exerce sur l’objet (« c’est un langage par lequel j’agis l’objet » – OC I, 709), par contre les langages de connotation, qu’ils soient taxés ou non de « mythes », sont multiples et engagés, liés à certaines classes, groupes ou causes politiques. Un signe dénote un seul objet, mais il peut connoter beaucoup de sens seconds. La pluralité des codes et des sens connotatifs sera particulièrement claire chez Barthes dans S/Z (1970), même si certains d’eux peuvent coexister sans exiger de choix.
Au niveau grammatical, c’est l’opposition sujet/prédicat. Les substantifs, que Barthes écrit souvent avec une majuscule « essentialiste » (la Littérature, l’Histoire) [21], possèdent pour lui un pouvoir unifiant, voire « un pouvoir constitutif » [22] du monde, comme c’est le cas des noms propres chez Proust (« Proust et les noms », 1967). Au contraire, les prédicats et surtout les adjectifs modulent et infléchissent ce pouvoir pour les besoins d’une cause particulière, et pour cette raison suscitent la méfiance. Barthes l’explique entre autres dans le long développement qu’il consacre à l’adjectif et qui fait partie de son cours sur le Neutre : « …le Neutre voudrait une langue sans prédication, où les thèmes, les “sujets” ne seraient pas fichés (mis en fiches et cloués) par un prédicat (un adjectif) » [23]. Autrement dit, la responsabilité globale et « constitutive » du Nom s’oppose à celle, par définition unilatérale, de l’adjectif : le sujet est essentiel, les prédicats sont accidentels.
Au niveau littéraire, c’est l’opposition déjà évoquée langue/écriture, compliquée par l’instabilité et l’ambivalence sémantique de son second terme. Si dans le Degré zéro, les écritures multiples et engagées s’opposaient à l’unité quasi-naturelle de la langue nationale (et du style individuel), après 1970 la langue est critiquée non plus comme naturelle mais comme autoritaire et injonctive (« fasciste ») [24], tandis que le mot écriture perd son pluriel pour se comprendre désormais comme une activité intégrale du Texte, qui « ne s’éprouve que dans un travail, une production » [25] et qui dépasse, en la mettant en scène, la pluralité des « sociolectes » engagés. C’est toujours le travail qui fonde la responsabilité globale : si le bûcheron hypothétique des Mythologies, par un acte total de travail, transforme un objet particulier (l’arbre en bûches), l’écrivain moderne, par l’action productive du Texte, accède sinon à l’innocence naturelle mais à la responsabilité plénière du monde et à « une idée responsable du langage » (I, 717), autrefois considérée comme une propriété du mythologue. Ce caractère global du Texte et de sa responsabilité a suggéré à Barthes l’idée d’éliminer l’Auteur individuel, cette figure fondamentale par laquelle la culture moderne définissait la responsabilité littéraire ; il est vrai qu’après avoir déclaré en 1968 « la mort de l’Auteur », il a fini par abandonner cette position trop radicale pour rétablir l’idée d’auteur [26].
Au niveau critique, c’est l’opposition science de la littérature / critique. Dans Critique et vérité (1966), la première est définie (avec une réserve hypothétique : « si elle existe un jour ») comme un « discours général dont l’objet est, non pas tel sens, mais la pluralité même des sens de l’œuvre » ; et la seconde, comme « cet autre discours qui assume ouvertement, à ses risques, l’intention de donner un sens particulier à l’œuvre » (OC II, 40) [27]. L’idée explicite de responsabilité (« qui assume […] à ses risques ») s’y associe plutôt à la critique [28], à telle ou telle méthode d’interprétation engagée et librement choisie, mais la science de la littérature a aussi sa responsabilité à elle, déterminée par le contexte historique de son exercice ; nous allons y revenir.
Au niveau socioculturel, c’est la distinction écrivains/écrivants, qui nous a déjà servi à dégager l’opposition fondamentale des deux responsabilités. Son trait déterminant, comme dans les cas des dénotation/connotation et langue/écriture, est un rapport à l’action et au travail. L’écrivain « agit, mais son action est immanente à son objet, elle s’exerce paradoxalement sur son propre instrument : le langage ; l’écrivain est celui qui travaille sa parole (fût-il inspiré) et s’absorbe fonctionnellement dans ce travail » (OC I, 1278). Par contre, les écrivants sont « des hommes “transitifs” », leur « parole supporte un faire, elle ne le constitue pas » (OC I, 1280). Si l’écrivain est responsable du monde, c’est dans la mesure où celui-ci se confond avec le langage – donc incomplètement, car il y a aussi des actions non verbalisées ; l’écrivant, lui, distingue ces deux instances, sans toutefois rejoindre l’état idéal du « bûcheron » (un homme autrement transitif) : en effet, son faire passe toujours par la médiation du langage et pour cette raison n’aboutit pas à une transformation immédiate et pleinement responsable du monde. Ainsi, l’opposition des écrivains et des écrivants caractérise non seulement deux formes de responsabilité mais aussi deux formes d’aliénation : d’une part la sacralisation (désocialisation et dépolitisation) du travail d’écrivain, et d’autre part la dévaluation des prises de parti hâtives et disparates, effectuées sans cesse par les intellectuels engagés. C’est le langage comme instance de la société et du pouvoir qui produit l’aliénation dans les deux cas.
Au niveau phénoménologique ou psychanalytique (à ce point-là, ces deux approches fort différentes convergent), c’est l’opposition corps/image, qui est particulièrement intéressante parce qu’elle n’est jamais explicitée chez Barthes, bien que chacun de ses deux termes ait des fonctions très importantes dans sa pensée. Le caractère implicite de cette opposition peut tenir à l’instabilité sémantique de son second terme. Les Mythologies, toujours dans le fameux passage du bûcheron, emploient le mot image pour désigner une aliénation connotative du sens premier du travail : dès que le langage du bûcheron n’est plus qu’un « instrument de l’arbre agi », alors cet arbre « n’a plus le sens du réel comme acte humain, il est une image-à-disposition » (OC I, 710). Ensuite, dans la période « structuraliste », l’image est pour Barthes essentiellement une image visuelle, un objet positif d’étude sémiologique (« L’Image photographique », 1961, « Rhétorique de l’image », 1964), mais après 1970 elle perd progressivement cet emploi docile pour devenir une force contraignante voire asservissante opposée au sujet : que ce soit l’image de l’être aimé (Fragments d’un discours amoureux, 1977) ou l’image de soi liée à l’Imaginaire lacanien, c’est toujours une aliénation du sujet livré à l’Autre ou aux autres : « “image” : ce que je crois que l’autre pense de moi » [29]. Par contre le corps, ce « mot-mana » du dernier Barthes [30], constitue un point d’appui et d’identité :
Ses amis de Tel Quel […] ils acceptent de parler un langage commun, général, incorporel, à savoir le langage politique, cependant que chacun d’eux le parle avec son propre corps. – Eh bien, pourquoi n’en faîtes-vous pas autant ? – C’est précisément, sans doute, que je n’ai pas le même corps qu’eux ; mon corps ne peut se faire à la généralité, à la puissance de la généralité qui est dans le langage (OC III, 229) [31].
L’intégralité du corps agissant est à ne pas confondre avec la généralité : le corps individuel est contraire à la multiplicité d’images généralisantes. Le corps incarne la totalité du sujet tandis que ses images n’en sont que des projections extérieures et partielles, soumises à des systèmes sémantiques généraux (sociaux) mais étrangers à lui. De même que la langue, le corps n’est pas une simple « nature » : on ne le choisit pas et pourtant on est responsable de ses goûts, passions et mouvements, même involontaires ; en revanche je ne suis pas responsable des images de moi que les autres peuvent se faire, et qui m’agacent même par leur inadéquation à mon être.
Enfin, au niveau biographique (et en même temps épistémologique), on peut risquer l’hypothèse que la distinction des deux responsabilités explique l’évolution de Barthes entre la science et la littérature. Il a défini sa science comme « l’activité structuraliste » (titre d’un article de 1963), et cet accent sur l’activité [32] impliquait une responsabilité : on est responsable de son activité (des résultats de celle-ci), et non de son « savoir » ni de ses « théories ». Mais la responsabilité de la science est double. Malgré ses prétentions globales, la science se divise en disciplines (moins concurrentes que coopératives, il est vrai) et surtout elle se compose d’opérations partielles, de pas méthodiques et contrôlables qu’on fait selon des choix conscients et parfois risqués. Nous avons vu que dans Critique et vérité Barthes rangeait la « science de la littérature » (structurale, bien entendu) du côté de la responsabilité intégrale, une responsabilité de connaissance objective. La suite semble lui avoir montré – il en a parlé plus d’une fois dans les entretiens autour de 1970 – que la science structuraliste s’institutionnalisait à son tour et devenait une option parmi d’autres, résultant d’un choix aussi engagé que celui d’une idéologie, d’un système de sens [33]. Son désengagement politique après 1960 aurait donc le même motif que son désengagement scientifique sept ou huit ans plus tard [34].
On le sait, après être passé « de la science à la littérature » (titre d’un article de 1967), Barthes cherchait une activité productrice dans l’écriture littéraire, le Texte comme production intégrale et neutre – dégagée des oppositions qui obligent à choisir. La littérature se définit dans Leçon (1978) par ses « forces de liberté », et cette nouvelle définition se réfère encore une fois à la responsabilité des formes :
Ce que j’essaye de viser ici, c’est une responsabilité de la forme ; mais cette responsabilité ne peut s’évaluer en termes idéologiques – ce pour quoi les sciences de l’idéologie ont toujours eu si peu de prise sur elle (OC III, 804).
Prenant en charge et mettant en mouvement les savoirs, y compris ceux de la science, la littérature assume la responsabilité de leur libération, d’une activité intégrale qui dépasse la spécialité non seulement de chaque discipline mais de la Science en général [35]. Or, encore une fois pour y arriver, Barthes a dû choisir la littérature en s’éloignant de la science [36], en inscrivant son parcours personnel dans l’opposition structurale science/littérature ; la responsabilité d’écrivain est en fin de compte sélective, comme on l’a vu déjà dans l’article « Écrivains et écrivants ». Après le passage par la science structuraliste, sa « littérature » ne pouvait plus revenir à l’innocence d’une « nature », elle ne pouvait qu’être un nouveau parti pris responsable.
Les deux formes de responsabilité sont donc réversibles, et leurs réversions correspondent aux revirements de Barthes se déplaçant entre différents discours de la culture. Son engagement structuraliste a été une étape aussi nécessaire que son engagement politique des années 50 sur son chemin vers l’écriture quasi-romanesque. Cela ne tient pas qu’aux lois de la carrière littéraire – au sens où sans cet engagement il n’aurait sans doute pas accédé à la notoriété mondiale d’un maître de la « théorie française » et n’aurait jamais accumulé le capital symbolique réalisé plus tard dans ses essais « non-engagés ». Il y a là une dialectique plus profonde : pour se totaliser et assumer la responsabilité du monde, il faut prendre position (en science et/ou en politique) et se faire donc un élément partiel de ce monde. Ou bien, rappelons-nous une fois de plus l’ambiguïté syntaxique et sémantique du verbe répondre : pour répondre d’un monde coextensif au langage – répondre en silence, car comment pourrait se dire ce qui englobe tout le langage ? – il faut produire, voire se faire soi-même une énonciation, qui répondra sérieusement aux paroles des autres et à la limite deviendra un acte significatif. L’avenir personnel que Barthes se préparait tenait à ce va-et-vient entre les mots et les silences, par lequel il a fait parvenir aux générations futures une image double de sa responsabilité.
NOTES
[1] Note de l’auteur.
[2] Éditions du Seuil, 1993-1995 (en 3 volumes) et 2002 (en 5 volumes). Pour retrouver les occurrences du mot dans les textes de Barthes, nous avons utilisé l’indexateur électronique sur le site http://www.roland-barthes.org.
[3] « La littérature, aujourd’hui » (1961) – OC I, 1283. Ici et dans la suite, les références abrégées renvoient aux Œuvres complètes de Roland Barthes en 3 volumes (éditions du Seuil, 1993-1995).
[4] Cf. aussi un petit article de 1979, « Un contexte trop brutal », qui reprend l’ancienne idée de responsabilité et la fait remonter à la critique théâtrale des années 50 et aux théories de Brecht : « Or, dès qu’il y a spectacle, j’ai besoin qu’il y ait un sens fort, unique, une responsabilité morale ou sociale. Car je suis toujours fidèle aux idées de Brecht… » (OC III, 995). Et les derniers cours de Barthes, en janvier et février 1980 : « …quelque chose qui est de l’ordre de l’idéologie revient en spirale, à la place du contenu mais à un autre niveau : la responsabilité de la forme ; chaque forme, Livre ou Album, a son enjeu, et c’est l’enjeu qu’il faut définitivement choisir ; tout le dramatisme du choix de la Forme constitue bien une épreuve (la première), et grave, car elle engage ce que je crois » (Roland Barthes, La Préparation du roman I et II, Seuil, 2003, p. 255) : « …une donnée tragique : que l’écrivain est à fond (je dirai : à mort) responsable de son écriture ; il est traversé de part en part par cette responsabilité… » (ibid., p. 316).
[5] Roland Barthes, Le Neutre, Seuil/IMEC, 2002, p. 254.
[6] Notons que Barthes avait cité la célèbre phrase de Valéry « la bêtise n’est pas mon fort » en intervenant à Cerisy en 1977 (voir « L’Image », 1978 – OC III, 871).
[7] Roland Barthes, Le Discours amoureux. Séminaires à l’École pratique des hautes études, 1974-1976, Seuil, 2007, p. 568.
[8] Lucien Tesnière a parlé dans ce sens de verbes trivalents, capables de s’employer avec trois actants, comme par exemple le sujet, l’objet direct et l’objet indirect (voir Lucien Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Klincksieck, 1959, p. 255-258). Le verbe répondre pourrait s’interpréter de la même façon, avec une configuration différente de ses valences.
[9] Jacques Derrida, en analysant la distribution sémantique du verbe répondre, remarque que « répondre de (soi) » implique l’identité d’un sujet désigné d’un nom : « “Je” suis tenu pour responsable de “moi-même”, c’est-à-dire de tout ce qui est imputable à (ce) qui porte mon nom » ; et « répondre devant » renvoie à « une instance autorisée à représenter légitimement l’autre, dans la forme institutionnelle d’une communauté morale, juridique, politique » (Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, suivi de l’Oreille de Heidegger, Galilée, 1994, p. 281, 282).
[10] « L’aventure sémiologique » (1974) – OC II, 37.
[11] Le Degré zéro de l’écriture (1953) – OC I, 148.
[12] Le Degré zéro de l’écriture – OC I, 145.
[13] En ce qui concerne la langue, cela n’est pas tout à fait exact, car l’écrivain peut changer de langue – occasionnellement, en citant un auteur ancien ou étranger, alternativement, en pratiquant tour à tour deux idiomes différents (Dante écrivant tantôt en latin et tantôt en langue vulgaire), ou définitivement, par exemple en changeant de pays (Conrad, Nabokov, etc.).
[14] « …la réserve d’un réel inaccessible à l’idéologie, comme le langage selon Staline » (Mythologies – OC I, 718).
[15] « Aujourd’hui ou Les Coréens » (OC I, 556-557).
[16] Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard Idées, 1980 [1948], p. 31.
[17] Barthes le dira encore plus tard : « …la postface des Mythologies, texte peut-être vieilli scientifiquement, mais texte euphorique, puisqu’il rassurait l’engagement intellectuel en lui donnant un instrument d’analyse et responsabilisait l’étude du sens en lui donnant une portée politique » (« L’aventure sémiologique », 1974 – OC III, 37).
[18] Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, p. 281.
[19] Le nom de Kafka peut renvoyer à un petit article de Barthes publié la même année 1960 (« La réponse de Kafka » – OC I, 1270-1273), mais aussi à quelques essais de Maurice Blanchot sur le même auteur (voir entre autres son recueil L’Espace littéraire, 1955). La critique de Blanchot, son idée de silence comme forme suprême du langage, est encore une source probable de la réflexion barthésienne sur la responsabilité d’écrivain.
[20] Cf. : « …la fonction de l’écrivant, c’est de dire en toute occasion et sans retard ce qu’il pense » (OC I, 1281) ; et par contraste, la tendance du dernier Barthes à différer ses réactions : « Fermeture de jugement pour congé annuel » (Le Neutre, p. 254).
[21] Voir l’analyse de Jean-Claude Milner, Le Pas philosophique de Roland Barthes, Verdier, 2003.
[22] « Proust et les noms » (1967) – OC II, 1370.
[23] Le Neutre, p. 85.
[24] Leçon (1978) – OC III, 804.
[25] « De l’œuvre au texte » (1971) – OC II, 1212.
[26] « …aujourd’hui je suis aux antipodes de cette attitude […] Mort, Incuriosité à Retour de curiosité, retour de l’auteur » (Roland Barthes, La Préparation du roman I et II, p. 276).
[27] Ce schéma structuraliste – une « science » globale et unitaire surplombant la multiplicité des interprétations critiques – est inverse de celui qui sera proposé en 1967 par Jean Starobinski dans son essai « La relation critique ». Selon Starobinski, qui développe l’idée du cercle, ou « parcours » herméneutique, le caractère englobant et personnel de ce parcours s’oppose à la pluralité des « techniques » d’interprétation, le parcours assurant le passage d’une technique à l’autre (voir Jean Starobinski, La Relation critique, Gallimard, 1970, p. 9-33).
[28] Plus exactement, à la « bonne » critique, consciente de son engagement, contrairement à l’objectivisme illusoire de la critique « universitaire » représentée par Raymond Picard, l’adversaire polémique de Barthes dans Critique et vérité.
[29] « L’Image » (1978) – OC III, 873.
[30] Roland Barthes par Roland Barthes (1975) – OC III, 194.
[31] La peinture abstraite (sans images) dont s’occupait Barthes en amateur lui permettait aussi d’« étendre l’exercice de [son] corps » en évitant de se prendre au « piège du langage, dans la responsabilité fatalement attachée à toute phrase » (« Le degré zéro de coloriage », 1978 – OC III, 821).
[32] Cf. l’analyse de Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, Thierry Marchaisse, 2015, p. 60-76.
[33] « Nous sommes plusieurs à penser […] qu’il y a une responsabilité sociale, historique, je ne dis pas des sens (cela, on le savait), mais aussi et surtout du sens : la cible, c’est l’aliénation, non des symboles eux-mêmes, mais des systèmes symboliques… » (entretien avec Pierre Daix, 1968 – OC II, 525).
[34] Ce n’est pas par hasard que l’éloignement de la science a coïncidé avec « l’engagement manqué » de Barthes en mai 68.
[35] « Politiquement, c’est en professant et illustrant qu’aucun langage n’est innocent, c’est en pratiquant ce que l’on pourrait appeler le “langage intégral”, que la littérature est révolutionnaire. La littérature se trouve ainsi aujourd’hui seule à porter la responsabilité entière du langage ; car, si la science a certes besoin du langage, elle n’est pas, comme la littérature, dans le langage » (« De la science à la littérature », 1967 – OC II, 429).
[36] Cela lui a fait une réputation quelque peu ambiguë, tantôt d’un « écrivain » pour qui la science ne serait qu’un masque d’occasion, et tantôt d’un penseur « post-moderne » et irresponsable.