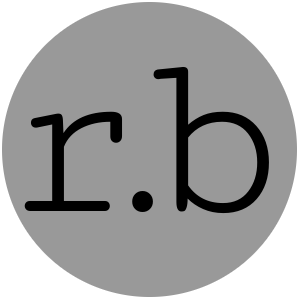« C’est fatal, juste et injuste, les livres les plus “autobiographiques” (ceux de la fin, ai-je entendu dire) commencent à la mort par dissimuler les autres. »
Jacques Derrida, « Les morts de Roland Barthes » [1981], Chaque fois unique, la fin du monde (Galilée, coll. « La Philosophie en effet », 2003, p. 96)
À partir de l’étymon grec kubernêtês ‒ « science du pilotage » ‒, Norbert Wiener forge le terme cybernetics en 1947. En tentant de perfectionner la protection antiaérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien américain a étudié la capacité d’un appareil à adapter sa marche selon des informations sur ses performances antérieures. Il en déduit une théorie plus générale de la communication et de la commande par rétroaction, qu’il synthétise dans Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948). Ses idées sont diffusées au sein de conférences, financées par une fondation, auxquelles assistent des anthropologues, des sociologues, des psychologues [1]… Sans parler de la fortune de son préfixe, la cybernétique est un « complexe d’idées » qui rend difficile une nette délimitation. Elle comprend
[a]u-delà de la théorie de la technique électrique pour la transmission des messages, […] l’étude du langage, […] l’étude des messages en tant que moyens de contrôle sur les machines et la société, le développement des machines à calculer et autres appareils automatisés analogues, certaines considérations sur la psychologie et le système nerveux, et une nouvelle théorie expérimentale de la méthode scientifique [2].
La prise en compte du hasard dans la physique via les probabilités mathématiques, la deuxième loi de la thermodynamique sur l’entropie croissante dans un système isolé et la théorie des jeux sont également récurrentes dans cette approche qui ne se confond avec aucune de ces disciplines mais consiste à les mettre en rapport selon un dessein inédit. Elle est indissociable de ce que Wiener nomme « seconde révolution industrielle » : l’invention de machines non plus seulement dotées de force physique mais aussi d’organes sensoriels, de mémoire et d’une capacité d’apprentissage pour effectuer diverses tâches selon les variations de l’environnement et dans une relative autonomie [3].
Wiener envisage des rapprochements entre machines, organismes vivants et sociétés notamment dans The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society (1950). Mais il n’hésite pas à refroidir les ardeurs de certains émules enclins à naturaliser les analogies. Il avance prudemment « que la question de savoir si ces machines [de la deuxième révolution industrielle] sont ou non vivantes est une question de sémantique » et précise « utiliser le mot vie pour qualifier tous les phénomènes qui, localement, remontent le courant de l’entropie grandissante [4] ». Le type de métaphore utilisé par Wiener semble être celui que Jacques Bouveresse excepte de son pamphlet Prodiges et vertiges de l’analogie (1999) :
il existe, dans les sciences elles-mêmes, une espèce très importante de métaphores, qui sont « constitutives de la théorie », et non pas seulement heuristiques, pédagogiques ou exégétiques. Les métaphores de cette sorte servent à formuler des assertions théoriques pour lesquelles il n’existe pas, au moins pour l’instant, de paraphrase littérale [5] .
La cybernétique se caractérise donc par une transdisciplinarité et un usage contrôlé du procédé de l’analogie homme/ machine. Elle n’est pas une approche relativement unifiée que Barthes adopte, emprunte, braconne ou bricole puisqu’elle se donne d’emblée comme une configuration plus ou moins mouvante selon l’auteur qui s’en réclame. Barthes n’en reprend pas certaines notions sur un mode métaphorique : celles-ci le sont déjà. Il s’y intéresse mais à distance : il n’y consacre aucun article ni essai. Mais on en croise des références éparses d’un bout à l’autre de son œuvre et dans les contextes les plus divers. La cybernétique est même sans doute un soubassement important de certains textes névralgiques de son parcours. Il nous faut au moins interroger cette présence à la fois discrète et persistante : la cybernétique se réduit-elle chez lui à un léger poudroiement métaphorique, voire à un aspect de son œuvre qui aurait mal vieilli et parasiterait un peu la réception de certains textes aujourd’hui ?
Précision importante, Barthes n’accède pas directement à la cybernétique américaine. C’est Claude Lévi-Strauss et Roman Jakobson, après leur exil aux États-Unis, qui ont contribué à la diffuser en France et dans le reste de l’Europe. Dans les années 1940 la Fondation Rockefeller soutient financièrement Wiener et le mathématicien Claude Shannon ainsi que Lévi-Strauss et Jakobson de manière à susciter une convergence de vues. Il s’agit de préparer une science unifiée de l’homme qui allierait sciences naturelles et sciences sociales. Jakobson reçoit une dotation pour appliquer les théories de Shannon & Weaver [6] à la linguistique du russe, ce qui « autorise la mise en place d’un dispositif inédit de circulation des savoirs, des financements et du prestige scientifique au sein d’une nouvelle communauté de chercheurs, de textes et d’institutions [7] », comme le précise Bernard Geoghegan. De même, Lévi-Strauss a négocié le soutien de la Fondation à la 6e section de l’École Pratique des Hautes Études. Ainsi se comprend « le virage opéré par Lévi-Strauss vers la cybernétique dans un effort plus vaste visant à rebâtir les sciences sociales dans la France de l’après-guerre, grâce à des moyens scientifiques et mathématiques accrus [8] ». En 1952, il est subventionné par un centre de recherches en communication du MIT pour mettre en place un séminaire hebdomadaire en France. Ronan Le Roux résume :
à l’École des hautes études, l’anthropologue a travaillé avec le mathématicien Georges Théodule Guilbaud, lequel publie en 1954 la première édition du « Que sais-je ? » sur la cybernétique, et […] il y organise un séminaire interdisciplinaire où se rencontrent spécialistes des sciences humaines et sociales (dont Benveniste, Lacan, Faucheux, Maucorps), d’une part, et d’autre part des mathématiciens français : Guilbaud, Mandelbrot, Riguet, Schützenberger, dont les trois premiers ont en commun d’être membres du « Cercle d’études cybernétiques », fondé par le polytechnicien Robert Vallée en 1949 [9].
Lévi-Strauss s’appuie sur la cybernétique dans plusieurs textes des années 1950 : « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » (Sociologie et Anthropologie), « Langage et société », « La notion de structure en ethnologie » et « Place de l’anthropologie dans les sciences sociales et problèmes posés par son enseignement » (Anthropologie structurale)… L’intégration de paramètres démographiques, géographiques, économiques, etc. afin de modéliser la façon dont une structure réagirait à des conditions réelles d’existence était bien trop complexe alors pour être véritablement réalisée. L’influence de la cybernétique chez Lévi-Strauss a été plus théorique que pratique. Elle s’est cantonnée au domaine communicationnel tout en se réduisant parfois à des approches similaires mais distinctes comme la thermodynamique. Pour Le Roux, l’anthropologue, tout comme Jakobson, disjoint ce qui constituerait le seul noyau dur de cette approche ‒ contrôle et communication ‒ au profit exclusivement du deuxième terme. Barthes a-t-il été au-delà de ce legs ? Quel en a été son usage ?
La mythologie cybernéticienne
Dans « Le cerveau d’Einstein » (Mythologies, 1957), la cybernétique n’est pas une méthode critique mais l’objet même de la mythologie en question. Dans le traitement médiatique du « génie » d’Einstein, Barthes distingue deux traits moins contradictoires que secrètement complices :
la recherche proprement dite mobilise des rouages mécaniques, a pour siège un organe tout matériel qui n’a de monstrueux que sa complication cybernétique ; la découverte, au contraire, est d’essence magique, elle est simple comme un corps primordial, comme une substance principielle, pierre philosophale des hermétistes, eau de goudron de Berkeley, oxygène de Schelling […] [10].
D’un côté, une approche matérialiste qui réduit le savant à son cerveau, l’intelligence à une partie du corps humain, la complexité de la pensée à une mécanique élaborée ; de l’autre côté, un ésotérisme de l’équation E = mc2 dont l’économie de termes contraste avec l’ampleur démesurée de son application, réalisant ainsi un vœu occultiste qui court depuis le Moyen Âge. Cybernétique ‒ la science américaine de pointe dans les années 1950 ‒ et gnose médiévale seraient donc ici l’avers et le revers d’une même mythologie [11].
Pour saisir cette distance critique de Barthes à l’encontre de la mythologie cybernéticienne, comparons ses positions sur la mort de l’Auteur avec celles d’Italo Calvino sur le même sujet. Il est très loin de ce que l’Italien prône dans une conférence de 1967 sur « Cybernétique et fantasmes ou de la littérature comme processus combinatoire ». Calvino associe les travaux des formalistes russes, de Greimas, de Lévi-Strauss, de Barthes, de Tel Quel, de l’OULIPO et de Chomsky aux travaux de Wiener, d’Alan Turing, de Shannon et de John von Neumann. Il affirme : « c’est avec sérénité et sans regret que je constate comment ma place [d’auteur] pourra être parfaitement occupée par un dispositif mécanique » [12]. Et il prophétise :
Le processus de la composition littéraire une fois démonté et remonté, le moment décisif de la littérature deviendra la lecture. […] L’œuvre ne cessera pas de naître, d’être jugée, d’être détruite ou sans cesse renouvelée au contact de l’œil qui la lit […] [13].
Barthes n’accole pas « la mort de l’auteur » à une utopie cybernéticienne. L’article de la revue Manteia, paru juste un an après la conférence de Calvino, opère certes une même corrélation ‒ « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur » (O.C. III 45) ‒ mais à partir de fondements tout autres : une historicisation philosophique et littéraire de la figure de l’auteur ainsi qu’une attention aux conséquences de son éviction pour la lecture et l’inscription dans le temps d’un texte moderne conçu comme « tissu de citations » et « activité […] contre-théologique » (O.C. III 43-44). La conscience d’une mythologie cybernéticienne a donc protégé Barthes de toute fusion inconséquente avec ce langage ‒ comme pour les autres langages qui ont pu susciter son intérêt.
Un bruit de fond
Pourtant, Barthes n’aura cessé de faire allusion à la cybernétique d’une manière à la fois prudente et suggestive. À propos des locatifs « à droite » et « à gauche » dans les romans de Robbe-Grillet, il précise : « en fait, ces termes, purement adverbiaux, ne décrivent rien : linguistiquement, ce sont des ordres gestuels, ils n’ont pas plus d’épaisseur qu’un message cybernétique. » (O.C. II 298) Il s’agit d’une notation isolée au sein d’un article, « Littérature objective » (Critique, 1954), dont la métaphoricité lorgne davantage du côté peinture et cinéma pour approcher la nouveauté de ces romans. La cybernétique n’y est qu’un langage analogique parmi d’autres essayés ‒ en l’occurrence plutôt esquissé que véritablement développé.
Mais certaines allusions sont devenues célèbres. Ainsi de la définition du théâtre comme « [u]ne espèce de machine cybernétique » (O.C. II 508) dans « Littérature et signification » (Tel Quel, 1963). Même modalisée, la métaphore est filée :
Au repos, cette machine est cachée derrière un rideau. Mais dès qu’on la découvre, elle se met à envoyer à votre adresse un certain nombre de messages. Ces messages ont ceci de particulier, qu’ils sont simultanés et cependant de rythme différent ; en tel point du spectacle, vous recevez en même temps six ou sept informations (venues du décor, du costume, de l’éclairage, de la place des acteurs, de leurs gestes, de leur mimique, de leur parole), mais certaines de ces informations tiennent (c’est le cas du décor) pendant que d’autres tournent (la parole, les gestes) ; on a donc affaire à une véritable polyphonie informationnelle, et c’est cela la théâtralité : une épaisseur de signes (je parle ici par rapport à la monodie littéraire, et en laissant de côté le problème du cinéma). (Id., Barthes souligne)
Là s’interrompt le fil. L’« épaisseur » était une qualité faisant défaut au « message cybernétique » dans l’article sur Robbe-Grillet et ce défaut qualifiait justement la nouveauté de ses romans. L’« épaisseur », au contraire, définit la « théâtralité ». C’est donc que la cybernétique ne suffit pas à rendre compte de l’expérience du spectateur. Barthes convoque alors la sémiologie et ses distinctions linguistiques (langue/ parole, dénotation/ connotation, signifiant/ signifié…). Mais le théâtre excède de nouveau cette approche. Par son hétérogénéité, sa profusion et sa temporalité, il ne se réduit ni à une machine ni à un système de signes [14].
L’apparition des métaphores cybernéticiennes épouse les infléchissements de l’œuvre barthésienne. Dans la communication « Le style et son image » au colloque de Bellagio en 1969, Barthes précise : « le style est essentiellement un procédé citationnel, un corps de traces, une mémoire (presque au sens cybernétique du terme), un héritage fondé en culture et non en expressivité » (O.C. III 980). Même si l’acception artificielle de « mémoire » est modalisée, Barthes opère ici un net changement par rapport au Degré zéro de l’écriture (1953). Le « style » n’est plus tributaire d’une métaphoricité biologique, humorale, naturelle, mais culturelle, impersonnelle, intertextuelle. Le « corps » tend au corpus.
Certaines notions cybernéticiennes apparaissent à plusieurs reprises et sur un long temps, s’appliquent à des objets souvent divers et interviennent dans des textes à visée aussi bien scientifique qu’autobiographique. Dans Système de la Mode (1967, rédigé en 1957-1963), Barthes se fait polyglotte : « pour parler un langage informatif, [le vêtement décrit] ne comporte aucun bruit, c’est-à-dire rien qui gêne le sens pur qu’il transmet : il est tout entier sens : la description est une parole sans bruit. » (OC II 919, il souligne) Dans « Le grain de la voix » (1972), il explique structuralement sa préférence musicale pour Panzéra au détriment de Fischer-Dieskau par la « pureté, je dirais presque électronique » (OC IV 152, il souligne) de son chant. La mythologie est cette fois du côté du « souffle » qui caractérise l’art du baryton allemand : « tout art exclusif du souffle a chance d’être un art secrètement mystique (d’un mysticisme aplati à la mesure du microsillon de masse) » (OC IV 151). De cette opposition entre deux chanteurs, on passe au contraste entre la mort de Mélisande chez Debussy et celle de Boris Godounov chez Moussorgski. À l’expressivité de Boris, Barthes préfère une Mélisande qui « meurt sans bruit ; entendons cette expression au sens cybernétique : rien ne vient troubler le signifiant, et donc rien n’oblige à la redondance ; il y a production d’une langue-musique dont la fonction est d’empêcher le chanteur d’être expressif » (OC IV 154, il souligne). Dans son cours sur Le Neutre (1977-1978), Barthes montre que le « silence intégral » fait comprendre par la négative à quel point « l’homme serait comme un bruit de la nature (au sens cybernétique), une caco-phonie » [15]. Dans La Chambre claire (1980), à propos de la notion de « masque » chez Calvino, il avance : « La société, semble-t-il, se méfie du sens pur : elle veut du sens, mais elle veut en même temps que ce sens soit entouré d’un bruit (comme on dit en cybernétique) qui le fasse moins aigu. » (OC V 815-818) Pour apprécier la manière dont Barthes accommode la notion, précisons que le bruit désigne deux phénomènes en cybernétique : l’un naturel, qui relève de la seconde loi de la thermodynamique, marque la déperdition croissante d’informations qui se produit dans toute communication lors du franchissement de ses étapes phonétique, sémantique et comportementale ; l’autre, culturel, réfère à des stratégies volontaires de brouillage communicationnel, à grande (propagande étatique…) ou petite échelle (deux parties qui s’affrontent lors d’un procès…), ce que modélise la théorie des jeux. Barthes reprend la notion pour cerner la pureté signifiante du vêtement, du chant, du silence et du visage. Il y a chez lui une épochè du signifiant de plus en plus radicale à l’encontre du bruit que représentent signification et expressivité, ce qui aboutira au fantasme d’une exemption du sens en passant par « le bruissement de la langue », dessinant un trajet qui irait des écritures blanches aux haïkus japonais. La notion de « bruissement » ‒ dérivée du verbe bruire ‒ opère comme une synthèse dialectique entre « bruit » et « silence » [16].
Une autre notion cybernéticienne récurrente se trouve dans « Écrivains et écrivants » (Arguments, 1960) :
Le paradoxe c’est que, le matériau devenant en quelque sorte sa propre fin, la littérature est au fond une activité tautologique, comme celle de ces machines cybernétiques construites pour elles-mêmes (l’homéostat d’Ashby) : l’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. (O.C. II 404, Barthes souligne)
La cybernétique relève ici d’une analogie explicite (« comme ») et d’un air du temps (démonstratif, parenthèses). L’appareil inventé par William Ross Ashby (1903-1972) entendait vérifier expérimentalement le fonctionnement de l’homéostasie. Il était conçu comme un îlot provisoire de résistance à l’entropie croissante dans un organisme vivant ou artificiel. Barthes rapproche ici l’homéostasie de l’autotélisme et de l’intransitivité alors en vogue dans la théorie littéraire. Claude Reichler a remarqué la résurgence de cette notion dans Sade, Fourier, Loyola (1971) : « C’est en effet le propre névrotique de l’obsession que de mettre en place une machine qui s’entretient toute seule, une sorte d’homéostat de la faute, construit de telle sorte que son seul fonctionnement lui fournit son énergie de marche » (OC III 761, sur la pratique de la « comptabilité » chez le mystique espagnol). L’homéostasie modéliserait une « obsession de l’infini » propre à Barthes [17]. On la retrouve jusque dans Comment vivre ensemble (1976-1977) lorsque le « groupe idiorrythmique » et « sans Télos » est redéfini comme « pure machine homéostatique qui s’entretient elle-même », « entretien perpétuel du plaisir pur de la socialité [18] », ce dont une certaine conception de la mondanité et l’utopie d’une société sans classes s’approcheraient imparfaitement.
Ces multiples allusions à la cybernétique n’excèdent pas jusqu’ici le stade d’un relatif isolement et d’une analogie modalisée au sein des textes où elles se trouvent. Tournons-nous à présent vers deux exemples volontairement disparates : un texte à usage personnel publié de manière posthume et une aventure collective toujours en cours.
Des briques made in China
Dans Carnets du voyage en Chine, Barthes fait de la « brique » un synonyme de « stéréotype ». Il en précise la provenance aux lecteurs du Monde dans « Alors, la Chine ? » : « Tout discours semble […] progresser par un cheminement de lieux communs (“topoi”et clichés), analogues à ces sous-programmes que la cybernétique appelle des “briques”. » (OC IV 518) Cette fois, la notion n’est pas isolée mais figure en bonne place dans l’index thématique que le voyageur a lui-même établi [19]. Face au discours du responsable d’une imprimerie à Pékin, il observe : « [Ici insertion de la brique : combattre victorieusement les influences de la clique Liu Shao Shi, etc.]/ [Ah si je pouvais enregistrer soigneusement ces briques et en montrer la combinatoire] [20] ». L’abréviation « etc. » marque bien le caractère prévisible et répétable de ce « laïus » ‒ autre terme choisi ‒ uniquement constitué d’éléments de langage dont seul peut varier l’agencement. Le responsable de l’imprimerie pékinoise est assimilé à une machine qui produit des discours formatés.
Dans son acception cybernéticienne, « brique » est déjà une métaphore de provenance architecturale. Le mot n’y a rien de péjoratif. Mais en faisant de ce terme un analogue de ce qui le fascine au plus haut point, Barthes sort celui-ci de la neutralité scientifique. Renommé ainsi, le cliché convoque un imaginaire de la lourdeur et de la compacité, voire une nuance de dureté et d’agressivité. La métaphore est remotivée : les « briques » emmurent vivant celui qui n’y prend garde. Barthes invente même l’adjectif « briqué » pour désigner cette pétrification définitive d’un être par la Doxa. Le terme pris au sens propre n’est pas absent des carnets : « [Dans la cour ‒ maisons basses en briques ‒ un très bel arbre vert clair, genre arbre de la Liberté] » (C 104). Ce paysage est presque une allégorie, traversé par une tension entre habitats contraignants et élancement végétal. Mais le végétal est lui-même menacé par un autre stéréotype à majuscule tout droit sorti de Bouvard et Pécuchet… Barthes prête attention à ce paysage ‒ bel exemple de « regard qui louche [21] » ‒ pendant un énième discours où il est justement question d’une « usine pour tailler les pierres, faire des briques » (C 104-105). Que ce soit au propre ou au figuré, dans les discours, les manufactures ou les logements, tout n’est que briques.
Choisir une telle métaphore pour désigner le stéréotype ‒ alors qu’il en forge d’autres ailleurs (la poisse, la colle…) ‒ n’est nullement hasardeux dans ce contexte : un voyage organisé du groupe Tel Quel dans la Chine maoïste alors en pleine campagne anti Confucius et Lin Piao. Il perçoit le « Totalitarisme politique absolu » (C 211) du régime à travers sa vitrine communicationnelle. La « brique » est donc une métaphore motivée à la fois par l’idiosyncrasie du critique et par son acuité politique. Elle n’épargne pas son compagnon de voyage Sollers : « [Ph. S. procède lui aussi par campagnes ‒ et c’est fatigant : par périodes, il tape toujours sur le même clou, avec variations d’exemples de preuves, plaisanteries, etc. : actuellement, c’est : Lacan en tant que suppôt de religion, idéaliste, etc.] » (C 119, il souligne). « Briques » (« les impérialistes américains », « compter sur ses propres forces », « paysans pauvres et moyen-pauvres », etc.), « campagne » (anti Confucius et Lin Piao) et « ligne » (du Parti communiste chinois) sont des notions convergentes. La cybernétique justement ne dissocie pas communication et contrôle. Barthes retrouve ici à sa manière cette imbrication fondamentale.
Wiener produit cette définition du stéréotype : « De même que l’entropie est une mesure de désorganisation, l’information fournie par une série de messages est une mesure d’organisation. […] C’est-à-dire, plus le message est probable, moins il fournit d’information. Les clichés ou les lieux communs, par exemple, éclairent moins que les grands poèmes [22]. » Il s’inquiète de la pente fasciste des États-Unis en plein maccarthysme et « chasse aux sorcières », notamment pour ce qui est du traitement contre-productif de l’information scientifique, obéré par un fétichisme du secret et des relents de manichéisme. Il est le premier à craindre l’instrumentalisation de la cybernétique à des fins technocratiques et antidémocratiques : les êtres humains ne sont pas comme des fourmis préprogrammées à accomplir une tâche unique dans la fourmilière. Wiener perçoit dans les États-Unis des années 1950 ce que Barthes observe dans la Chine des années 1970 :
[Le fait incontestable : le verrouillage complet de l’information, de toute l’information, de la politique au sexe. Le plus étonnant est que ce verrouillage soit réussi, c’est-à-dire que personne, quelle que soit la durée et les conditions de son séjour, ne réussit à le forcer sur aucun point. Dimension spécifique, aux conséquences incalculables, et que je ne vois pas bien. […]] (C 183-184, il souligne)
La Chine ainsi décrite réalise le pire cauchemar d’un cybernéticien conséquent. Mais si Barthes utilise à sa manière cette approche pour prendre du recul face aux discours officiels, il en convoque aussi librement d’autres ‒ phénoménologie, structuralisme et marxisme ‒ pour quérir du signifiant sous la chape du signifié, discerner des plis subtils dans l’anti-mode des uniformes, se laisser surprendre malgré l’absence éprouvée de dépaysement, savourer une éclaircie dans le grésil quotidien, cerner quelques accrocs dans la ligne du Parti, reconnaître des aliénations concrètes derrière les visites idylliques, entendre les inflexions d’une diction dans la dictée des discours, apprécier les calligraphies de Mao au détriment de ses portraits-chromos, saisir des degrés de fadeur dans chaque thé offert… Ce qui est présenté de la Chine durant ce voyage met à rude épreuve la visée structuraliste consistant à percevoir des différences au sein des ressemblances [23]. Et il faut toute la finesse de Barthes pour déceler ces altérations malgré tout ‒ dans le vêtement, la météo, le paysage, l’art, le thé et même la phraséologie : « [Donc, leur discours : combinatoire de briques, dont le jeu seul, très faible, laisse apparaître des différences ‒ sans doute subtiles à déchiffrer. […]] » (C 41). Il subsiste un infime « jeu » dans la mécanique réglée des « discours », une légère fissure dans le mur de « briques », une mince improbabilité dans le programme communicationnel.
Plus de dix ans auparavant, Système de la Mode comparait les modèles d’énoncés vestimentaires aux « “briques” de la machine à traduire » (OC II 984 [24]). Une note renvoyait à cette définition de Benoît Mandelbrot ‒ mathématicien franco-américain, membre du « Cercle d’études cybernétiques » et qui fréquentait le séminaire de Lévi-Strauss : « “des morceaux de calcul codés à l’avance et que l’on utilise comme briques dans la construction de tout code” » (id.). La notion était donc d’emblée prise dans un procès analogique. Des briques des énoncés de Mode pour lesquels Barthes n’exprimait aucune répulsion particulière on passe donc aux briques des discours maoïstes qui provoquent chez lui un malaise diffus ‒ considérablement atténué dans son article du Monde. Dans Système de la Mode, la notion n’était mentionnée que dans un court paragraphe. Elle devient par contre prégnante dans les carnets. Elle l’aide à supporter le voyage en Chine en mettant un mot sur son sentiment de décalage, en ménageant un recul critique par rapport au groupe, en posant même le premier jalon d’une analyse possible du discours maoïste.
Claude Coste affirme : « De la mode à la Chine, de la sémiologie scientiste à l’essayisme voyageur, la situation, comme on s’en doute, a beaucoup changé. La “brique” appartient désormais au monde de la doxa, du prêt-à-penser, de la bêtise [25]. » Tous les développements qui précèdent permettent d’apporter deux nuances :
– que la brique qualifie le discours maoïste au lieu de l’énoncé vestimentaire ne signifie pas que Barthes la répudie, et avec elle la cybernétique, et avec elle la sémiologie, et avec elle le scientisme ‒ elle en manifeste la persistance. Barthes ne jette pas le bébé notionnel, de provenance cybernéticienne, avec l’eau du bain empirique, la Chine après la Mode ;
– la distinction entre « sémiologie scientiste » et « essayisme voyageur » est par conséquent un peu trop tranchée. Les carnets ne cessent pas de mobiliser un regard sémiologique, qui n’a pour le moins pas baissé en acuité depuis Système de la Mode, et ils le mobilisent au côté d’un regard phénoménologique.
Il est donc nécessaire de revenir sur le rôle qu’a pu jouer la cybernétique dans l’aventure sémiologique et structurale dont elle semble partager le destin ‒ que ce soit pour y adhérer ou s’en séparer.
Structuralisme, sémiologie et cybernétique
Dans « L’imagination du signe » (Arguments, 1962), Barthes distingue « conscience symbolique », « conscience paradigmatique » et « conscience syntagmatique » en précisant que « c’est la conscience syntagmatique qui permet vraiment de concevoir les “programmes” cybernétiques, tout comme elle a permis à Propp et à Lévi-Strauss de reconstruire les “séries” mythiques » (OC II 463). Barthes remonte au type d’attitude mentale que présuppose la cybernétique. Il relie par ce truchement cybernétique et structuralisme ‒ qui font donc la paire à ses yeux. Mais cette « conscience syntagmatique » n’est qu’une des trois discernées. « “Programmes” » et « “séries” » sont en outre mis à distance par des guillemets tandis que les notions linguistiques sont les opérateurs mêmes de la distinction entre les trois types de « conscience ». Barthes promeut dans cet article paradigme et surtout syntagme au détriment du symbole, le signe au lieu de la structure, la sémiologie naissante après le structuralisme proprement dit. Il s’agit aussi de l’ultime livraison de la revue Arguments ‒ du côté d’un marxisme hétérodoxe : l’imagination paradigmatique, associée à une posture quasi rentière, est distinguée de l’imagination syntagmatique-cybernétique, opératoire et productive, plus proche de l’ouvrier ou de l’artisan. Si Barthes se tourne résolument vers la linguistique, notamment celle du danois Hjelmslev, et se lance dans l’aventure de la revue Communications dès 1961 [26], il ne s’agit donc pas d’un reniement mais d’un remaniement : le syntagmatique englobe cybernétique et structuralisme qui continuent donc à être un avenir de Barthes sur un autre mode [27].
Wiener résumait ainsi la « thèse » de Cybernétique et société :
la société ne peut être comprise que par une étude des messages et des dispositifs de communication qu’elle contient ; […] dans le développement futur de ces messages et de ces dispositifs, les messages entre l’homme et les machines, entre les machines et l’homme, et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant [28].
Il se sentait requis par « une époque où l’énorme masse de communication par habitant rencontre un courant toujours plus mince de communication globale [29] ». La revue Communications, reliée au Centre d’Études des Communications de masse (VIe section de l’École Pratique des Hautes Études), ne pouvait pas ne pas faire signe au moins partiellement vers la cybernétique. Barthes la cofonde avec Georges Friedmann ‒ sociologue des rapports homme/ machine dans les sociétés industrielles de la première moitié du XXe siècle ‒, et Edgar Morin ‒ qui avait animé la défunte Arguments et qui intègre de plus en plus la cybernétique dans ses propres travaux [30].
« Le message photographique » (1961) est le premier texte que Barthes écrit pour la revue. Dans son article sur « La cybernétique “américaine” au sein du structuralisme “français” », Bernard Geoghegan conclut par cette ouverture : « Nous pourrions nous pencher sur les réflexions que Jacques Lacan (1978 [1954-1955]), Roland Barthes (1961) et Umberto Eco (1979 [1960]) ont menées sur et avec la cybernétique […] [31]… » Concernant Barthes, il ne signale en bibliographie que « Le message photographique ». À relire cet article, on ne distingue pas seulement une tresse entre sémiologie naissante et persistance marxiste. Dès les premières lignes, le vocabulaire est cybernétique : « La photographie de presse est un message. L’ensemble de ce message est constitué par une source émettrice, un canal de transmission et un milieu récepteur. » (OC I 1120) « Message », terme typiquement cybernéticien, se retrouvera dans plusieurs intitulés des contributeurs de la revue (« Le message photographique » et « Le message publicitaire » de Barthes, « Le message narratif » de Brémond, « Sémiologie des messages visuels » d’Eco…).
Dans Lettre à Roland Barthes (2015), Jean-Marie Schaeffer montre à propos de « L’activité structuraliste » (Lettres nouvelles, 1963) que la référence cybernéticienne est décisive, notamment dans ce passage où Barthes rappelle que « la forme, a-t-on dit, c’est ce qui permet à la contiguïté des unités de ne point apparaître comme un pur effet de hasard » (OC II 470). Schaeffer explicite ce « a-t-on dit » :
La notion de hasard renvoie à un autre champ qui a joué un rôle important dans la naissance du structuralisme : la cybernétique (qui intéressait notamment Jakobson et Lévi-Strauss). Cette présence, fût-elle discrète, de la cybernétique est importante : elle permet de comprendre que les règles combinatoires forment ou informent la substance (les sons, les tracés graphiques, etc.) de proche en proche par opérations locales et récursives et non pas sous la forme de structures abstraites préexistantes dont les énoncés ne seraient que des instanciations. Le structuralisme n’est pas un platonisme des formes : celles-ci sont des règles opératoires. C’est la raison pour laquelle, il me semble, vous tenez avec tant de force dans ce texte à le définir comme une activité mentale plutôt que comme une ontologie [32].
Les multiples allusions à la cybernétique tout au long du cheminement bigarré de Barthes ne se réduiraient donc pas à une couche superficielle de l’œuvre mais seraient la partie émergée d’une imprégnation véritable, au moins dans cet article programmatique et les réalisations qui en ont découlé ‒ ce qui n’est pas rien. Schaeffer rappelle les raisons pour lesquelles Lévi-Strauss a outrepassé les réticences de Wiener à introduire la modélisation dans les sciences sociales : aucun locuteur n’a conscience en parlant des règles grammaticales qui régissent ses énoncés, par conséquent l’observation n’influe pas davantage sur l’objet observé que dans le domaine des sciences naturelles ; de même, les séries de données linguistiques s’étendent sur plusieurs millénaires et peuvent donc être exploitées statistiquement tout en répondant aux critères scientifiques de stabilité et de prédictibilité. Schaeffer rapproche le structuralisme littéraire de cette visée lévi-straussienne : la profusion de données n’y est pas moindre et les travaux du cognitiviste Daniel Dennett ou le programme de « lecture à distance » de Franco Moretti semblent montrer l’existence de « niveaux des faits littéraires qui échappent à la planification consciente [33] ». Schaeffer, et d’autres chercheurs dont il se sent proche, considère donc « L’activité structuraliste » comme un article précurseur de ses propres travaux, toujours en cours, dans lesquels l’approche cybernétique est délibérément intégrée. Précisons que cette intégration n’est cependant pas univoque : les « humanités numériques » restent clivées entre une visée de compréhension et une visée de prédiction/ contrôle, une adaptation de l’outil informatique à des questionnements inédits et une application directe de calculs intensifs à de gigantesques bases de données culturelles, ce qui implique une divergence au niveau des financements, des compositions d’équipes et des dépendances institutionnelles [34]…
Conclusion
À propos de Système de la Mode, qu’il réhabilite également, Schaeffer s’étonne : « Même Éric Marty, qui pourtant ne vous veut que du bien, ne croit pouvoir le sauver qu’en y voyant une “étrange œuvre baroque” dans laquelle vous vous seriez perdu “dans une sorte de jouissance, d’autant plus autiste qu’elle est dissimulée par un jargon cybernétique” [35]. » Comme on a pu l’entrapercevoir, c’est l’ouvrage de Barthes qui concentre le plus de références explicites à la cybernétique [36]. Son titre conciliait d’emblée tendance hédoniste et tendance scientiste. Le livre engageait un geste qui a lui aussi persisté : tresser une pluralité de langages autour d’un objet fuyant ‒ en l’occurrence les fils cybernétique, linguistique, structuraliste, sémiologique mais aussi quelques filaments psychanalytique, sociologique, ethnologique, anthropologique et esthétique, autour du vêtement décrit dans deux magazines de mode de la fin des années 1950. Certains fils s’amenuisent, d’autres s’étoffent : le fil cybernétique, fût-il minoritaire, n’est jamais coupé. Il y a même quelque chose qui tiendrait du cordon ombilical si on s’intéressait à la place qu’occupe la combinatoire dans la génétique et l’archive barthésiennes.
La dépréciation de la cybernétique participe sans doute d’une mode antimoderne qui tend à se faire passer pour une nature : « le vrai Barthes est le dernier, etc. [37] » Mais comme Barthes l’a théorisé lui-même à propos du cycle mini-jupe/ jupe longue, il y a fort à parier que ses premiers livres soit remis au goût du jour dans quelques années et que Fragments d’un discours amoureux (1977), l’essai sur la photographie ou les cours au Collège de France soient relus autrement. La lettre de Schaeffer y contribue déjà ‒ à rebours d’un processus de classicisation : « Rien dans vos écrits tardifs ne témoigne, à mon sens, d’une rupture avec le moment “structural” qui n’aurait été en somme qu’un moment d’égarement [38]. »
[1] Il s’agit des conférences Macy (1942-1953).
[2] Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains [2e édition 1954], trad. de l’anglais par Pierre-Yves Mistoulon et revu par Ronan Le Roux, Seuil, coll. « Points Sciences », 2014, p. 47.
[3] Pour plus de précisions, voir Ronan Le Roux, « Présentation », dans Norbert Wiener, La Cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, trad. de l’anglais par Ronan Le Roux, Robert Vallée et Nicole Vallée-Lévi, Seuil, coll. « Sources du savoir », 2014, p. 11-53 ; « Cybernétique et société au XXIe siècle », dans Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, op. cit., p. 7-40.
[4] Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, op. cit., p. 64.
[5] Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles-lettres dans la pensée, Raisons d’agir, 1999, p. 36. Cet essai, qui s’appuie sur la philosophie de Wittgenstein, est publié dans les circonstances de l’affaire Sokal et vise essentiellement les applications aventureuses du théorème de Gödel que Régis Debray croyait pouvoir faire dans le champ socio-politique.
[6] Voir Claude Shannon & Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Chicago, 1963.
[7] Bernard Geoghegan, « La cybernétique “américaine” au sein du structuralisme “français”. Jakobson, Lévi-Strauss et la Fondation Rockefeller », Revue d’anthropologie des connaissances, 2012/3, Vol. 6, n° 3, p. 591.
[8] Ibid., p. 593.
[9] Ronan Le Roux, « Lévi-Strauss, une réception paradoxale de la cybernétique », L’Homme. Revue française d’anthropologie, 189|2009, p. 174.
[10] Mythologies, dans Roland Barthes, Œuvres complètes, t. I, nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Seuil, 2002, p. 742. Les références se feront désormais dans le corps du texte sous la forme OC suivie du numéro de tome et de page.
[11] Dans les années 2010, il y aurait une mythologie à écrire sur l’application de termes ou d’expressions relevant de l’informatique à nombre de discours politiques relayés par les médias. Certains « think tank dédiés à l’analyse des politiques publiques » et autres « laboratoires d’idées innovantes » ont ainsi pu diffuser l’idée que face à « la crise » il faudrait « changer de logiciel politique ».
[12] Italo Calvino, La Machine littérature. Essais, trad. de l’italien par Michel Orcel et François Wahl, Seuil, coll. « Pierres Vives », 1984, p. 21.
[13] Ibid., p. 20.
[14] Ou alors on considère rétrospectivement que Barthes était en avance sur son temps et qu’un théâtre cybernéticien est ce que tentent aujourd’hui Heiner Goebbels dans Stifters Dinge (Avignon, 2008) ‒ spectacle sans acteurs avec cinq pianos sans pianistes ‒, Romeo Castellucci dans sa version du Sacre du printemps de Stravinsky (Villette, 2014) ‒ quarante machines pilotées par ordinateur et qui projettent des cendres d’os ‒, ou Joris Mathieu dans Artefact (TNG, 2017) ‒ des robots qui racontent leur genèse via des textes de Beckett. Sur « le geste théâtral de Roland Barthes », voir l’essai de Christophe Bident publié chez Hermann en 2012.
[15] Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978), texte établi, annoté et présenté par Thomas Clerc, Seuil/ IMEC, coll. « Traces Écrites », Paris, 2002, p. 58.
[16] Marie-Jeanne Zenetti est arrivée à une conclusion analogue en suivant le chemin sinueux des métaphores optiques dans son article sur « Transparence, opacité, matité dans l’œuvre de Roland Barthes, du Degré zéro de l’écriture à L’Empire des signes », dans Appareil [En ligne], 7 | 2011, mis en ligne le 04 avril 2011.
[17] Voir Claude Reichler, La Diabolie. La séduction, la renardie, l’écriture, Minuit, coll. « Critique », 1979, p. 207-210.
[18] Roland Barthes, Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977), texte établi, annoté et présenté par Claude Coste, Seuil/ IMEC, coll. « Traces Écrites », 2002, p. 83-84.
[19] Précisons qu’il ne référence pas toutes les pages de ses carnets relatives à l’entrée « Briques » mais seulement les plus significatives. Pour être complet, il faudrait en ajouter une bonne dizaine, dont celle que je cite juste après.
[20] Roland Barthes, Carnets du voyage en Chine, édition établie, présentée et annotée par Anne Herschberg-Pierrot, Paris/ Caen, Christian Bourgois/ IMEC, 2009 p. 30. Les références se feront désormais dans le corps du texte sous la forme : C, suivi du numéro de la page.
[21] Il ne souhaite ni « parler de la Chine du point de vue de la Chine » ni « voir la Chine du point de vue de l’Occident » mais précise : « Le bon regard est un regard qui louche. » (C 196, il souligne)
[22] Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, op. cit., p. 53 (il souligne). À rapprocher de cette entrée du Roland Barthes par Roland Barthes (1975) : « Ennui des discours prévisibles. La prévisibilité est une catégorie structurale, car il est possible de donner les modes d’attente ou de rencontre (bref : de suspense) dont le langage est la scène (on l’a fait pour le récit) ; on pourrait donc fonder une typologie des discours sur leur degré de prévisibilité. » (OC IV 722-723, il souligne)
[23] « On ne saurait imaginer renversement plus complet du consensus épistémologique régnant alors et sans doute encore de nos jours : le structuralisme construit logiquement un segment du monde sensible ‒ plus particulièrement, la part phonique de la langue ‒ en posant qu’il n’est nul besoin pour cela d’une théorie de la ressemblance, mais seulement d’une théorie de la différence. » (Jean-Claude Milner, Le Périple structural. Figures et paradigme [2002], nouvelle édition revue et augmentée, Verdier, Lagrasse, 2008, p. 308)
[24] Sur cette « machine à traduire », voir Émile Delavenay, La Machine à traduire, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1959.
[25] Claude Coste, Bêtise de Barthes, Klincksieck, coll. « Hourvari », Paris, 2011, p. 209. Sur le voyage en Chine et la comparaison entre les carnets, l’article du Monde et le cours donné au retour, voir p. 207-221.
[26] Voir Fanny Lorent & Thomas Franck, « Le projet sémiologique de Barthes dans la revue Communications », Revue Roland Barthes, n° 3, « Barthes en revues (1942-1980) », mars 2017 [en ligne]. Les auteurs insistent surtout sur les rapports avec Adorno et sa critique de la culture de masse.
[27] Sur l’importance de « L’imagination du signe » dans la trajectoire de Barthes, voir Jean-Claude Milner, « Barthes II. Du signe aux signes », dans Le Périple structural. Figures et paradigme, op. cit., p. 167-179.
[28] Norbert Wiener, Cybernétique et société, op. cit., p. 48.
[29] Ibid., p. 159. Wiener est aux antipodes de prêcher la communication azimutée : « les gens qui ont choisi pour carrière la communication n’ont souvent plus rien à communiquer » (p. 162).
[30] Voir notamment Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe [1990], Seuil, coll. « Points Essais », 2005.
[31] Bernard Geoghegan, art. cit., p. 596.
[32] Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, Éditions Thierry Marchaisse, coll. « Lettres à… », Paris, 2015, p. 65.
[33] Ibid., p. 74.
[34] Voir Pierre Mounier, « Les humanités numériques, gadget ou progrès ? Enquête sur une guerre souterraine au sein de la recherche », La Revue du Crieur, n° 7, juin 2017, p. 144-159.
[35] Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, op. cit., p. 84.
[36] Voir notamment OC II 919 (bruit), 984 (brique), 1036 (programme), 1060 (mémoire)…
[37] Voir notamment Alain Finkielkraut, « “Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne” », dans Rue Descartes, « Roland Barthes après Roland Barthes », n° 34, 2001/4, p. 87-92 ou Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », Paris, 2005. Dans Les Écrivains face à la doxa ou Du génie hérétique de la littérature (José Corti, coll. « Les Essais », Paris, 2011), Jean-Pierre Martin en donne lui aussi un échantillon : « Mais ce qui nous éclaire peut-être une fois de plus, sur ce point [la morale politique] comme sur bien d’autres, c’est le dernier Barthes, en particulier sa réflexion sur l’individuation. » (p. 202)
[38] Jean-Marie Schaeffer, Lettre à Roland Barthes, op. cit., p. 22-23. Du côté de la cybernétique, un chercheur comme Ronan Le Roux défriche le terrain par ses travaux sur sa diffusion en France entre 1948 et 1975 ainsi que ses traductions récentes (!) des ouvrages fondateurs de Wiener.