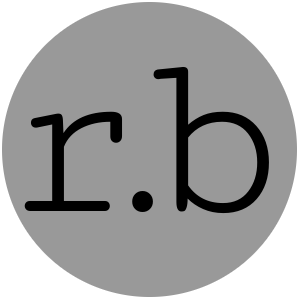Mon article a pour but de déterminer le statut du récit de conversion qui sous-tend, chez le tout dernier Barthes, l’imagination d’une Vita Nova – d’une Vie Nouvelle [1]. Si le choix fait par l’auteur de donner pour titre Vita Nova à son ultime projet d’écriture justifie à lui seul de se concentrer sur ce thème, la publication posthume des huit esquisses éponymes, comme celles de la conférence « “Longtemps je me suis couché de bonne heure…” », du cours La Préparation du Roman et des journaux intimes Soirées de Paris et Journal de Deuil, témoignent de ce qu’il existe à présent un corpus considérable d’écrits – sans compter « Délibération » et La Chambre claire publiés du vivant de Barthes – à travers lequel on peut explorer la manière dont Barthes exploita (ou avait l’intention d’exploiter) ce topos des plus littéraires. En effet, la richesse même de ce corpus semble avoir suscité un intérêt renouvelé pour le concept de Vita Nova lui-même, fait attesté, par exemple, par le titre et le contenu d’un colloque organisé en juin 2014 par Marie Gil et Frédéric Worms. Si les quatorze intervenants de Vita nova : La Vie comme écriture ont embrassé un éventail de textes allant de Dante jusqu’à Jacques Roubaud, l’ange tutélaire du colloque – et la référence incontournable des communications – était Barthes, « à qui », comme l’a bien dit Dominique Rabaté, « l’on doit la réinvention de la notion » [2]. Néanmoins, et malgré une fascination alimentée par la publication échelonnée d’inédits, nous sommes encore loin, à mon sens, de comprendre le projet de Barthes dans son ensemble [3]. Il est possible que le trésor caché de l’Archive (qui reste en grande partie un trésor défendu [4]) révèle un jour le sens subjectif de ce fantasme créateur si particulier. En attendant, j’aborde ici une question qui me semble fondamentale pour commencer à y voir clair : dans la Vita Nova de Barthes, quelle est la relation entre ce récit quasi-mythique, empreint d’intertextualité, et le deuil empirique – la mort de la mère de Barthes – sur lequel cette vie nouvelle est fondée ?
En janvier 1977, Barthes, qui avait passé la soixantaine, inaugura sa vie nouvelle au Collège de France par une référence affectueuse à la vita nuova relativement tardive de Michelet. Sa Leçon, surtout vers la fin du texte, est parsemée, d’allusions à son propre âge : « plus âgé que lui » (Michelet avait 51 ans au moment de se lancer dans sa vie nouvelle) ; « périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis » ; enfin, pour défendre le projet d’un « enseignement fantasmatique », Barthes continue dans le même esprit : « Il est un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; mais il en vient ensuite un autre où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas […]. Vient peut-être maintenant l’âge d’une autre expérience [5] ». Quelque cinq mois plus tard, au moment du colloque de Cerisy organisé autour de son travail, le besoin de plus en plus prononcé chez Barthes d’une mutation personnelle et intellectuelle se manifeste par le fantasme d’écrire un roman – roman inspiré par Guerre et Paix, qu’il dit lire le soir à Cerisy avant de s’endormir, et dont la mission serait de « peindre ceux que j’aime ». Le petit récit de Barthes concernant son illumination soudaine à Cerisy s’insère de façon désinvolte pendant la discussion d’une communication de Frédéric Berthet, « Idées sur le roman » :
l’autre soir, je ne sais plus quel soir, j’étais je l’avoue franchement dans un grand état de fatigue et même je dirais de désarroi, pour bien des raisons, et dans cet état, c’était le soir, tout d’un coup j’ai été soutenu d’une façon en quelque sorte miraculeuse, euphorique, par l’idée que j’allais enfin écrire un roman, que j’allais enfin, toutes affaires cessantes, déblayant tout le reste, entrer dans une sorte de grande ascèse comme a pu le faire Proust […], j’allais moi aussi entrer en roman, comme on entre en religion, et c’est pour cela que l’autre jour j’ai employé l’expression « sauter le pas » [6].
Voici donc une deuxième annonce (publique elle aussi) d’un joyeux renouveau de vie. Or, celui-ci est conçu par Barthes comme une rupture plus radicale avec sa vie actuelle, car il s’agit d’une immersion totale dans une existence austère qui serait placée au service du Roman. En effet, « entrer en roman » prend le caractère d’une conversion religieuse, même si Barthes dégrade sa comparaison en assimilant l’effet vivifiant de cette épiphanie à celui d’un libertin sadien qui, exténué par la débauche, est miraculeusement restauré par « certaines substances [7] ». De même, quand il rappelle avoir employé l’expression « sauter le pas » – c’était en s’entretenant avec Robbe-Grillet quelques jours plus tôt : « Quand allez-vous sauter le pas ? Quand allez-vous faire du roman ? » – ses auditeurs n’auraient pas oublié, j’imagine, la référence gidienne qui l’avait accompagnée : « Allez-y, sautez le pas, expression dont Gide rappelait qu’elle s’appliquait également à “aller pour la première fois au bordel” et “faire sa première communion” [8] ».
Si ces allusions amusantes invitent à la prudence quant au statut de la conversion – même « peindre ceux que j’aime » est une citation approximative de Sade [9] – un épisode de Guerre et Paix deviendra une référence obsédante chez Barthes, mobilisée dans toutes les versions ultérieures de son récit de Vita Nova. Or, c’est une référence inattaquable par l’ironie à cause du rapprochement fait par Barthes avec la mort de sa mère. Quelque cinq semaines après avoir raconté ce qu’il lisait avant de s’endormir à Cerisy, Barthes, qui séjourne à Urt auprès de sa mère malade – elle décline physiquement et mourra moins de trois mois plus tard – poursuit sa lecture du roman de Tolstoï. Son journal intime du 5 août 1977 décrit la violence de l’émotion suscitée en lui par la mort du prince Bolkonski, et surtout par la tendresse déchirante des derniers mots (« “Ma chère, mon amie” ») qu’il adresse à sa fille Marie. Pour Barthes, c’est une expérience de lecture qui catalyse sa conversion à la vérité de la littérature, vérité qui s’apparente à une vérité religieuse : « La littérature a sur moi un effet de vérité autrement plus violent que la religion. Je veux dire par là, simplement, qu’elle est comme la religion. [10] » En 1979, Barthes inclut ce passage dans les extraits du Journal d’Urt qu’il publiera dans « Délibération » (essai sur la question : « dois-je tenir un journal en vue de le publier ? [11] »). Pour autant, il n’y avait pas véritablement de divulgation personnelle dans cette délibération, car l’expérience conversionnelle décrite dans son journal était déjà évoquée dans sa célèbre conférence, « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” », prononcée en octobre 1978, un an après la mort de sa mère – on imagine que Barthes avait voulu marquer ainsi cet anniversaire de sa disparition – et cela dans le cadre très public du Collège de France : « Je ne parle pas ici d’une œuvre, mais d’un bouleversement ; ce bouleversement a pour moi son sommet à la mort du vieux prince Bolkonski, aux derniers mots qu’il adresse à sa fille Marie, à l’explosion de tendresse qui, sous l’instance de la mort, déchire ces deux êtres qui s’aimaient sans jamais tenir le discours (le verbiage) de l’amour. [12] »
Cet épisode est désormais conjoint – dans La Préparation du Roman il le sera de façon encore plus déchirante – à celui de la mort de la grand-mère dans À la recherche du temps perdu : « la douleur y est pure, dans la mesure où elle n’est pas commentée […] et où l’atroce de la mort qui vient, qui va séparer à jamais, n’est dit qu’à travers des objets et des incidents indirects » [13]. Et si Barthes dit avoir lu ces deux scènes de mort beaucoup de fois – « deux lectures ([…] faites si souvent que je ne puis les dater) [14] » – et si leur effet sur lui a toujours été le même (« l’émotion qu’elles ravivent toujours en moi [15] »), il prétend désormais avoir compris que – chaque fois, tout d’un coup, et comme à l’improviste – elles suscitent en lui des « moments de vérité ». Ce sont ces moments de vérité qui, par leur manière de véhiculer une transcendance, inculquent une nouvelle forme de savoir :
Je constatai d’abord que ces episodes, je les recevais […] comme des « moments de vérité » : tout d’un coup la littérature (car c’est d’elle qu’il s’agit) coïncide absolument avec un arrachement émotif, un « cri » ; à même le corps du lecteur qui vit, par souvenir ou prévision, la séparation loin de l’être aimé, une transcendance est posée : quel Lucifer a créé en même temps l’amour et la mort ? [16]
Et c’est certainement la toute-puissance de ces épisodes qui mène Barthes à déclarer, dans un ajout oral au texte écrit de La Préparation du Roman(10 mars 1979) : « peu m’importe que le roman soit en crise historique, du moment que la lecture me donne ces moments de vérité, et tant que ces moments me seront donnés dans – quelquefois – ce que je lis, eh bien je croirai toujours au roman [17] ».
Si la conversion de Barthes au roman par la lecture de deux scènes de mort littéraires a tant d’importance, c’est en partie parce qu’elles incarnent l’affect qu’il exige du roman (« son instance est la vérité des affects, non celle des idées [18] »). Mais c’est leur position dans la structure très concertée de la conférence de Barthes qui leur confère ce rôle suprême de convertisseur. Barthes réduit une expérience de lecture réitérée à un événement présenté comme unique ; par ailleurs, il fait coïncider cette lecture pseudo-singulière avec ce qu’il a déjà établi comme le milieu symbolique de sa vie. En fait, cette idée du milieu de la vie est développée, dès le début de la seconde partie de la conférence, à partir de l’illustre incipit de la Divine Comédie de Dante : « Nel mezzo del camin di nostra vita ». Pour Barthes, « le milieu du chemin de notre vie » n’est pas un calcul arithmétique – comment pourrait-il l’être, puisque Barthes a déjà atteint l’âge de 62 ans ? – mais« un point sémantique, l’instant, peut-être tardif, où survient dans ma vie l’appel d’un nouveau sens, le désir d’une mutation : changer la vie, rompre et inaugurer [19] ». L’âge, selon cette manière de voir les choses, ne s’accumule pas selon un rythme chronologique et régulier ; il est vécu comme le passage à travers une série de cases, ou, suivant une autre métaphore, une série d’écluses : « à certains points du parcours, il y a des seuils, des dénivellations, des secousses ; l’âge n’est pas progressif, il est mutatif [20] ». Réservant durant quelques paragraphes la raison anecdotique de l’intérêt qu’il ne cesse de manifester pour l’âge, Barthes avoue que c’est sa manière d’envisager la mort qui a changé : « On se savait mortel […] ; tout d’un coup on se sent mortel. » C’est ce qui explique sa certitude de s’engager dans le dernier tronçon du chemin de sa vie : « Cette évidence, dès lors qu’elle est vécue, amène un bouleversement du paysage : il me faut, impérieusement, loger mon travail dans une case aux contours incertains, mais dont je sais (conscience nouvelle) qu’ils sont finis : la dernière case [21] ».
C’est seulement à ce moment de la conférence que Barthes explique ce qui lie le milieu symbolique de sa vie – la perception solennelle que l’œuvre à écrire, dans un paysage changé, sera sa dernière œuvre, le besoin de renverser des habitudes de travail dont il commence à avoir assez –, et son propre deuil : « Enfin un événement (et non plus seulement une conscience) peut survenir, qui va marquer, inciser, articuler cet ensablement progressif du travail, et déterminer cette mutation, ce renversement de paysage, que j’ai appelé le “milieu de ma vie” [22] ». Néanmoins, l’annonce du deuil personnel se fait encore attendre, car Barthes commence par invoquer deux deuils mythiques. Le premier est celui de l’abbé de Rancé, dandy mondain du dix-septième siècle qui, rentrant de voyage, découvre le corps décapité de sa maîtresse, tuée dans un accident : « il se retire et fonde la Trappe [23] ». L’autre est celui de Proust, initiateur avoué de Barthes (« du moins, le temps de cette conférence »), dont le « “milieu du chemin de la vie” fut certainement la mort de sa mère », même si « la mutation d’existence, l’inauguration de l’œuvre nouvelle » (À la recherche) n’a pas été immédiate [24]. Enfin, le fait empirique de la mort de la mère de Barthes est articulé de façon oblique – « Un deuil cruel, un deuil unique et comme irréductible » – et ce deuil est établi, sans équivoque, comme le tournant de sa vie : « quoique tardif, ce deuil sera pour moi le milieu de ma vie ; car le “milieu de la vie” n’est peut-être jamais rien d’autre que ce moment où l’on découvre que la mort est réelle, et non plus seulement redoutable [25] ». Dans une illumination qui est présentée encore une fois comme soudaine (« il se produit tout d’un coup cette évidence »), le moment de faire le saut est arrivé. Comme Barthes ne dispose plus d’assez de temps pour essayer plusieurs manières de vivre, « il faut que je choisisse ma dernière vie, ma vie nouvelle » ; en plus, il faut qu’il choisisse une vie qui le délivre de son « acédie », « cet état ténébreux […] où me conduisent l’usure des travaux répétés et le deuil ». Enfin, et pour la première fois dans cette conférence, Barthes se sert de la formule « cette Vita Nova » pour décrire sa conversion à une nouvelle vie [26]. Évidemment, c’est une Vita Nova qu’il situe dans l’espace séparant la mort de sa mère de la sienne. Et c’est cette dernière mort (celle de Barthes lui-même) qui est anticipée à maintes reprises par le leitmotiv de son âge.
La brièveté littérale du dernier tronçon du « chemin de vie » de Barthes (il vivra moins de dix-huit mois après avoir dessiné « la dernière case »), en combinaison avec le contexte imprévisible de la publication de La Chambre claire (ce livre sur la relation entre la photographie et la mort, surtout celle de la mère de Barthes, sortant plus ou moins au moment de sa propre mort) nous laisse dans l’impossibilité de ne pas prendre la conférence « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” » au pied de la lettre : c’est bien un récit de conversion « au premier degré » – récit d’un deuil véritable qui suscite le désir d’une nouvelle vie qui se manifesterait, dans le temps restant à Barthes, comme une nouvelle pratique de l’écriture. La publication en 2009 de Journal de Deuil, qui révèle la grande douleur de Barthes pendant les deux ans qui ont suivi la mort de sa mère, a certainement augmenté l’enjeu – il est d’autant plus difficile, depuis lors, de sortir du cadre de l’expérience biographique du deuil de Barthes pour trouver d’autres moyens d’approche de la vita nova barthésienne, et du fantasme de conversion qui la structure.
« Conférence publique » du Collège de France, publiée deux ans après la mort de Barthes, « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” » a posé les fondements du cours La Préparation du Romanqui allait la suivre de très près. Le contenu de la conférence, y compris sa part intime, est repris dans le cours, et Barthes se relance dans le récit de sa vita nova dans les toutes premières séances du 2 et du 9 décembre 1978. Les sous-titres que l’on peut lire dans son texte écrit jalonnent la structure formelle de la conversion qui sous-tend « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” » : « Le “Milieu” de la vie », « Changer ». « Fantasme d’écriture », « Le Roman », etc. [27] Cette fois, pourtant, la section « Changer » (pivot évident de la mutation) est affublée d’un nouveau récit d’illumination qui se présente, encore une fois, comme une expérience inédite.
À la différence de l’illumination de Cerisy que Barthes avait introduite par une référence temporelle très vague (« l’autre soir, je ne sais plus quel soir »), cet épisode est daté de manière très précise : « Et maintenant, un bref instant, un peu d’anecdote personnelle : quand la décision de ce “changement” a-t-elle été prise ? – le 15 avril 1978. [28] » Le cadre, lui aussi, a changé : Cerisy est remplacé par Casablanca, où Barthes, par un après-midi gris et un peu frais, prend avec des amis la route de Rabat pour aller visiter un « joli vallon ». Mais ce ne sera pas (ou ne sera pas encore) une conversion à la manière de la Route de Damas, car Barthes n’arrive pas à se défaire de l’état d’acédie qu’il avait décrit dans « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” » : « Tristesse, un certain ennui, le même, ininterrompu (depuis un deuil récent) et qui se reporte sur tout ce que je fais, je pense (manque d’investissement) [29] ». Il rentre à Casablanca où il s’installe sans la solitude de son appartement et se livre à une « marinade » flaubertienne (la marinade renvoyant chez l’auteur à la méditation pratiquée par Flaubert, sur son divan, lorsqu’il était en proie à la « panne » d’écriture) ; c’est dans ce cadre et à ce moment précis que quelque chose commence à changer : « Éclosion d’une idée : quelque chose comme la conversion “littéraire” – c’est ces deux mots très vieux qui me viennent à l’esprit : entrer en littérature, en écriture ; écrire, comme si je ne l’avais jamais fait : ne plus faire que cela [30] ».
Or, à tomber sur cette anecdote, on ne penserait pas que Barthes, l’été précédent, avait raconté une transformation intérieure qui comportait les mêmes éléments : le passage d’un état de grande fatigue et de désarroi à la certitude euphorique d’entrer enfin « en roman », tout comme on entre « en religion ». D’ailleurs, un composant essentiel de cette conversion-là était l’imagination d’une entrée dans « une sorte de grande ascèse » à la Proust. Le Barthes d’un après-midi d’avril à Casablanca est converti de façon franchement décevante – même si appropriée au contexte de son cours – à l’idée d’unifier écriture et enseignement en un seul et même projet littéraire : « image de joie, si je me donnais une tâche unique, telle que je n’aie plus à m’essouffler après le travail à faire (cours, demandes, commandes, contraintes), mais que tout instant de la vie fût désormais travail intégré au Grand Projet [31] ». Si je qualifie cette conversion de décevante – aucune transcendance, cette fois ! – l’expérience de Barthes, prise dans son ensemble et toujours ancrée à sa date, est néanmoins comparée à un Satori. Et c’est cette comparaison qui justifie l’allusion à Proust (allusion de rigueur) qui va clore ce petit récit biographique : « Ce 15 avril : en somme sorte de Satori, d’éblouissement, analogue (peu importe si l’analogie est naïve) à l’illumination que le Narrateur proustien éprouve à la fin du Temps retrouvé [32] ».
Quelle que soit la réalité empirique de cette anecdote, sa théâtralité est dégonflée par l’engagement pédagogique qui la suit : « On va tout de même dédramatiser ce 15 avril ! – et pour cela, reprendre certains éléments de cette “décision”, d’une façon plus détachée, plus théorique, plus critique [33] ». Pourtant, des huit esquisses du projet Vita Nova, ébauchées en août-septembre 1979 à la charnière des deux parties de La Préparation du Roman, cinq mentionneront cette date précise (jour, mois, année) pour en faire un point de pivot, comptant parmi les éléments clés d’une conversion mythique. Comme dans le cours, la date récurrente est liée à une prise de décision : « Décision du 15 avril 78 » ; « La décision du 15 Avril 1978 », et ainsi de suite [34]. D’esquisse en esquisse, Barthes hésite quant à la manière précise d’écrire cette date – « a » majuscule ou minuscule pour « avril » ? « 78 » ou « 1978 » ? « Décision » ou « La Décision » ? – mais il n’y a aucune hésitation quant au jour en question. Surtout, Barthes ne fait pas mention du cours du Collège de France dans Vita Nova, la « décision » étant repassée, dans chacune des cinq esquisses où elle joue un rôle structural, d’un regroupement joyeux de l’Enseignement et de l’Écriture à une convergence plus solennelle – à la Tolstoï et Proust – de la Littérature et de l’Amour : « La littérature comme substitut d’amour », « “Je me retire pour entreprendre une grande œuvre où serait dit…. l’Amour” », etc. [35]
En 2002, Jonathan Culler, qui examine les esquisses de Vita Nova sans connaître l’existence de l’anecdote marocaine – à l’époque, elle n’avait pas encore été révélée par la publication de La Préparation du Roman – écrit au sujet du 15 avril 1978 : « On n’est pas certain qu’une telle décision a eu lieu (la réduction à un seul jour nous permet de soupçonner un dispositif narratif en vue d’un récit), mais l’essai sur Proust rend l’idée d’une conversion plausible. [36] » Plus tard, en 2008, déçu de l’immersion tardive de Barthes dans le mythe de l’écrivain qu’il avait démystifié lui-même – en un mot, « le fétichisme des auteurs comme des génies qui produisent des œuvres » – Culler s’arrête de façon utile sur la section de La Préparation du romanqui porte comme titre « Crises ». Ces « crises » font partie intégrante des « démarrages » qui, comme le dit Barthes (cité par Culler), ont souvent retenu l’intérêt des historiens de la littérature : « “comment naît”, “comment part une œuvre” → Donc, par là même, moment mythique (même si, pour celui qui écrit, il est très réel et douloureusement réel ; car œuvre = chose difficile à commencer, à inaugurer [37] ». En premier lieu, selon Culler, Barthes « montre effectivement des indices d’une attitude toujours critique envers le mythe de l’écrivain [38] » ; par exemple, Barthes expose avec ironie la manière dont ce mythe est inscrit dans le Castex et Surer, manuel littéraire autrefois en usage dans les classes secondaires : « une chose surprenante et amusante par sa régularité, vrai tic : la vie de presque tous les écrivains est articulée par une crisecentrale, […] crise d’où découle un renouveau des œuvres, c’est-à-dire d’où l’Œuvre triomphante part, régénérée [39] ». Jusqu’ici tout va bien, mais Culler désapprouve la suite de l’analyse de Barthes : « Tout en notant que l’idée de crise est spécieuse et qu’elle s’adapte aux besoins du mythe de la crise féconde, il se sert néanmoins du manuel de Castex et Surer, qui est “à la fois parfaitement mythologique et bien fait”, pour produire une typologie de crises (anecdotiques, amoureuses, politiques, spirituelles) qui se distingue difficilement des autres typologies de Barthes [40] ».
Culler se réfère ici à la stratégie rhétorique qu’il avait déjà identifiée (et critiquée [41]) chez Barthes, c’est-à-dire sa manie de produire ce que Culler appelle « des typologies jetables » [« disposable typologies »] – « des listes de types de x, qui peuvent être perspicaces mais qui sont trop particulières ou trop ludiques pour qu’on les conserve comme le canevas d’une analyse future, comme apport au métalangage de la fiction, ou quoi que ce soit [42] » – et il poursuit en notant la relation entre la typologie des crises de l’écrivain, qui est ironisée par Barthes, et l’un des fils conducteurs de son cours : « “Dans le fil de mon récit (histoire de l’homme qui veut écrire, entreprendre une Œuvre), l’idée d’Œuvre (de cette Œuvre-là, solennisée) est liée à l’idée d’une Rupture de Vie, d’une Novation du Genre de Vie, de l’Organisation d’une Nouvelle Vie : Vita Nova” ». Et après avoir attiré l’attention sur « les majuscules qui servent à mythifier tous ces noms », Culler de conclure : « Il est difficile de distinguer ici le mythe de Castex et Surer de l’imaginaire qui est propre à Barthes [43] ».
Vu que La Préparation du Roman est consacrée à une exploration des habitudes et des difficultés mythiques du Grand Écrivain – espèce de composé formé de morceaux de Rousseau, Chateaubriand, Flaubert, Mallarmé, Tolstoy, Proust, Gide, Kafka, et parfois de Barthes lui-même – la description de la crise féconde comme pivot du mythe de l’écrivain peut sembler logique. Pourtant, le fil subjectif du récit de Barthes (la façon de faire de son deuil un avatar de cette crise mythique, et le fait que la mort de sa mère brise ce que, dans d’autres contextes, il serait heureux de décrire comme son « imaginaire ») est, à mon sens, moins facile à appréhender. Or, quand Culler cite Barthes sur la fécondité de la crise « centrale », il omet la précision que Barthes avait ajoutée entre parenthèses — « même si elle ne se situe pas au milieu de la vie » – association directe, s’il en fut, au « Nel mezzo del camin di nostra vita » qui avait joué un rôle si solennel dans la conférence « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure” ». Mais il y a pire, car Barthes introduit dans son analyse enjouée des crises d’écrivains un schéma très rudimentaire pour illustrer le procédé qu’il est en train de décrire : une longue flèche avec le mot « Naissance » à une extrémité, une croix représentant la Mort à l’autre, et un rond hachuré presque à mi-distance de la tige [44].
Bien sûr, le dessin de Barthes est une parodie des schémas chronologiques qui truffent les éditions successives de Castex et Surer [45]. Mais on pourrait le prendre aussi pour une caricature réussie de sa version personnelle du « milieu du chemin de notre vie » – caricature que les détracteurs les plus cruels de Barthes auraient bien pu imaginer pour le remettre à sa place [46]. Du cercle rudimentaire qui représente dans son dessin la crise qui change la vie, Barthes déclare : « Rond fatidique ! et promotionnel, car les rares biographies où il n’existe pas ont l’air tout à fait minables : auteurs déshérités ou paumés, qui n’ont même pas su mettre dans leur vie une crise créatrice [47] ». Et il insiste sur ce point essentiel dans un ajout oral à ses notes : « rond promotionnel […] qui fait de l’écrivain un grand écrivain [48] ». D’ailleurs, la typologie amusante de crises que Barthes construit en suivant de très près le Castex et Surer sape, d’une manière qui peut surprendre, deux illustres deuils créateurs. Le premier, classé par Barthes dans les « Crises anecdotiques(accidents de la biographie) » est la mort de la fille de Victor Hugo : « Hugo, 1843 : mort de Léopoldine (Hugo = riche : il aura deux crises). » Le deuxième, plus frappant encore, concerne la mort de la mère de Chateaubriand en 1798 ; ce deuil est placé, toujours de façon ironique, en tête d’une liste de crises spirituelles :« Crises spirituelles (ce sont les meilleures) : Chateaubriand (retour à la foi à la mort de sa mère, 1798–1800). [49] » C’est un deuil qui, selon Chateaubriand, motive sa fameuse déclaration : « J’ai pleuré et j’ai cru. » Ces mots, tirés de la préface à la première édition de son apologétique, Génie du christianisme [50], pourrait servir, si seulement Barthes n’avait pas l’air de s’en moquer, de bel exergue à Vita Nova, son propre fantasme de conversion, après la mort de sa mère, à une Nouvelle Vie mise au service de la Littérature.
Quand Barthes, dans un entretien publié dans Playboy le mois même de sa mort, compare la décision d’entreprendre un régime alimentaire à une conversion religieuse, il est, évidemment, sur son ancien terrain mythologique : « Il y aurait un livre à faire sur tous ces problèmes de l’amaigrissement […], sur le phénomène et sa mythologie. […] Vous comprenez, c’est un phénomène religieux, c’est une “névrose religieuse”. Se mettre à faire un régime a tous les caractères d’une conversion [51] ». L’on peut penser que cet exemple tardif de la conversion religieuse comme métaphore, tout ironique qu’il soit, prend sa source dans sa préoccupation simultanée d’une Vita Nova. Pourtant, une des Mythologies des années cinquante représente un exemple très précoce de l’intérêt de cette métaphore pour Barthes. Dans « Conjugales », publié en 1954, Barthes commente le cas de Sylviane Carpentier, qui avait été couronnée Miss Europe 1953 et qui, selon Paris-Match, avait renoncé à la gloire et la fortune en épousant un électricien de Palaiseau. C’est l’accent mis dans Paris-Match sur le choix supposé d’une modeste vie petite-bourgeoise, quand quelque chose de splendide se profilait à l’horizon, qui permet à Barthes de développer son analyse par analogie avec une conversion :
La petite-bourgeoisie peut être fière du ralliement de Sylviane Carpentier, tout comme autrefois l’Église tirait force et prestige de quelque prise de voile aristocratique : le mariage modeste de Miss Europe, son entrée touchante, après tant de gloire, dans le deux-pièces-cuisine de Palaiseau, c’est M. de Rancé choissisant la Trappe, ou Louise de La Vallière le Carmel : grande gloire pour la Trappe, le Carmel et Palaiseau. [52]
Ce n’est pas seulement la métaphore religieuse qui m’intéresse ici, mais cette apparition précoce de l’abbé de Rancé, précurseur tragique (dans « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” » et La Préparation du roman) d’un Barthes converti à une Vita Nova à cause d’un deuil cruel. Ce qui, dans la mythologie de 1954, était un trait d’esprit associant métaphoriquement une reine de beauté des années cinquante avec un abbé trappiste du dix-septième siècle, se transforme en 1978 en un parallèle grave et dépourvu d’humour. La métamorphose spirituelle de Rancé, relayée par Proust, renforce maintenant la solennité d’une conversion qui peut être séculaire, mais qui est bien une conversion provoquée par « la séparation loin de l’être aimé [53] ».
Dans les références à Rancé qui feront partie intégrante de son propre récit Vita Nova, Barthes réduit les faits contingents de la conversion de l’abbé au moment saisissant où il découvre la tête coupée de Mme de Montbazon : « Rancé, cavalier frondeur, dandy mondain, revient de voyage et découvre le corps de sa maîtresse, décapitée par un accident : il se retire et fonde la Trappe [54] ». Il est possible que les détails mélodramatiques – mise en scène de la tête placée à côté du cercueil, et même l’épisode dans son ensemble – soient apocryphes, et Barthes le savait certainement au moment de publier, en 1965, une préface a la Vie de Rancé de Chateaubriand [55]. Ce dont on peut être sûr, c’est que sa lecture attentive du texte de Chateaubriand a dû le familiariser avec les détails du processus interminable par lequel Rancé se retira du monde, car ce n’est que plusieurs années après la mort de sa maîtresse que cette retraite fut consommée pour de bon. Mais pour jouer son rôle dans la Vita Nova barthésienne, la conversion de Rancé se réduit à l’essentiel : Barthes parle à tort d’un Rancé qui aurait « fondé » la Trappe plutôt que de restaurer et réformer un bénéfice dont il avait hérité, et il répète l’anecdote de la tête coupée sans se référer à la discussion assez détaillée de Chateaubriand (débat qu’il connaissait bien en 1965) sur sa réalité historique controversée. En fait, le Rancé de Barthes rejoint très précisément la figure mythique résumée en une phrase dans mon édition Garnier-Flammarion du texte :« ce personnage mi-réel mi-fabuleux, ce viveur converti parce qu’il a vu le cadavre décapité de sa maîtresse [56] ».
Afin de comprendre pourquoi le dernier Barthes choisit de réduire la vie de Rancé à ce moment mythique, je vais examiner de près, dans la dernière partie de cet article, la préface de 1965 qu’il a donnée au texte de Chateaubriand. Si Barthes a donné à la partie centrale du texte le sous-titre prometteur « La tête coupée », il faut situer son propre geste de troncation dans le contexte de la préface dans son ensemble. Mais il faut souligner en même temps un intérêt renouvelé pour Chateaubriand de la part de Barthes pendant la dernière année de sa vie. Comme nous le savons par la mise en scène des lectures faites avant de s’endormir dans Soirées de Paris, les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand – « le vrai livre [57] » – sont lues avec enthousiasme pendant quatre soirées consécutives du mois d’août 1979. Tout en partageant cet « éblouissement » dans un entretien sur Chateaubriand publié en décembre 1979 – « Ces Mémoires sont devenus mon livre de chevet pendant plusieurs semaines ; je m’y précipitais, chaque soir » – Barthes souligne que c’est le Chateaubriand de la vieillesse qui le séduit, « un homme profond, grave, puissant » qu’il avait découvert dans la Vie de Rancé [58].
En effet, la Vie de Rancé, écrit par un Chateaubriand vieillissant sur l’ordre de son confesseur (encore plus âgé que lui), a été publiée en 1844 quand son auteur avait 76 ans ; Chateaubriand mourra quatre ans plus tard. Puisque Chateaubriand ne cesse d’entremêler ses propres souvenirs aux épisodes de la vie de Rancé, le texte est interprété, d’un commun accord critique, comme une sorte de post-scriptum aux Mémoires d’outre-tombe qui avaient été composés pendant une trentaine d’années (à partir de 1811 jusqu’en 1841), et qui étaient voués dès le début, comme le précise leur titre, à une publication posthume. Mais ayant terminé ses Mémoirespour faire passer sa vieillesse – ce que Chateaubriand décrit comme « l’ennui de ces heures dernières et délaissées, que personne ne veut et dont on ne sait que faire » – et, à la dernière ligne du texte,s’étant assis au bord de son tombeau pour descendre dans l’éternité [59], le septuagénaire doit accepter qu’il est toujours vivant et qu’il devra s’ennuyer encore. Comme Barthes le démontre avec beaucoup de perspicacité, la Vie de Rancé est conçue par Chateaubriand, et cela de façon très consciente, comme son œuvre finale ; c’est par ailleurs un dernier livre écrit pour remplir l’espace qui sépare l’achèvement des Mémoires d’outre-tombede sa mort.
Tout d’abord, Barthes constate que le sujet de la Vie de Rancé est la vieillesse :« une passion malheureuse, celle, non point de vieillir, mais d’être vieux [60] ». Quoique Chateaubriand soit bien placé pour élaborer le toposde la vanité du monde, ce n’est pas ce qui intéresse Barthes. Notant la disparition effective de la catégorie de la vieillesse dans les œuvres modernes – « il n’y a plus d’image du vieillard, il n’y a plus de philosophie de la vieillesse, peut-être parce que le vieillard est in-désirable [61] » – Barthes glose l’expérience existentielle d’être vieux que Chateaubriand, qui vit sa vieillesse comme une maladie, semble assimiler au sentiment d’être abandonné par le monde : « C’est cette langueur d’être vieux, étendue tout au long des Mémoires, qui est ici condensée sous la figure d’un solitaire, Rancé ; car celui qui abandonne volontairement le monde peut se confondre sans peine avec celui que le monde abandonne [62] ». Relevant, aux yeux de Barthes commentant Chateaubriand, d’« un temps où l’on meurt à moitié », assimilée à « la mort sans le néant », la vieillesse se fait le siège de « l’Ennui [63] ».
Or, en 1965, Barthes ne met pas cet état contingent (« l’ennui est l’expression d’un temps en trop, d’une vie en trop ») en rapport avec le concept d’acédie dont il parle si souvent dans ses derniers écrits. En fait, il préfère parler un langage sartrien : « Que fais-je dans le monde ? ; par ce sentiment profondément existentiel (et même existentialiste), la Vie de Rancé, sous l’appareil chrétien, fait penser à La Nausée ; les deux expériences ont d’ailleurs la même issue : écrire : seule l’écriture peut donner du sens à l’insignifiant [64] ». Mais « la déréliction existentielle est infligée à l’homme d’une façon métaphysique, par-delà les âges », tandis que Chateaubriand, pour sa part, « est de trop par rapport à un temps antérieur, à un être de ses souvenirs ». Et c’est lorsque « le souvenir apparaît comme un système complet de représentations » (comme c’est le cas des Mémoires d’outre-tombe), que la vie est perçue comme terminée et que la vieillesse commence [65]. Comme le dit Chateaubriand dans la Vie de Rancé, « je ne suis plus que le temps ». Barthes, qui se sert de ces mots comme exergue à sa préface [66], suggère qu’une vie réglée par la mémoire – par la non-vie de la vieillesse – devient une essence : « Étant le regard qui transforme la vie en destin, la vieillesse fait de la vie une essence mais elle n’est plus la vie […] : c’est la dernière impasse de la vieillesse : les choses ne sont que lorsqu’elles ne sont plus [67] ». C’est ainsi que la vieillesse et l’écriture se confondent dans ce que Barthes semble concevoir comme le fondement d’une perspective posthume : « le souvenir est le début de l’écriture et l’écriture est à son tour le commencement de la mort (si jeune qu’on l’entreprenne) [68] ». Pour Chateaubriand, « la vieillesse est […] étroitement liée à l’idée d’œuvre [69] » et sa Vie de Rancé est perçue, de façon prophétique, comme sa dernière œuvre. De même, l’ensemble de ce projet ébauché par Barthes sous le nom de la Vita Novasera vécu très consciemment comme sa dernière œuvre.
C’est dans la partie centrale de sa préface – « La tête coupée » – que Barthes aborde la soudaineté de la conversion de Rancé selon Chateaubriand (la cassure nette de sa vie mondaine). Pour préparer le terrain, Barthes propose une analyse inspirée des figures rhétoriques au moyen desquelles Chateaubriand crée la qualité de disjonction qui caractérise son texte. Selon Barthes, Chateaubriand a recours à la métaphore non pas pour rapprocher les choses en les comparant, mais pour interrompre le sens et le faire partir vers « “autre chose” [70] » ; en effet, la figure clé de cette « parataxe éperdue [71] » (l’agencement de phrases sans subordination grammaticale, le manque de liens logiques entre les cadres géographiques et les personnages historiques évoqués de façon si digressive) est l’anacoluthe. Décrite par Barthes comme « à la fois brisure de la construction et envol d’un sens nouveau [72] », son but ultime est de « faire entendre, en même temps, autre chose. Que la Vie de Rancé soit une œuvre littéraire (et non, ou non pas seulement, apolégétique), cela nous entraîne très loin de la religion, et ici le détour est encore une fois assumé par une figure : l’antithèse [73] ». Dans la lecture brillante de Barthes, l’antithèse est la figure rhétorique qui « structure entièrement » le texte de la Vie de Rancé :
Vivant sa propre vieillesse comme une forme, Chateaubriand ne pouvait se contenter de la conversion “objective” de Rancé ; il était nécessaire qu’en donnant à cette vie la forme d’une parole réglée (celle de la littérature), le biographe le divisât en un avant (mondain) et un après (solitaire), propres à une série infinie d’oppositions, et pour que les oppositions fussent rigoureuses, il fallait les séparer par un événement ponctuel, mince, aigu et décisif comme l’arête d’un sommet d’où dévalent deux pays différents ; cet événement, Chateaubriand l’a trouvé dans la décollation de la maîtresse de Rancé [74].
Comme dans son analyse géniale de l’antithèse qui sous-tend les premières pages de Sarrasine de Balzac [75], Barthes transforme la réaction de Rancé face à la tête coupée en la représentation littérale d’une figure abstraite : « amoureux, lettré, guerrier, bref mondain, Rancé rentre un soir de la chasse, aperçoit la tête de son amante à côté de son cercueil et passe aussitôt sans un mot à la religion la plus farouche : il accomplit ainsi l’opération même de la contrariété, dans sa forme et dans son abstraction [76] ». Et si les commentateurs religieux ont toujours repoussé l’idée d’une tête coupée qui aurait provoqué la conversion spectaculaire de Rancé, il est peu surprenant, selon Barthes, que les poètes aient célébré ce qui, à la lettre, est un événement poétique :
il n’est possible, si l’on veut, qu’en littérature ; il n’est ni vrai ni faux, il fait partie d’un système. […] La littérature substitue ainsi à une vérité contingente une plausibilité éternelle ; pour que la conversion de Rancé gagne le temps, notre temps, il faut qu’elle perde sa propre durée : pour être dite, elle devait se dire en une fois [77].
C’est la raison pour laquelle la Vie de Rancé concerne Chateaubriand, ainsi que « ces lecteurs lointains que nous sommes [78] ». Certainement, c’est la raison pour laquelle elle concernera le Barthes de la Vita Nova, car son récit de conversion exige une coupure abrupte de sa vie entre un « avant » et un « après » – coupure lui permettant, à travers ses résonances intertextuelles, de subsumer la perte empirique de sa mère dans une structure symbolique. Toutefois, dans sa préface de 1965, Barthes ne parle pas encore le langage métaphorique du « milieu du chemin de la vie », ni d’une « vita nova ». S’il avait relu la Vie de Rancé au moment d’écrire « “Longtemps, je me couchée de bonne heure…” », il n’aurait certainement pas manqué de relever la précision arithmétique avec laquelle Chateaubriand construit la dernière antithèse de son texte : « Rancé avait été soixante-quatorze ans sur la terre, dont il avait vécu trente-sept dans la solitude, pour expier les trente-sept qu’il avait passés dans le monde [79] ». Il n’aurait pas négligé non plus l’allusion dantesque que l’on lit plus ou moins à mi-chemin du texte, et qui lui sert de charnière : « Ici commence la nouvelle vie de Rancé [80] ».
À la fin du premier paragraphe de sa préface, Barthes interroge :« À quoi donc la Vie de Rancé peut-elle nous convertir, nous qui avons lu Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Genet ou Blanchot ? [81] ». Évidemment, la fonction de la préface est de répondre à cette question, et bien avant la fin le lecteur a compris que ce qui est en jeu est une conversion a la Littérature. Pourtant, dans le dernier paragraphe, Barthes pose encore des questions quant au but de la littérature : « À quoi donc sert-elle ? […] À quoi sert […] d’appeler la vieillesse voyageuse de nuit ? […] À quoi sert la tête coupée de la duchesse de Montbazon ?” [82] ». Sa conclusion, qui s’accorde prophétiquement avec les préoccupations d’un Barthes endeuillé – un converti en série, s’il en fut, à la religion de la littérature – est que l’ensemble d’opérations qui constitue la littérature « sert peut-être à ceci : à moins souffrir ». Bien sûr, poursuit-il, appeler la vieillesse « la voyageuse de nuit » ne peut guérir définitivement du malheur de vieillir, « car d’un côté il y a le temps des maux réels qui ne peuvent avoir d’issue que dialectique (c’est-à-dire innommée), et de l’autre quelque métaphore qui éclate, éclaire sans agir [83] ». Néanmoins, Barthes emprunte comme titre original de sa préface la métaphore dont se sert Chateaubriand pour parler de la vieillesse – « La Voyageuse de Nuit » – et il fait des stratégies rhétoriques de la Vie de Rancé la réponse de l’écrivain à une déréliction partagée : « Et cependant cet éclat du mot met dans notre mal d’être la secousse d’une distance : la nouvelle forme est pour la souffrance comme un bain lustral [84] ». La littérature, qui distance la souffrance et renouvelle son langage, purifie et rénove la souffrance même. Assimilant cette distanciation salutaire à l’ironie, à laquelle il attribue une vertu positive qui s’accorde à son sens étymologique de questionnement, Barthes décrit la Vie de Rancé comme « une œuvre souverainement ironique [85] » au titre de l’attention assidue qu’elle prête à la difficulté d’être. C’est en ce sens qu’il semble trouver exemplaire cette toute dernière œuvre de Chateaubriand. La distance ironique de cette biographie des plus littéraires transcende l’acédie existentielle du deuil, de l’ennui, et de la vieillesse. Le mot « ironie » est utilisé ici, comme dans le récit conversionnel à moitié esquissé de la Vita Nova de Barthes, non pas comme un outil sarcastique voué à la moquerie ou à la démystification – la comparaison de Sylviane Carpentier avec l’abbé de Rancé, les crises qui font de l’écrivain un Grand Écrivain – mais comme une stratégie créatrice pour subsumer la souffrance contingente (« un deuil cruel et irréductible [86] ») dans l’éternité d’un mythe littéraire.
[1] Ce texte est la reprise d’une conférence donnée au séminaire Roland Barthes à l’ENS en décembre 2014, objet d’une première publication en anglais : Diana Knight, « What Turns the Writer into a Great Writer ? The Conversion Narrative of Barthes’s Vita nova ». L’Esprit créateur 55.4, 2015, p. 165-180 (numéro spécial What’s So Great About Roland Barthes ?, dir. Thomas Baldwin, Katja Haustein et Lucy O’Meara).
[2] Pour la version écrite, voir Dominique Rabaté, « Une conversion intérieure », dans La Vita Nova : La vie comme texte, l’écriture comme vie, dir. Marie Gil et Frédéric Worms, Paris, Hermann, 2016, p. 132 (« Roland Barthes à qui nous devons le sens que prend maintenant l’expression même de Vita nova, lui qui en est réellement l’inventeur »). Ce colloque reflétait les préoccupations de ses directeurs : sur la « Vita nova » de Barthes, voir Marie Gil, Roland Barthes : Au lieu de la vie, Paris, Flammarion, 2012, p. 466-477 ; pour une méditation plus générale, voir Frédéric Worms, Revivre : éprouver nos blessures et nos ressources, Paris, Flammarion, 2012. Que Barthes ait acquis droit de cité dans cette tradition est illustré par la place que lui accorde Jean-Pierre Martin dans Éloge de l’apostat : Essai sur la « vita nova », Paris, Seuil. 2010, p. 175-198.
[3] Ma propre fascination pour ce projet date de la première publication des plans par Éric Marty en 1995 et précède la parution de La Préparation du romanen 2003. Voir mon article (publié en anglais dans Nottingham French Studiesen 1997) : Diana Knight, « Vaines pensées : la Vita nova de Barthes », dans Sur Barthes, dir. Claude Coste, Revue des sciences humaines, n° 268, 2002, p. 93-107.
[4] Le « Grand fichier » de Barthes, déposé à la BnF, est toujours réservé. Cependant, plusieurs fiches ont été citées ou reproduites en 2015. Voir Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Seuil, 2015, notamment p. 649-661 pour sa discussion de Vita nova, et Roland Barthes, Album : Inédits, correspondances et varia, éd. Éric Marty, Paris, Seuil, 2015, p. 371-372 et XXXIII-LXIV.
[5] Leçon (1978), dans Roland Barthes, Œuvres complètes, éd. Éric Marty, 5 tomes, Paris, Seuil, 2002 [désormais OC], V, p. 446.
[6] Prétexte : Roland Barthes. Colloque de Cerisy, dir. Antoine Compagnon, Paris, Union Générale d’Éditions, 1978, p. 366.
[7] Ibid.
[8] Ibid., p. 251.
[9] Voir Frédéric Berthet, « Idées sur le roman », dont une citation tirée de la préface des Crimes de l’amour avait provoqué l’anecdote de Barthes (« et voilà la base de tous les romans : [l’homme] en a fait pour peindre les êtres qu’il implorait, il en a fait pour célébrer ceux qu’il aimait ») ; ibid., p. 349.
[10] « Délibération »,OC, V, p. 675-676.
[11] Ibid., p. 669.
[12] « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” », OC, V, p. 467.
[13] « “Longtemps” »,OC, V, p. 467-468. Quant à la version du cours, je pense surtout à ce que dit Barthes du « peignage douloureux des cheveux par Françoise », commentaire qui, de par sa résonance personnelle, est tout aussi « intolérable » que le « moment de vérité » proustien qu’il décrit : « Pourquoi est-ce que c’est vrai (et non pas réelou réaliste) ? Parce que par cette radicalité du concret […], l’écrivain désigne ce qui va mourir : plus c’est concret, plus c’est vivant, et plus c’est vivant, plus cela va mourir ; peigner les cheveux de quelqu’un qui va mourir, c’est le déchirement absolu parce que ses cheveux sont encore vivants, ils sont vivants mais ils vont mourir : c’est le utsuroi japonais : une sorte de plus-value énigmatique qui est donnée par l’écriture et qui justifie intégralement, en dehors de toute théorie, l’écriture. » Voir Roland Barthes, La Préparation du roman : Cours au Collège de France 1978-1979 et 1979–1980, éd. Nathalie Léger et Éric Marty, Paris, Seuil, 2015, p. 228.
[14] Ibid., p. 467.
[15] Ibid., p. 468.
[16] Ibid.
[17] Ibid., p. 227 (transcription amendée par moi-même).
[18]« “Longtemps” », OC, V, p. 469.
[19] Ibid., p. 465.
[20] Ibid., p. 466.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid., p. 466-467.
[24] Ibid., p. 467.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] Roland Barthes, La Préparation du roman I et II : Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), éd. Nathalie Léger, Paris, Seuil/IMEC, 2003, p. 25-43.
[28] Ibid., p. 31.
[29] Ibid., p. 31-32.
[30] Ibid., p. 32.
[31] Ibid.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Vita nova, OC, V, p. 1008-1009.
[35] Ibid., p. 1008, p. 1014.
[36] Jonathan Culler, Roland Barthes, trad. Sophie Campbell, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2015, p. 154 (première publication en anglais, Barthes : A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2002).
[37] Barthes, La Préparation du roman, éd. 2003, p. 326.
[38] Jonathan Culler, « Preparing the Novel : Spiralling Back », dans Roland Barthes Retroactively : Reading the Collège de France Lectures, dir. Jürgen Pieters et Kris Pint, Paragraph 31.1, 2008, p. 115 (je traduis).
[39] Ibid. (citant Barthes, La Préparation du roman, éd. 2003, p. 326).
[40] Ibid.
[41] Culler, Roland Barthes, op. cit., p. 122.
[42] Culler, « Preparing the Novel », op. cit., p. 110.
[43] Ibid., p. 115 (citant Barthes, La Préparation du roman, éd. 2003, p. 280).
[44] La Préparation du roman, éd. 2003, p. 326.
[45] Je tiens à remercier Béatrice Damamme-Gilbert de m’avoir fait comprendre à quel point les remarques de Barthes sur les schémas de Castex et Surer sont exactes. En l’occurrence Barthes, incapable de montrer à l’assistance le tableau sur lequel il avait voulu esquisser son schéma parodique, avait dû se contenter d’une description verbale. Il avait eu plus de succès dans son cours sur Le Neutre. Reproduisant le schéma qui représente la vie de Proust, Barthes souligne la force de cette simplification visuelle qui transforme une retraite incertaine en mythe : « Y a-t-il une retraite proustienne ? Je l’ai toujours cru, fortement, et je me suis nourri de cette image (Castex et Surer, XXesiècle). […] J’ai dit : mythe. En fait, je me suis aperçu que l’image de la retraite proustienne me venait uniquement du schéma Castex-Surer que j’ai cité. […] [U]ne vraie coupure est mal repérable. » Voir Roland Barthes, Le Neutre : Cours au Collège de France (1977–1978), éd. Thomas Clerc, Paris, Seuil/Imec, 2002, p. 183-185, ainsi que P.-G. Castex et P. Surer, Manuel des études littéraires françaises : XXesiècle, Paris, Hachette, 1953, p. 78. Bizarrement, Barthes dit avoir changé l’ordre de présentation des figures du Neutre pour répondre à une lettre anonyme lui invitant à se retirer (Le Neutre, p. 177) ; cependant, la proximité chronologique de sa présentation de « La retraite » (le 13 mai 1978) et du mythique « 15 avril 1978 » est frappante.
[46] Je pense, bien sûr, à Michel-Antoine Burnier et Patrick Rambaud, Le Roland-Barthes sans peine, Paris, Balland, 1978, qui parodie, entre autres choses, la suite de photographies privées qui ouvre Roland Barthes par Roland Barthes.
[47] La Préparation du roman, éd. 2003, p. 326.
[48] La Préparation du roman, éd. 2015, p. 466 (séance du 2 février 1980).
[49] La Préparation du roman, éd. 2003, p. 326-7. Pour les schémas qui sont censés représenter la vie de Chateaubriand et celle de Hugo, voir P.-G. Castex et P. Surer, Manuel des études littéraires françaises : XIXe siècle, Paris, Hachette, 1950, p. 23 et p. 65.
[50] François-René de Chateaubriand, Essais sur les révolutions ; Génie du christianisme, éd. Maurice Regard, Paris, Gallimard, 1978, p. 1282.
[51] « Entretien » (1980, avec Laurent Dispot), OC, V, 938.
[52] Mythologies(1957), OC, I, p. 706–707.
[53] « “Longtemps” », OC, V, p. 468.
[54] Ibid., p. 466-467.
[55] Chateaubriand, Vie de Rancé, précédé de « La voyageuse de nuit » par Roland Barthes, Paris, Union Générale d’Éditions, 1965. La version légèrement remaniée, republiée par Barthes dans Nouveaux essais critiques (1972), abandonne le titre original.
[56] Chateaubriand, Vie de Rancé, éd. Marius-François Guyard, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p. 10. Guyard mentionne plusieurs fois la préface de Barthes, antérieure de quatre ans à la sienne.
[57] Soirées de Paris, OC, V, p. 980.
[58] « Pour un Chateaubriand de papier », entretien avec Jean-Paul Enthoven, OC, V, p. 767.
[59] Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, dir. Maurice Levaillant, 4 tomes, Paris, Flammarion, 1948, I, p. 1 et IV, p. 606.
[60] Barthes, « Chateaubriand : Vie de Rancé »,OC, IV, p. 58.
[61] Ibid., p. 56.
[62] Ibid.
[63] Ibid., p. 56-57.
[64] Ibid., p. 57. Cette allusion à l’illumination joyeuse de Roquentin – seule une nouvelle forme d’écriture (« Une autre espèce de livre. […] Un livre. Un roman ») pourrait le sauver de la contingence de l’existence – fait entrer La Nausée dans le corpus barthésien de récits de conversion (et fait du roman de Sartre un intertexte important pour Vita nova que j’entends explorer ailleurs). Pour l’épiphanie ultime (et beaucoup commentée) de Roquentin, voir Jean-Paul Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, 1938, p. 247-248.
[65] Barthes, « Chateaubriand :Vie de Rancé », OC, IV, p. 57.
[66] Ibid., p. 55.
[67] Ibid., p. 57. Barthes pense-t-il ici au « vivre ou raconter » de Roquentin (La Nausée, p. 62) ?
[68] Ibid., p. 57-58.
[69] Ibid., p. 57.
[70] Ibid., p. 59.
[71] Ibid., p. 60.
[72] Ibid.
[73] Ibid., p. 62.
[74] Ibid.
[75] Voir S/Z, OC, III, p. 140-141 et p. 172-173.
[76] Ibid.
[77] Barthes, « Chateaubriand :Vie de Rancé », OC, IV, p. 62-63.
[78] Ibid., p. 63.
[79] Chateaubriand, Vie de Rancé, 1965, p. 183.
[80] Ibid., p. 103. Reprise de la célèbre formule qui ouvre la Vita Novade Dante :« incipit vita nova ».
[81] Barthes, « Chateaubriand : Vie de Rancé », OC, IV, p. 55.
[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] Ibid.
[85] Ibid.
[86] « “Longtemps […]” »,OC, II, p. 467.