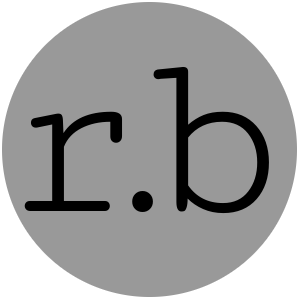Penser la théorie au futur (Barthes, Genette, Todorov)
C’est souvent avec inquiétude ou circonspection, aujourd’hui, que l’on évoque l’actualité, et a fortiori l’avenir de la théorie littéraire. Depuis le reflux du structuralisme vers le mitan des années 1970, l’heure du bilan n’a cessé de sonner. Antoine Compagnon, Tzvetan Todorov et d’autres ont ainsi multiplié ces dernières années les témoignages et les synthèses, se retournant sur ce présumé « âge d’or » de la théorie littéraire, pour en dresser l’inventaire et en juger la postérité.
La peur
La démarche biographique est une démarche de compréhension : saisie intellectuelle et totalité, connaissance compréhensive (selon la définition du TLF, « Qualité, attitude d’une personne compréhensive, capable de saisir la nature profonde d’autrui dans une communion affective, spirituelle allant parfois jusqu’à une très indulgente complicité »). Certains points résistent pourtant à toutes ces formes de compréhension, ce qui est le cas avec Barthes de la peur.
Barthes et la question homosexuelle – Avant propos
Le colloque international « Roland Barthes et la question homosexuelle » s’est tenu à l’université de la Sorbonne Nouvelle les 7 et 8 octobre 2022. Organisé par Bruno Blanckeman (université de la Sorbonne Nouvelle), Claude Coste (université de Cergy Paris-Item-CNRS),...
Il n’y a pas de question homosexuelle
« Le monde homosexuel n’est pas tellement intéressant. C’est le monde à partir d’un homosexuel qui est intéressant. Toujours l’Indirect. » (Roland Barthes, Grand Fichier, fiche n°302, 5 juin 1978) Roland Barthes était un « ficheur », selon la désignation alors en...
Roland Barthes, « L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » : le neutre
Copi[1] La référence à Copi – icône du courant gay qui a émergé dans les années 1960-1970 à Paris – au travers du titre d’une de ses pièces, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer[2], ne vise pas à associer Roland Barthes au dramaturge argentin par une...
Inexprimable amour ? Lecture de Fragments d’un discours amoureux.
En épigraphe des Fragments du discours amoureux, on peut lire : « le discours amoureux est aujourd’hui d’une extrême solitude[1] ». Le discours amoureux des Fragments du discours amoureux est le discours que personne ne tient tout haut, que le lecteur lit à voix...
Le théâtre comme lieu, structure et métaphore de l’homosexualité dans l’œuvre de Roland Barthes.
S’interroger sur l’homosexualité de Roland Barthes conduit à ne pas faire abstraction de la vie de l’écrivain et à voir comment elle se reconfigure et s’écrit dans l’œuvre[1]. Si « le temps amoureux a une forme : c’est le fragment [2]», celle de l’espace du désir est...
La figure du gigolo
Il importe, pour commencer, de bien préciser que le mot « Barthes » dans les pages qui vont suivre ne désigne pas un homme, mais, par métonymie, une œuvre – même si l’ensemble des textes retenus, essentiellement « Incidents » (notations prises au Maroc), « Soirées de...
Trois, Deux, Un. L’Androgyne, un fantasme de Roland Barthes
Dans Le Sexe des Modernes (2021), Éric Marty a récemment mis en perspective la théorie du Neutre avec les thèses de Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan, et Butler sur la sexualité et le genre, la transidentité et le drag, le queer et l’homosexualité. Alors que Barthes...
À distance respective: Roland Barthes/Hervé Guibert
Hervé Guibert publie son premier livre, La Mort propagande, en 1977, suite de récits porno-poétiques dans un certain air du temps, qui se cherchent une singularité en mettant à l’épreuve la langue normative[1]. Il s’inscrit par là même dans la tentation d’une...
Roland Barthes & Renaud Camus
Commençons par la biographie, avant d’aller vers le biographique[1]. Évoquant les années 1974-1978 de la vie personnelle de Barthes, Marie Gil réunit quelques fils qui n’ont rien d’épars et forment même un réseau affectif précis : « Dans le patchwork des amitiés […],...
Roman et « désir raconté ». Lecture de « F.B. »
« F.B » est le titre d’un essai de Barthes au statut particulier, daté de 1964 comme les Essais critiques, mais publié vingt ans plus tard, de façon posthume, à l’initiative de François Wahl dans Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. Le texte occupe neuf...