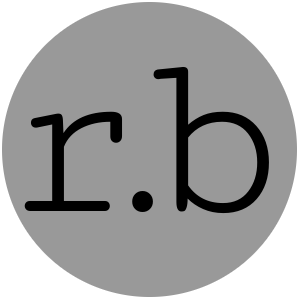Il importe, pour commencer, de bien préciser que le mot « Barthes » dans les pages qui vont suivre ne désigne pas un homme, mais, par métonymie, une œuvre – même si l’ensemble des textes retenus, essentiellement « Incidents » (notations prises au Maroc), « Soirées de Paris » (extraits d’un journal) et de nombreuses fiches tirées du Grand Fichier[1] (1975-1980), revêtent un indiscutable caractère autobiographique[2]. Que s’est-il réellement passé dans la vie de Barthes, au Maroc, à Paris, dans les différents lieux de rencontre homosexuelle ? Il est difficile de répondre avec exactitude sur la nature des faits et la véracité des comptes rendus est toujours sujette à caution. Cet article se propose ainsi d’analyser les discours et non les faits concernant la prostitution et tout particulièrement la figure du gigolo. Comment se manifeste chez Barthes un imaginaire de la sexualité et du désir ? Comment se construit un discours à la fois pour soi (le fichier) et pour les autres (l’ensemble des textes publiés ou destinés à la publication) ? La réponse est d’autant plus complexe que le point de vue écrit de Barthes évolue nettement au cours du temps.
Mise à distance
La première attitude consiste à condamner la prostitution comme une pratique révélatrice des dysfonctionnements de la société et à réhabiliter la prostituée comme victime ou comme puissance transgressive. C’est ce type d’analyse que l’on peut lire dans l’article (« La mangeuse d’homme ») que Barthes consacre à Nana, le roman d’Émile Zola, en 1955. La seconde attitude, plus délicate, correspond aux écrits sur le Maroc et, en particulier, à « Incidents » où sont évoquées de nombreuses rencontres sexuelles dans un contexte homoérotique proche de Gide, Genet ou Montherlant. Or, quand elle est explicitement présente, la prostitution ne concerne que les relations hétérosexuelles, à l’instar de L’Immoraliste ou de Si le grain ne meurt. Dans les rares passages où elle intervient, elle est évoquée de manière caricaturale, loin de toutes formes d’érotisme ou d’hédonisme. En quelques mots frappants, Barthes traduit la situation d’un pays où domine la frustration sexuelle envisagée d’un point de vue strictement masculin :
La gardienne du marabout est une vieille femme édentée qui initie les garçons du village pour cinquante francs l’un. (I, OCV, I, 975)
Le groupe des garçons s’est cotisé pour se payer une putain ; l’un a fait trente kilomètres à bicyclette pour la chercher à A., rapporter de la boisson ; ils lui ont ensuite passé dessus. (I, OCV, 975)
Tout au plus trouve-t-on une allusion à la prostitution homosexuelle dans un fragment très visuel : « Sur la plage de Tanger (familles, tantes, garçons), de vieux ouvriers, comme des insectes très anciens et très lents, déblayent le sable. » (OCV, I, 959) La syntaxe met en avant la métaphore des ouvriers, quand la parenthèse condense les activités très contrastées d’une ville symboliquement associée par la littérature (Genet, Bowles…) aux rencontres masculines. S’agit-il d’un exemple de figure Moussu[3], cette pratique qui consiste à dire l’essentiel à l’arrière-plan de la phrase ? Difficile de répondre : on soulignera tout au plus le dégradé ludique qui conduit de « familles » au double sens du mot « tante » pour aboutir au mot « garçons », très connoté du côté de l‘homosexualité (on pense aux Garçons de Montherlant).
Quand les relations homosexuelles apparaissent, la prostitution et l’argent sont clairement absents. Ainsi, un fragment décrit un bref échange très révélateur de l’attitude de Barthes : « Petit instituteur de Marrakech : ”Je ferai tout ce que vous voudrez.”, dit-il, plein d’effusion, de bonté, et de complicité dans les yeux. Et cela veut dire : je vous niquerai, et cela seulement. » (I, OCV, 972) Bénéficiant d’une réelle position sociale à défaut d’un bon salaire, l’instituteur n’a rien à vendre : malgré la condescendance de l’adjectif « petit », il est présenté comme un être de désir et non comme une victime de l’Occidental dans un contexte postcolonial. L’incident nous rappelle que si l’étranger se comporte souvent comme un prédateur sexuel (l’argent du riche achète le corps du pauvre), il peut aussi se révéler comme une chance, une bonne occasion de rencontres pour des Marocains dont la sexualité est vouée à la clandestinité. L’étranger, c’est celui qui passe, qui ne compromet pas, contrairement au voisin, au cousin ou au proche, qui observent et qui parlent.
Dans d’autres fragments, Barthes met en scène des anecdotes avec des enfants (l’argent est présent), mais dans une relation – parfait exemple de la théorie du don et du contre-don – qui n’a rien de sexuel. C’est tantôt fleurs contre écriture (avec un épisode qui rappelle le désir triangulaire de René Girard) :
Le petit I. m’apporte des fleurs, un vrai bouquet champêtre : quelques têtes de géraniums, une branche d’églantines rouges, deux roses, quatre brins de jasmin. Ce mouvement qu’il a eu, c’est à la suite d’un grand plaisir que je lui ai fait : écrire son nom, de plusieurs façons à la machine, sur un papier que je lui ai donné (des fleurs contre l’écriture.)/Ayant donné une aspirine à l’un, tous ont maintenant mal à la tête et cela tourne à la distribution d’hôpital. (I, OCV, 975)
C’est tantôt argent contre transport (avec, en arrière-plan culturel, la déférence que l’on doit, non pas à un Français, mais à un adulte) :
Mais aussi : à Settat, j’ai pris en stop un garçon de douze ans ; il porte un gros sac en plastique plein d’oranges, de mandarines et un paquet entouré d’un vilain papier d’épicier ; sage, sérieux, réservé, il ne lâche rien de tout cela, qu’il a posé sur ses genoux, dans le creux de sa djellaba. Il s’appelle Abdelatif. En rase campagne, sans un village en vue, il me dit de stopper et me montre la plaine : c’est par là qu’il va. Il m’embrasse la main et me tend deux dirhams (sans doute le prix de l’autobus, qu’il avait préparé et tenait serré). (I, OCV, 971)
C’est enfin thé contre transport (avec l’éloge d’une ingéniosité presque magique) :
Sur la route de Marrakech à Beni-Mellal : un adolescent pauvre, Abdelkrim, ne parlant pas français, porte un panier rustique, rond. Je le prends en stop pour quelques centaines de mètres. A peine monté dans l’auto, il tire de son panier une théière et me tend un verre de thé chaud (chaud, comment ?) ; puis il descend, disparaît sur le côté de la route. (I, OCV, 972)
Ces saynètes, dans un recueil souvent critique à l’égard du Maroc, sont autant d’hommages au raffinement d’une culture à la fois populaire et ancestrale.
Si la sexualité est très présente dans « Incidents », si l’argent et le commerce ont une place récurrente, rien ne renvoie à la figure du gigolo. Cela pose une question générale touchant l’activité critique : comment lire un texte ? Quelle relation établir entre texte et contexte, sans sacrifier l’un à l’autre ? En effet, l’absence de la prostitution masculine appelle au moins trois lectures différentes. La première qui privilégie la lettre tient compte des « incidents » tels qu’ils sont écrits, sans leur substituer la réalité des événements. La seconde qui transforme l’absence en implicite considère que la prostitution est présente dans le texte sous la forme d’un non-dit qui dit bien ce qu’il veut dire. Quant à la troisième lecture, elle s’inquiète du dispositif savamment construit par Barthes, comme s’il s’agissait d’éliminer tous les indices renvoyant à une sexualité tarifée. En d’autres termes, c’est l’effort même pour cacher qui désignerait le masque et la dissimulation. Il appartient à chacun de choisir sa démarche. On rappellera cependant que la troisième lecture, proche du procès d’intention, prend le risque de considérer toute défense comme un déni et de voir dans toute protestation d’innocence une preuve de culpabilité. Et si la réalité doit faire la leçon au texte, on rappellera à toutes fins utiles que le désir de Barthes ne s’est jamais tourné vers les enfants.
Éloge ambigu du contrat
Après la condamnation et l’évitement, la troisième attitude, plus audacieuse, correspond à un renversement complet : elle consiste en un éloge paradoxal de la prostitution (« Éloge ambigu du contrat ») dans Roland Barthes par Roland Barthes. Le texte est souvent cité :
En même temps encore et à un dernier niveau, le contrat est sans cesse désiré, comme la justice d’un monde enfin « régulier » : goût du contrat dans les relations humaines, grande sécurité dès qu’un contrat peut y être posé, répugnance à recevoir sans donner, etc. À ce point – puisque le corps y intervient directement – le modèle de bon contrat, c’est le contrat de Prostitution. Car ce contrat, déclaré immoral par toutes les sociétés et tous les régimes (sauf très archaïques), libère en fait de ce qu’on pourrait appeler les embarras imaginaires de l’échange : à quoi m’en tenir sur le désir de l’autre, sur ce que je suis pour lui. (OCIV, 638-639)
En d’autres termes, comme le précise Barthes dans la suite du fragment, ce contrat libère des complications affectives et du méli-mélo sentimental ; de manière plus générale, il évite l’égoïsme qui prend sans donner et la sainteté qui donne sans recevoir (ce qui renvoie, une fois encore, à la dialectique du don et du contre-don[4]).
Mais peut-on croire un instant à la réalité d’un tel paradoxe ? à l’équilibre harmonieux entre celui qui achète une prestation sexuelle et celui qui la donne ? Une fois encore, il ne s’agit pas d’opposer la vie au texte, mais de confronter un texte avec d’autres textes, pour les faire dialoguer. En effet, plusieurs fiches dénoncent implicitement ce contrat (une heureuse relation sans affects) comme une posture intenable. De nombreux exemples le montrent très clairement : la prostitution et la figure du gigolo sont étroitement liées à l’âge – l’âge du client plus encore que celui du vendeur. Autrement dit, la vieillesse, comme non-dit du texte, entre en étroite liaison avec l’éloge du contrat. Barthes a largement passé la soixantaine quand il rédige la fiche suivante :
8 oct 79. Dès qu’il y a disparité d’âges, il y a virtuellement contrat, car on n’échange pas la même chose : ce n’est pas désir contre désir, c’est désir contre sagesse, expérience, notoriété etc./Gigolos : modèle de rapport, puisque désir contre argent, modèle-joker bien connu valable pour tout autre chose. (GF, 768)
Entre réalité et métaphore, le gigolo est un « modèle-joker », une clé pour appréhender de nombreuses relations, à commencer par la relation enseignante. Que peut offrir un vieil homme ? De l’argent et du savoir : « Le rapport enseignant-enseigné, c’est […] un rapport contractuel qui est un rapport de désir. Un rapport de désir réciproque qui implique la possibilité de la déception et donc de la réalisation. Je pourrais dire de façon provocante : un contrat de prostitution. » (« A quoi sert un intellectuel ? », OCV, 381) Autrement dit, le contrat de prostitution, au sens propre comme au sens figuré[5], replace le désir au cœur de l’échange, mais un désir déséquilibré, chacun des partenaires ayant ses propres attentes[6]. Qu’est-ce qu’on achète quand on se tourne vers un gigolo ? Son corps et sa disponibilité, ni plus, ni moins : mais jamais la réciprocité de son désir. Comme on peut le lire dans une fiche qui dit tout d’une manière un peu brutale : « Les gigolos ne bandent pas[7]. »
Le théâtre de la mauvaise foi : le gigolo
Quand le fragment de Roland Barthes par Roland Barthes donne une approche hédoniste du contrat, les nombreuses fiches écrites dans les années 70 mettent en scène les décalages dans la relation d’un homme mur avec de jeunes gigolos. On assiste en voyeur à une petite phénoménologie du désir, entre bonheurs[8] et déceptions. À l’origine, on trouve, naturellement, le corps du gigolo, mais un corps fragmenté, un corps remodelé par le regard. Voici un exemple très significatif de cette petite comédie racontée avec un humour assez mélancolique :
Plus tard dans la soirée, au Flore, non loin de notre table, un autre, angélique avec ses cheveux longs coupés d’une raie au milieu ; de temps en temps il me regarde ; m’attire sa chemise très blanche ouverte sur sa poitrine ; il lit le Monde et boit du Ricard, je crois ; ne part pas, finit par me sourire ; il a de grosses mains, qui démentent la douceur et la délicatesse du reste ; c’est de ses mains que j’induis le gigolo (il finit par partir avant nous ; je l’arrête, parce qu’il sourit, et prends un vague rendez-vous). (SP, OCV, 983[9])
Dans cet échange qui n’a rien d’euphorique, qui agit ? Est-ce l’objet qui suscite le désir ou le sujet qui investit l’objet ? On se situe plutôt dans un entre-deux qui correspond à une forme d’intentionnalité. Le corps de l’autre saute aux yeux, mais le regard de Barthes se l’approprie en découpant et en en fétichisant une partie (mains, dents, courbure du nez, coiffure reviennent le plus souvent…) selon un désir qui fonctionne sur le déplacement synecdotique (un fragment pour la totalité du corps) ou métonymique (la chemise pour la poitrine).
Dans cette construction précaire, le choc des contraires suffit à mettre fin au désir, qui se volatilise aussi rapidement qu’il est apparu. Dans « Incidents », comme dans les nombreuses fiches consacrées au Maroc[10], Barthes se montre très sensible aux oppositions, aux effets de contraste[11]. Dans les fiches consacrées aux rencontres avec les gigolos, le procédé revient constamment. Si dans l’exemple cité plus haut, le contraste entre Le Monde et le Ricard, entre la lecture intellectuelle et la boisson populaire, ne produit pas d’effet négatif, l’apparition des mains, des grosses mains, ramène le désir au prosaïsme de la prostitution, malgré un échange timide, qui n’aura d’ailleurs pas de suite.
Autant que les corps, les mots jouent un rôle essentiel dans le double processus d’excitation et de déception, qu’il s’agisse d’un mot à propos d’un gigolo[12] ou des mots du gigolo lui-même. Dans plusieurs fiches, le corps et la parole entrent en conflit, celle-ci venant ruiner le désir de celui-là. Pour ruser avec la réalité, se met alors en place un théâtre de la séduction qui ne trompe véritablement personne. Chaque partenaire joue comme il peut son rôle dans un échange dominé par la mauvaise foi. Du côté du gigolo, il est frappant de voir combien les mots jouent à la respectabilité, transforment maladroitement une relation tarifée en une rencontre humaine. Cette comédie de la pudeur concerne au premier chef un mot-clé comme « micheton ». Venant du prénom « Michel » et du dérivé « miché » au sens de « niais », le « micheton » désigne le client que l’on peut tromper facilement. Mais qui cherche à tromper qui ? Le gigolo qui ment au client potentiel se ment d’abord à lui-même pour donner une image respectable de sa personne :
Le gigolo Ivan, par pudeur euphémique, n’osant prononcer le mot « micheton » (jugé sans doute infamant en s’adressant à moi) appelle ses clients des « sujets » : triomphe de la métaphysique. » (GF, 10)
Une autre fiche met en scène, cette fois-ci, la vigilance sémiologique du « micheton » qui déchiffre les signes et ne s’en laisse pas conter :
25 IX 75 sept.-22. Sakis, jeune grec (29 ans) rencontré au Chamarré : bien que visiblement en état de drague michetonneuse, il s’en tient au discours sublime : seulement amis, sympathie, les jeunes ne m’intéressent pas, ils n’ont rien dans la tête etc. Discours type du gig à éviter : très mauvais signe, car duplicité posée d’emblée. (GF, 129)
Dans le langage des gigolos, le mot commande à la réalité ; éviter le mot, c’est éviter la chose par une sorte de cratylisme inversé[13]. De son côté, le client a besoin que le mot, le bon mot, soit prononcé pour que le contrat s’établisse sans ambiguïté. Barthes est abordé par un gigolo : « il s’appelle Dany, […] il est dans la merde (discours typique du gigolo : c’est-à-dire discours chaste où la chose n’est jamais nommée. Chaque fois que j’insiste pour lui faire dire qu’il est vraiment prêt à coucher avec moi, il répond : « Je suis libre. ») (GF, 94) En éludant le mot obscène, Dany sait-il qu’il joue avec Barthes une scène qui, paradoxalement, rappelle la figure « Je t’aime » des Fragments d’un discours amoureux ? En effet, le sujet amoureux, après avoir fait sa déclaration, après avoir prononcé la formule quasi magique du « Je t’aime », attend une réciprocité parfaite, comme si une fois encore la perfection du don avait besoin de la perfection du contre-don :
ce que je veux, c’est recevoir de plein fouet, entièrement, littéralement, sans fuite, la formule, l’archétype du mot d’amour : point d’échappatoire syntaxique, point de variation : que les deux mots se répondent en bloc, coïncidant signifiant par signifiant (Moi aussi serait tout le contraire d’une holophrase) ; ce qui importe, c’est la profération physique, corporelle, labiale, du mot : ouvre tes lèvres et que cela en sorte (sois obscène). (OCV, 192)
La rencontre entre le comble de l’amour et la crudité de la prostitution ne manque pas d’ironie. À l’obscénité du sentiment amoureux correspondrait l’obscénité de la sexualité[14] ? Faut-il, dans le cadre de la prostitution, établir une équivalence entre un désir purement physique et un désir sentimental ? Après celle du gigolo, la mauvaise foi de Barthes n’est pas loin de le penser.
Théâtre de la mauvaise foi : Barthes
La quête michetoneuse – comprendre : celle du micheton – laisse elle aussi une bonne place à la ruse. Souvent anodin (« J’avais l’idée d’aller chercher un gig à Montmartre ; c’est peut-être pour cela que, de mauvaise foi, je n’ai rien trouvé à Voltaire. » SP, OCV, 988-989), le mensonge que l’on se fait à soi-même intervient la plupart du temps dans des situations psychologiquement plus complexes. Barthes raconte comment il a payé par avance un gigolo qui ne viendra pas au-rendez-vous :
Je me suis demandé si j’avais vraiment tort (tout le monde s’exclamerait : donner à l’avance de l’argent à un gigolo !), et je me suis dit que, puisqu’au fond je n’avais pas tellement envie de lui (ni même de coucher), le résultat était le même : couché ou non, à huit heures je me serais retrouvé au même point de ma vie ; et, comme le simple contact des yeux, de la parole, m’érotise, c’est cette jouissance que j’ai payée. (SP, OCV, 983)
Sur fond de mélancolie, Barthes sauve la mise par un exercice de lucidité qui lui évite de jouer le rôle du « miché », de celui qu’on peut facilement tromper. Sous son apparente escroquerie, le contrat est sauf ; tout le monde s’en tire avec satisfaction, chacun obtient (argent, érotisme) ce qu’il souhaitait.
Plus complexe encore apparaît la distinction entre deux sortes de désir, le « corps-désir » et le « corps-appel[15] ». Le premier correspond à une sexualité purement physique, le second à un désir associé à un affect, à un sentiment, voire à l’amour – « le désir plus qque chose ». Mais derrière cette distinction facile à se représenter se dessine en fait une opposition entre le désir non verbalisé et le désir verbalisé. Une fiche établit clairement la différence en des termes assez crus :
1. 05. 78. Suis de l’Imaginaire : j’aime tout de suite qui je désire.
- Mon désir est donc pris tout de suite dans un « discours », une verbalisation, un madrigal, une idylle, une « psychologie », un baratin.
- Sauf : il m’arrive de désirer sans parler : ordre, lieux lupercaliens, sordides, cinémas, tasses, jardins. Émoi de la queue – de la queue en situation.
- La différence entre ces 2 ordres : dans le second cas, il s’agit d’être sans noms. Avec le Nom apparaît l’Amour. (GF, 128, extrait)
Or, ces deux désirs excluent le gigolo. Même si elle est verbalisée, la prostitution ne relève guère de l’« imaginaire » ou du « baratin » ; inversement, dans les lieux où triomphe le désir-corps, toute autre relation que physique est exclue, qu’elle soit langagière ou commerciale. Ce monde hédoniste et sans affect (ou sans affect lourd), c’est celui que dépeint Renaud Camus dans Tricks[16], récit de dragues homosexuelles préfacé par Barthes[17]. Mais la relation harmonieuse entre le Corps-désir et le Corps-appel, entre le sexe et l’amour, ne relève-t-elle pas de l’Utopie ? L’oscillation entre les deux types de corps ne désigne-t-elle pas un manque – ce manque que le gigolo vient précisément combler ?
Reste une dernière forme de mauvaise foi qui correspond à la question politique et morale. La position de Barthes est embarrassante : il lui est difficile de critiquer la prostitution, de se montrer sensible à la misère physique, économique et psychologique des gigolos[18]. Une telle déploration passerait même pour le comble de la malhonnêteté : rien de pire, d’une certaine manière, que de condamner un système auquel on participe par ailleurs. Le contraste entre le discours (moraliste) et la pratique (sexuelle) trahirait une pure et simple stratégie pour se donner bonne conscience. Comme lors de son voyage en Chine, Barthes se trouve confronté à une aporie dont il va tenter de sortir tant bien que mal. Il commence par éviter deux attitudes possibles, le cynisme (le mal sans culpabilité) et le misérabilisme (l’ivresse compassionnelle). Sa réaction après la vision de Passe ton bac d’abord, le film de Maurice Pialat, témoigne clairement de sa méfiance à l’égard de la victimolâtrie : « je n’aime pas ce type très actuel de message où il faut sympathiser avec des paumés (horizon bouché de la jeunesse, etc.), dont tout l’univers est imbécile : les arrogances du paumé, telle est l’époque. » (SP, OCV, 992) Avec lucidité, il préfère assumer l’ambivalence de ses réactions. Voici comme il réagit en regardant le gigolo Jean-David :
Jean-David, masseur gig du G Tell
Je suis observateur critique, démystifiant et donc sans générosité à l’égard de maints traits (« tics ») et puis en même temps, ou très vite, en tourniquet, revirement : sorte de sympathie, d’amusement, de « compréhension sans objet » (sensiblerie diffuse, idéologie de « l’Homme mon frère » (mais le contraire est aussi ridicule). (GF, 228)
Le « tourniquet » affectif qui passe de la sympathie à la sévérité, de la proximité à la distance, refuse de sacraliser la victime (il existe une forme de ruse et de roublardise chez les gigolos, qui sont aussi des sujets dotés d’une part de liberté) et de nier la misère sociale dans laquelle ils vivent. Mais cela est-il suffisant ? Cet équilibre très instable appelle une sortie dialectique qui passe comme souvent chez Barthes par la littérature.
La dialectique du gigolo
Comment dialectiser la figure du gigolo ? Par dialectique, on entendra toute entreprise pour sortir des oppositions manichéennes (entre le bien et le mal par exemple), soit en en montrant la complexité, soit en cherchant une forme de dépassement (en ce sens-là, le neutre est dialectique, mais d’une manière très différente de la dialectique hégélienne). La première solution consiste sans doute à faire confiance à la vie. Si elle se distingue de la réalité référentielle, l’œuvre naît de cette réalité-même (c’est une banalité de le rappeler) ; or, pour Barthes, la vie présente des traits qui sont, non seulement, des matériaux, mais aussi des modèles pour l’écriture. Ainsi, comme le précise la fiche 62 : « La vie n’est pas un roman mais certainement un tissu de départs de roman. » Le lien entre vie et création se précise dans une autre fiche qui réfléchit au plan de Vita nova, le roman auquel Barthes travailla jusqu’à sa mort :
22 août 79. Plan du 22 août 79 (1) Trop édifiant (« Vanité du monde »), trop déceptif
Plan plat
Ce n’est pas ma façon sincère de vivre le monde. Par ex : la Drague est plus dialectique : vaine soirée mais aussi sorte de menue création du rapport avec le gigolo. (GF, 623)
Ainsi, la dialectique, avant de devenir littérature, appartient déjà à la relation qui lie le client et le prostitué – la seconde dialectique (esthétique) s’inscrivant dans le sillage de la première (existentielle). Ce continuum est accentué par l’emploi du mot « création », commun à la prostitution et au récit fictionnel ; une fois encore, le romancier s’inspire non seulement de la réalité, mais aussi des patrons d’écriture qui sont en quelque sorte inscrits dans la vie.
Ce qui vaut pour la drague vaut tout autant pour la vadrouille. Barthes décrit une expérience liée aux déceptions de l’âge, mais riche de potentialités esthétiques :
Vadrouille :
(La Vadrouille n’est pas la Drague – J’en ai, hélas, passé l’âge = C’est une déambulation à travers des « mauvais lieux » – cinémas, rues à gigolos, repérage de Saunas avec sans doute pour horizon la possibilité d’un plaisir sexuel – mais avec aussi une assez intense activité d’observation et de paresse). (GF, 974, extrait)
La lecture de ces quelques exemples révèle l’importance de deux activités présentes dans la vie et indispensables à l’écriture (et que l’on a déjà rencontrées dans la description des gigolos) : l’observation et la distanciation. Sémiologue d’un nouveau genre, Barthes déchiffre les signes sexuels et tire de ce déchiffrement un plaisir intellectuel. Qui est donc un certain Michel Sauquet ? L’énigme de l’identité se résout dans une fiche de 1979 :
29 XI 79. Reçu Michel Sauquet (il m’avait écrit, je ne le connaissais pas). Sous une jeune moustache, deux dents de devant très séparées déparent son visage doux et régulier. Il se raconte. En partant je l’embrasse il tend son visage en fermant les yeux, geste qui signe en lui la tante. (GF, 946)
On retrouve le même goût pour les énigmes dans de nombreuses fiches où Barthes réfléchit à la nécessité du code. Après avoir répondu à une annonce du Nouvel Observateur, il s’interroge sur l’identité de son interlocuteur. La réponse est rassurante :
Retour de chez le gig :
Relaxation, décontraction et comme plénitude (soulagement ?) parce que l’inconnu s’étant avéré un simple gig, il y a réintégration de la banalité, du code : rassurant.
- Rapport de la Perversion et du Code : elle vécue comme l’exceptionnel absolu – même si en fait elle est codée
- Tout le problème est là : quelque chose de codé, de banal (penser au SM) et vécu intensément comme ironie : surpuissance individuelle.
- L’épisode me définit comme attaché au Code comme une sécurité, une puissance tutélaire à quoi je reviens avec soulagement : fin de la peur. (GF, 902, extrait)
Cette relation au code, très dialectique, touche autant à la vie qu’à l’écriture. La lutte entre la règle et sa transgression, la double nécessité de parler le code pour faire société, et de ruser avec lui pour échapper au pouvoir de la doxa concerne toutes les situations ; mais cette réflexion touche tout particulièrement l’écrivain qui entretient avec la langue une relation complexe oscillant entre la nécessité d’un certain conformisme (il faut être lu) et le besoin impérieux d’inventer sa propre échappatoire.
Vivre et écrire, c’est ainsi trouver le bon mot, le mot qui éclaire et qui soulage. Le 20 novembre 1979, Barthes sort de chez Pierre B :
20 XI 79. Je fus pleinement contenté quand je trouvais le mot : c’était une cocotte ! (ni gigolo, ni entretenu)
Trouver le mot : le code est bouclé. (GF, 903)
Dans plusieurs fiches écrites au Maroc, Barthes met en scène son effort pour dire la beauté du jeune Ahmed, tâtonnant autour de la réalité par un déploiement d’adjectifs et de métaphores, cherchant le mot précis qui rendra compte de la spécificité de l’objet contemplé. Le même effort de justesse se lisait déjà dans Roland Barthes par Roland Barthes : « Je cherche peu à peu à rendre sa voix. J’essaye une approche adjective : agile, fragile, juvénile, un peu brisée ? Non, ce n’est pas exactement cela ; plutôt : sur-cultivée, ayant un arrière-goût anglais. » (OCIV, 646) S’il ne réussit pas toujours à dire directement, l’écrivain n’a-t-il pas plusieurs ruses dans son sac ? Comme le rappelle une note de Fragments d’un discours amoureux, Ronsard pour exprimer la douceur de la femme aimée sort de la tautologie par un excès de tautologie : « Quand je fus pris au doux commencement/D’une douceur si doucettement douce. » (OCV, 243) Face aux yeux d’Ahmed, l’écrivain-voyageur s’en sort finalement grâce à une solution de fortune qui dit malgré tout quelque chose de la singularité du jeune homme : « Je renonce. Un jour, le bon adjectif me viendra. Ou il sera : celui dont je ne puis décrire les yeux. » (GF, ?)
L’observation et la nomination appellent une troisième qualité : la distanciation. Sans lien avec la prostitution, Barthes relate un dîner avec des amis où il se sent quelque peu mal à l’aise :
5 mai 78. Et, soudain, assez triste (toujours l’image de me voir partir), tout d’un coup je reprends courage : je fais un, le décrochage fictionnel : je les prends tous (et leur réunion) pour des êtres de roman. En somme la mise en position romanesque est un moyen de ne plus, de moins souffrir, d’éloigner les blessures, les calices, de se retrouver avec soi-même dans une sorte de sécurité. Roman : pellicule, vernis qui s’interpose entre la blessure et moi, tout en laissant voir, puisque c’est transparent. (GF, 229, extrait)
Le même recul apparaît dans une autre fiche grâce à une métaphore cinématographique :
2 août 78. J’ai même pensé avec excitation à un film où un monologue intérieur accompagnerait ainsi le voyage du Sujet, montrant qui il voit et commente – sans jamais il connaisse ces « rencontres » implicites, intenses et fugitive. Là-dessus ou pourrait broder. (GF, 338, extrait)
Le recul créatif qui transforme le monde en spectacle explique en partie le détachement émotionnel de Barthes à l’égard des gigolos. Cette distance qui relève d’une forme d’hyper-conscience devient ainsi le complément indispensable du pathos, dont il est longuement question dans La Préparation du roman[19]. Quand le pathos est défini comme une forme d’intentionnalité (il est à la fois le monde en tant qu’il affecte le sujet et le sujet en tant qu’il est affecté par le monde), la distanciation est le complément nécessaire à tout acte de création qui cherche à concilier sensibilité et lucidité. C’est au prix d’un tel équilibre que l’on pourra agir, c’est-à-dire écrire une œuvre en transcendant son propre désir :
22 VIII 79. L’Agir, le Faire
= le moment où le désir a assez de force pour transformer, créer (GF, 624)
Un personnage singulier
Comment agir quand on est à la fois client des gigolos et écrivain ? Comment faire du prostitué un objet d’écriture permettant de sortir de la mauvaise foi du désir ? Les pages publiées de « Soirées de Paris », les nombreuses fiches du Grand fichier (dont une grande partie porte sur la conception de Vita nova) traitent les gigolos comme des personnages de roman. Incertain sur la démarche à suivre, Barthes vient de voir Macadam cowboy (1969), un film de John Schlesinger qui raconte les aventures et mésaventures d’un jeune homme venu à New York pour y exercer des activités de gigolo auprès de femmes riches. Le film produit comme un déclic :
31 VIII 79. Vu Macadam Cow Boy
Idée de confier le rôle de conducteur (et Maître : maestro et duce) à un gigolo (itinéraire, parcours d’imitation)
(Dante. Enfer I. 85)
« Tu es mon maître et conseil et auteur ». (GF, 544)
Parmi tous les modèles que se donne Barthes pour écrire son roman, La Divine Comédie de Dante occupe une place aussi importante que La Recherche proustienne, les deux grands classiques reposant sur une même quête du paradis – qu’il s’agisse de Dieu ou de la Littérature. Dans ce long cheminement qui commence avec l’enfer, le guide joue un rôle essentiel : Virgile pour Dante, un ensemble de personnages pour Proust (la mère, la grand-mère, Bergotte, mais aussi Swann et Charlus). L’idée neuve de Barthes consiste à confier ce rôle très valorisant au gigolo, qui se trouve ainsi arraché à sa profession[20] et à son image en devenant le maître de la dialectique, celui qui transforme la drague et la vadrouille en une autre quête, esthétique et existentielle. Une fiche du 30 août décrit le processus qui conduit de l’enfer du deuil au paradis de la littérature sous la conduite du médiateur :
Urt 30 VIII 79.VN
Schéma :
« 1. Deuils
2. Vaines Soirées. La contingence infinie, l’Acédie
3. Je décidai de refaire ces vains trajets, à l’écoute de médiateur qui me disent la Dialectique, la mélange du Bien et du Mal
– la Transcendance
4. Je décidai de rassembler tout cela dans la plus haute expression d’amour qui me fût à la limite possible : une Œuvre. (GF, 660)
Parmi tous les médiateurs possibles, le gigolo occupe une place singulière parce qu’il offre des qualités auxquelles l’ami, par exemple, ne peut pas prétendre. Quand l’ami (si nécessaire par ailleurs) rassure et reste ainsi dans le domaine du « possible[21] », le gigolo ouvre sur un autre monde (par opposition à la bourgeoisie intellectuelle parisienne auquel appartient Barthes). Souvent issu de milieux populaires, le gigolo est l’instrument d’un véritable dépaysement. On aurait ainsi tort de lire de la condescendance dans l’affirmation suivante : « (23. IX. 75) J’ai repris contact avec le peuple : je revois des gigolos[22] ». (GF, 125)
De nombreuses fiches vont dans le même sens de manière insistante. En voici un florilège très représentatif :
23 VIII 79
Gigolo
- Comme Autre
- comme Peuple
- Médiateur de l’Autre-Peuple
- Guide de « vaines soirées » (GF, 631)
22 août 79
« Médiateur »
- Le gigolo comme Autre
- Ami (certains)
- La femme comme agacement » (GF, 625)
Le guide
« celui qui met du souci »
« celui qui met de l’utopie »
(≠ amis (réels)
« Qui met de l’Espoir »
Le jh inconnu
De la Paix (l’ami) » (GF, 656, 657)
L’altérité fantasmée par Barthes se caractérise par sa dimension strictement masculine (« la femme comme agacement »). Mais au sein de cette micro-société, le gigolo offre sa force de contestation (un peu comme la prostituée chez Zola) et crée ainsi une ouverture qui permet de réinventer le monde à la lumière de l’Utopie.
À cette première manière de valoriser le gigolo en correspond une seconde, tout aussi romanesque. En faisant du gigolo un guide, Barthes encourait le risque d’écraser l’individu sous le type, d’annuler les différences sous une dénomination générale qui estompe les particularités de chacun. Il existe bien un « discours gigolo » fait de stéréotypes, mais Barthes manifeste le souci constant de mettre en avant la nature « intraitable », c’est-à-dire irréductible, de chaque gigolo qu’il rencontre et dont il met en valeur la personnalité :
Incidents
Jean-Luc, gigolo – mince, fin, juvénile, me répond, sur une question concernant son travail : « j’ai passé deux ans aux abattoirs et trois en en boucherie. »
Il dit aussi lorsque je lui propose du whisky pour son coca : « juste une larmichette ». (GF, 10)
Hier, en fin d’après-midi, au Flore, je lisais les Pensées de Pascal ; à côté de moi un adolescent mince au visage très blanc, glabre, joli et étrange, insensuel (pantalon de simili-cuir), était affairé à recopier sur un cahier, les prenant sur des feuilles volantes, des phrases, des schémas ; on ne savait si c’était de la poésie ou des mathématiques. Le gig Dany, sourcils noirs et pull rouge, vient à mes côtés, boit un citron pressé, car, dit-il, il a mal à l’estomac, mangeant trop de sandwiches – et parfois ne mangeant rien du tout d’une journée ; il n’a toujours pas de logement ; ses mains, lourdes, sont moites. (GF, 107)
Arrivant à Saint-Germain, un peu plus haut que le Drugstore, un très beau gigolo blanc m’arrête ; je suis surpris par sa beauté, la finesse de ses mains, mais, timide et fatigué, j’allègue un rendez-vous. (GF, 113)
Séance épidictique : le garçon-serveur – en train de manger dans un coin (vin des Rochers, camembert) devant un client solitaire énumère les gigolos morts dans l’année : Claude, François etc. (drogue ou suicide)
Sans éloge : « Il picolait trop » « Il avait un grand nez ») (GF, 79)
On sera sensible, dans ces exemples, à la précision des notations qui alternent et combinent des traits touchant au vêtement, au corps fragmenté (on l’a vu), aux aliments, aux sociolectes et aux idiolectes. Ces personnes devenues personnages échappent aux généralités par l’intérêt quasi brechtien que Barthes accorde aux réalités concrètes. De plus, la plupart de ces gigolos portent un nom qui les distingue les uns les autres : l’identité n’est pas ici une forme de contrôle, mais de reconnaissance. De manière quasi systématique, Barthes note l’incident, ce qui étonne et qui détonne, ce qui arrache chaque scène à un scénario trop connu. La surprise est souvent provoquée par un mot, inattendu, comme la « larmichette » de Jean-Luc (qui parle comme une vieille dame un peu pompette) ou le terme « épidictique » qui, au-delà d’une certaine ironie (l’éloge n’est guère valorisant !), apparente très fugitivement ces piliers de comptoir aux grands rhéteurs de la Grèce antique. Dans cette pré-écriture qui laisse deviner certaines pages du roman à venir, on est frappé par une pratique généralisée de l’asyndète, pour peu qu’on donne à ce terme un sens plus rhétorique que grammatical : les notations sont juxtaposées, empruntées à des domaines différents, tel détail surgissant au cours d’une description qui ne manifeste aucun esprit de suite. Grâce à un ensemble assez décousu, Barthes évite de brosser un tableau ou un portait qui tirerait l’interprétation du côté de la généralité : la réalité est donnée dans sa diversité, son mystère, chaque gigolo imposant, en dépit des stéréotypes, une présence qui échappe aux classifications.
Quand le désir de l’homme âgé feint de croire à l’équilibre du contrat prostitutionnel, quand la comédie de la mauvaise foi, avec ses ombres et ses lumières, cherche difficilement une sortie dialectique, quand le « micheton » refuse le cynisme et la bonne conscience, la solution passe une fois encore pour Barthes par la littérature comme art de la singularité. L’entreprise ne va pas sans grandeur, mais la dialectique n’est jamais sûre… Et si la littérature se révélait finalement comme la plus subtile et donc la plus dangereuse des mauvaises fois ?
Notes
- Des années 50 à sa mort, Barthes a tenu un monumental ficher, conservé à la BnF. Le Grand Fichier, qui correspond aux années 70, mêle fiches de travail et journal personnel. Les références sont données en abréviation après la citation : GF, suivi du numéro de la fiche. ↑
- Les références aux œuvres publiées de Barthes sont données dans l’édition des Œuvres complètes en cinq tomes, procurée au Seuil par Éric Marty en 2002 (abréviation : OC suivi de la tomaison en chiffre romain et de la pagination en chiffre arabe). « Incidents » sera abrégé en I et « Soirées de Paris » en SP. ↑
- Sur la figure Moussu, définie par Barthes, voir Prétexte : Roland Barthes, colloque de Cerisy, [UGE 1978], Paris, Christian Bourgois, 2003, p. 460. ↑
- La prostitution libère de l’amour : « 18 août 79. Échec, vide. J’imagine, pour consacrer la rupture et en quelque sorte m’en laver, d’aller chez les garçons (comme on dit : chez les filles). Prostitution = peut-être un acte lustral. » (GF, 606) ↑
- Une fiche de 1975 établit un lien très clair entre la séduction intellectuelle et la séduction au sens le plus large. Barthes qui voyage en Italie avec des amis relate sa rencontre avec un jeune admirateur : « 2. IX. 75. Je me rappelle l’incident à Venise (RH ironisant sur ce jeune homme qui m’avait reconnu et dit en être commotionné) : eux, les jeunes (les plus jeunes), ils vivent tous dans une drague sans barrière ; mais l’âge (non ce n’est pas une coquetterie, un protestème) forclôt la drague classique ; il ne reste à l’homme vieux (ou approchant) que la drague des gigolos (heureusement elle a son charme, sa simplicité) ; et pour quelqu’un qui peut être reconnu dans un lieu public parce qu’il a écrit, cela, c’est la seule drague qui lui reste (elle ne va, en général, pas bien loin) ; comment – quels que soient les petits ridicules de ce genre de rencontres, – n’en serait-il pas ému ? » (GF, 131) ↑
- La relation au gigolo n’est pas toujours réussie : « 18 sept 79. Les gigolos, (seuls) charitables au vieux… » (GF, 727) ; « 5 oct 79. Je rate même les gigolos. » (GF, 760). ↑
- Fiche tirée du « Fichier vert », constitué principalement par Barthes quand il écrit Roland Barthes par Roland Barthes (1975). ↑
- « 1. 05. 78. Hier soir, au Flore, dragué par un gig allemand (plus très jeune) : genre bien habillé, mains assez fines, blazer, parlant très bien le français (je n’aime pas l’expression de son visage : ce qque chose de faux et de dur que j’attache mythiquement au peuple allemand). Je n’en ai pas vraiment envie mais, comme toujours, ne peux m’empêcher d’être « électrisé », « sensibilisé » par la situation : qqu’un me « désire » ». (GF, 124) ↑
- « 25 IX 75 sept.-22. Seules m’attiraient vraiment, par éclairs très fugitifs, une certaine courbure de l’entre-deux yeux – et ses mains, très nette, et sa coupe « garçon » ». (GF, 129) ↑
- Barthes effectue plusieurs séjours touristiques au Maroc à la fin des années 70, où il rédige un ensemble de fiches assez proches des « Incidents ». ↑
- Le premier fragment donne le ton : « Le barman, à une gare, est descendu cueillir une fleur de géranium rouge et l’a mise dans un verre d’eau, entre la machine à café et le débarras assez crasseux où il laisse traîner tasses et serviettes sales. » (I, OCV, 955) ↑
- « 28 avril 78. Palace : vu (et parlé avec) le gigolo, pas jeune mais beau, dont on m’avait dit « qu’il faisait bien l‘amour » : force impressive, mémorable de ce mot (mais qu’est-ce que ça veut dire ? » (GF, 210) ↑
- « Gigolos : on dirait que par logique, pour compenser la « bassesse » de leur situation, ils ne cessent de surévaluer leurs dons, leur intelligence, leur loyauté, leur sentimentalité etc. » (GF, fiches à part, 4, février 1980) ↑
- Barthes ne propose-t-il pas de substituer le mot « sexe » au mot « cœur » dans toute la littérature romantique ? Voir la figure « Le cœur », Fragments d’un discours amoureux (OCV, 83). ↑
- « 2 août 78. Bien insister sur la différence entre le corps-désir et le corps-appel (le désir plus qque chose) » (GF, 338, extrait) ↑
- Renaud Camus, Tricks, Paris, POL, 1979. ↑
- À un « corps-désir » heureux peut succéder « un corps-désir » malheureux. Il suffit de relire la visite dans le cinéma porno de la rue du Dragon pour s’en convaincre : « je ressors et vais voir le nouveau film porno du Dragon : comme toujours – et peut-être encore plus –, lamentable ; je n’ose guère draguer mon voisin, pourtant possible sans doute (peur idiote d’être refusé). Descente à la chambre noire ; je regrette toujours ensuite cet épisode sordide où je fais chaque fois l’épreuve de mon délaissement. » (SP, OCV, 989) ↑
- Éric Mary décrit les gigolos comme des spectres et des épaves dans sa remontée de la rue de Rennes en compagnie de Barthes : « j’étais frappé par leur pâleur, les cernes sous leurs yeux, la bouche gonflée », Roland Barthes ou le métier d’écrire, Paris, Seuil, 2006, p. 41-42 ↑
- Voir La Préparation du roman, Paris, Le Seuil, 2003, « Point », 2019, p. 93. ↑
- « 27 Août 79. VN Les guides (Virgile). Il faut inverser : le Maestro ne me guide pas dans son champ, mais plutôt dans un champ différent de sa spécialité : par ex le gigolo —> pas la Drague » (GF, 655) ↑
- « Le Cercle de mon possible » = la litt. », note Barthes dans les esquisses de Vita nova (OCV, 1018). Il se réfère librement à l’opposition qu’établit Heidegger entre le « possible », auquel est soumis chaque élément de la nature et l’« impossible », c’est-à-dire le nouveau qu’instaure la technique (voir Essais et conférences, traduction d’André Préau, préface de Jean Baufret, Paris, 1958, Gallimard [Paris, 1988, Gallimard, coll. « Tel », p. 113). Il existe plusieurs usages du « possible » pour Barthes, tantôt positif, tantôt négatif. La rédaction du roman lui permet de sortir de la répétition que représente l’écriture universitaire (le « possible » comme habitude). Inversement, la littérature est décrite comme le « possible », c’est-à-dire une pratique à laquelle il aspire. Dans ce « possible » que représente la littérature et qui permet d’échapper au « possible » de l’écriture universitaire, le gigolo apporte la force dépaysante de son « impossible. ». ↑
- D’une certaine manière, l’ouverture de Barthes s’inscrit dans une tradition ancienne : condamnée à une certaine clandestinité, l’homosexualité a souvent favorisé une mixité sociale, que l’on trouve également chez Proust ou Cocteau. ↑