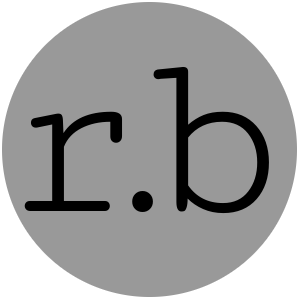« F.B » est le titre d’un essai de Barthes au statut particulier, daté de 1964 comme les Essais critiques, mais publié vingt ans plus tard, de façon posthume, à l’initiative de François Wahl dans Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. Le texte occupe neuf pages dans l’édition des Œuvres complètes établie par Éric Marty[1]. Il est enveloppé d’un anonymat auquel concourent plusieurs éléments. Il y a d’abord les deux lettres du titre, « F.B. », reprises dès l’incipit (« les textes de F.B. ») comme les initiales d’un auteur qui n’est jamais désigné autrement dans le texte. Il faut faire appel à un savoir externe – celui fourni par Tiphaine Samoyault dans sa biographie de Barthes en 2015 – pour identifier « F.B. » comme François Braunschweig, rencontré par Barthes en novembre 1963, de trente ans son cadet, avec qui une relation amoureuse partagée et socialisée existe pendant deux ans, avant de se prolonger ensuite amicalement[2]. François Braunschweig est le dédicataire des Essais critiques, en décembre 1964. La périphrase « les textes de F.B. » est répétée tout au long de l’essai qui se donne comme une étude sur eux mais s’abstient d’indiquer leur titre – au point de laisser supposer qu’ils n’en ont pas – ou de les citer, ne les évoquant que de façon indirecte. La publication posthume, en 1984 dans Le Bruissement de la langue, est introduite par une « [Note de l’éditeur.] », lequel a signé « F.W. » en tête du volume et qu’Éric Marty, dans son édition, identifie de façon explicite comme François Wahl. La première phrase de cette note fait savoir que : « Inédit, ce texte fut écrit en marge de fragments d’un jeune écrivain, qui ne semble pas avoir poursuivi dans cette voie, celle de la littérature par la suite, et n’a rien publié[3]. » On ne saurait établir un climat plus épais d’anonymat. Celui-ci est augmenté encore, s’il était besoin, par le fait que les seuls noms propres à trouver place dans l’article sont ceux d’auteurs canoniques (Aristote, Pascal, Vico, Chateaubriand, Stendhal, Poe, Valéry) mentionnés pour inscrire un fond culturel sans lien direct avec Barthes ou avec « F.B. ». Le nom de Barthes est, en somme, le seul avoué… à la réserve près que cet aveu n’est pas de Barthes puisqu’il n’a pas publié ce texte et ne s’en est donc pas lui-même déclaré l’auteur. On ne peut que supposer un usage privé de cet écrit, et c’est dans ce cadre que les noms ont existé autour de lui : Barthes aura écrit ces pages à l’attention de François Braunschweig, en réponse à la lecture que celui-ci lui aura proposée de ses « textes ». Il est probable, cependant, que cet anonymat est fortuit : Barthes aura rédigé ce qu’il projetait comme la préface d’un recueil de nouvelles de François Braunschweig, le manuscrit aura été adressé aux Éditions du Seuil mais refusé par François Wahl, peu convaincu par « les textes de F.B. ». Telle est l’hypothèse que l’on peut faire. « F.B » illustrerait ainsi parfaitement le propos tenu sur Barthes par le protagoniste de Tricks de Renaud Camus :
il y a beaucoup de petits textes de lui qui se promènent comme ça dans la nature. Il a toute une théorie perverse de la faute professionnelle, qu’il m’a expliquée un jour : il aime l’idée de faire des préfaces, par exemple, à des livres qu’il n’aimerait pas, ou qu’il aimerait mais qui seraient indéfendables, d’écrire quelque chose sur eux par amitié, ou par amour. Une espèce de cadeau[4].
Les pages suivantes adopteront la ligne de lecture suggérée par ce propos : lire « F.B. » comme la préface écrite « par amour » d’un livre a priori « indéfendable ». Seule la préface finit par aboutir à la publication, en tant qu’essai et après long délai.
Essai critique publié de façon posthume sur un texte (« les textes de F.B. ») dont on ne dispose pas, « F.B. » impose un mode de lecture pour le moins problématique. Il relève de la manière des préfaces que Barthes a pu écrire, par exemple sur La Vie de Rancé de Chateaubriand ou sur Aziyadé de Loti, mais sans texte de référence pour l’accompagner, se donnant ainsi à lire comme la préface à un ouvrage absent, une préface orpheline. Cela seul – disposer de l’essai critique, mais pas du texte auquel il se consacre – suffit à enlever cet écrit à l’orbe critique pour le situer aux frontières de la fiction et à le rendre lisible comme une nouvelle conçue dans l’esprit de Borges. La « [Note de l’éditeur] » va dans ce sens : elle emploie une dizaine de lignes à présenter l’article en mettant l’accent sur Barthes plutôt que sur « F.B. », sur « Barthes écrivain » qui essaierait dans ces pages des « propositions aiguës sur un nouveau type de romanesque[5] ». Cette note met en place un dispositif à l’ancienne, romanesque précisément, celui de récits introduits par un premier narrateur anonyme qui explique comment le texte livré à l’attention du lecteur est venu à lui, et qui s’efface une fois cela dit pour laisser la parole au héros, second narrateur ou sujet lyrique, ici Barthes. Éprouvé jusqu’à l’usure par les romans du xviiie siècle (par exemple, Manon Lescaut ou Paul et Virginie), ce procédé est employé encore au xixe siècle pour introduire les plaintes monodiques de jeunes hommes : par Senancour dans Oberman, par Constant dans Adolphe, par Sainte-Beuve dans Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, par Fromentin dans Dominique, par Loti dans Aziyadé, par Gide dans Les Cahiers d’André Walter. Ces deux derniers exemples nous approchent de Barthes et de la question homosexuelle.
On se propose ici de lire « F.B. » des deux manières dont il se donne : d’une part, comme un article exigeant qui développe sur la littérature des « propositions aiguës », ce que fait toujours Barthes, même quand il traite de textes particuliers ; d’autre part, comme une nouvelle, bordée par le dispositif fictionnel que met en place l’anonymat. À la conjonction des deux s’observe une abolition de l’écart entre littérature et critique ou, pour le dire dans les termes baudelairiens souvent repris par Barthes, une réconciliation de cette « double postulation » dans la même aventure d’écriture. On ne convoquera donc pas d’érudition particulière dans cette lecture, sur le plan de la biographie par exemple, afin de rester fidèle à l’enseignement de Barthes qui écrit, précisément au début de « F.B. », que « l’érudition […] est le contraire de la lecture[6] ». Se passer d’érudition, au demeurant, relève ici à peine du choix tant « F.B. » a été peu commenté[7].
« F.B » sera envisagé successivement, dans la suite de cette étude, comme un essai critique et comme une fantaisie croisant fiction et réflexion. La question homosexuelle y sera rencontrée de différentes façons : en tant qu’elle est évoquée thématiquement, présente comme telle dans « les textes de F.B. » ; en tant qu’elle est exemplifiée par la démarche de Barthes, celle d’une critique amoureuse qui revendique le « désir » comme un maître-mot et désigne à travers lui un élément décisif, recherché dans la lecture en général et trouvé dans celle de ces textes ; en tant qu’elle apparaît en ligne de mire d’une réflexion en soi, discrètement formulée autour de l’enjeu du « particulier ».
« F.B. », essai critique
Commençons par caractériser la manière critique montrée par Barthes dans cet essai avant de reconstituer autant que faire se peut « les textes de F.B. » à partir de ce que leur critique en dit. Il importera ensuite d’évaluer les termes employés dans ce discours d’éloge.
Barthes manie, dans « F.B. », un mode de discours critique qui lui est habituel à la même époque et qu’on retrouve, par exemple, dans les Essais critiques. Ce discours est empreint d’une grande autorité, laquelle se marque dans la manière de poser les notions et les catégories. Le ton est parfois professoral : « La littérature a pour matière la catégorie générale du langage[8] » ; « L’ancienne rhétorique distinguait la disposition de l’élocution[9] » ; « Signum facere, telle pourrait être la devise de ces textes[10] ». Les arguments d’autorité, cependant, et heureusement, prennent plus volontiers la forme d’assertions superbes, courtes, énoncées au présent gnomique, selon un modèle fréquent chez Barthes : on peut penser au début de la mythologie sur le catch (« La vertu du catch, c’est d’être un spectacle excessif[11] ») ou au début de Sur Racine (« Il y a trois Méditerranées dans Racine : l’antique, la juive et la byzantine[12] »). Ainsi lit-on, dans la première page de « F.B. » : « Ce qui est accompli, ici, c’est l’écriture » ; « un fragment d’écriture est toujours une essence d’écriture » ; ou encore, « son écriture est un luxe sans perte, c’est-à-dire sans durée » [13]. Le soulignement accordé à ces derniers mots revient pour mettre en relief beaucoup d’autres mots et expressions, souvent en fin de phrase ou proposition de manière à produire un effet de scansion. Ainsi, et cet échantillon est loin d’être exhaustif : les textes de F.B. ont « le luxe tendre et somptueux d’une écriture absolument libre[14] » ; « du roman, ils ont la profonde amoralité[15] » ; « en eux règne le temps fondamental des littératures libres […] : l’indicatif[16] » ; ce ne sont pas « des fragments, mais des incidents, choses qui tombent, sans heurt[17] » ; à les lire, nous sommes « tendus vers quelque chose que nous devons comprendre[18] » ; « ce qui est écrit n’appelle pas autre chose[19] ».
Le texte est subdivisé en paragraphes portant des titres fournis par des notions abstraites : « Éclats de langage », « Incidents », « La description », « Sublimation », « Éros », etc. C’est une pratique que Barthes réserve habituellement à ses ouvrages longs, mais qu’on retrouve dans « Pierre Loti : Aziyadé », article de 1971 dont la forte parenté avec « F.B. » sera soulignée plus loin.
Observons que le critique, en outre, structure son propos autour d’une série d’oppositions fortement marquées, avec une vigueur qui rappelle celle mise autrefois à poser que, par exemple, « le catch n’est pas un sport, c’est un spectacle », ou encore que le catch n’a rien à voir avec la boxe[20]. Dans « F.B. », les « érotiques traditionnelles » sont ainsi opposées à « un érotisme nouveau » : elles sont lourdes et crispées, quand il est léger et profond[21]. La propension à produire des oppositions se retrouve dans l’insistance à dire tout ce que « les textes de F.B. » ne sont pas. Il s’agit certes d’approcher une définition de ce qu’ils sont, mais en montrant la difficulté à le faire et en faisant valoir leur part d’indicible :
le désir n’est pas ici l’attribut d’une création qui lui préexisterait, […] l’auteur ne découvre pas que le monde est désirable, il le détermine désirable ; […] l’auteur ne raconte pas ce qu’il voit, ce qu’il ressent, il ne déroule pas les précieuses épithètes qu’il a le bonheur de trouver, il n’agit pas en psychologue […] ; il ne fait pas les corps désirables, il fait le désir corporel […][22].
L’article fait sonner ces « pas » qui se propagent en échos. En ligne de fuite, et nous y reviendrons, le désir apparaît comme la notion qui promet de rendre vaines toutes les oppositions et de les surmonter comme autant d’obstacles dans une course de haies.
Signalons enfin, comme un autre trait de cette démarche critique, la volonté de produire des propositions générales sur la littérature, par déplacement et renouvellement des notions. Ces propositions portent sur le fragment et l’écriture fragmentaire (« un fragment d’écriture est toujours une essence d’écriture », « tout fragment est fini, du moment qu’il est écrit » ; « personne ne parvient à nier la grandeur des œuvres fragmentaires »[23]) ; sur la création (« l’artisanat n’est plus la condition nécessaire du style » chez un écrivain qui, comme F.B., « donne sa peine non à la matière verbale, mais à la décision d’écrire : tout se passe avant l’écriture[24] ») ; sur le rôle des descriptions dans les romans (« dans une description romanesque, si elle n’est pas trop mauvaise, l’histoire pénètre de loin tous les détails[25] ») ; sur le rapport entre littérature et langage (elle naît de lui et doit le détruire : « ce retournement presque impossible fait les textes de F.B.[26] »). Une sorte d’épiphanie critique est permise grâce aux textes de F.B., tant ils permettent de révéler de vérités à propos de la littérature. « Textes d’élocution » qui relèvent du « chant », ils conduisent à formuler l’existence, et donc la possibilité, de « cette écriture seconde, cette écriture mentale qui se forme et avance “entre les choses et les mots” », comme « une sorte de chant antérieur (comme on parle d’une vie antérieure)[27] ».
Cette démarche critique somptueuse, sur quoi porte-t-elle ? Tâchons maintenant de le préciser, c’est-à-dire, autant que faire se peut, de reconstituer « les textes de F.B. » à partir de « F.B. ». Rappelons qu’aucune citation n’est donnée, ce qui maintient ces textes à l’état de mirage : rien n’interdit de se demander s’ils ont jamais existé… Essayer cette reconstitution, c’est répondre à une invite implicite, lancée par François Wahl, plus que par Barthes, lorsqu’il décide de publier en 1984 « F.B. » sans les « textes de F.B. ». La dimension « ludique » de l’essai – affirmée plus qu’étayée par lui dans sa note d’ouverture – est en bonne partie construite par ce geste qui est de l’éditeur plus que l’auteur.
Ce qui est dit des textes de F.B., c’est en premier lieu leur forme : ils « ne sont ni des esquisses, ni des notations, ni des matériaux, ni des exercices ; ils ne font penser ni au carnet ni au journal : ce sont des éclats de langage[28] ». Après une série de refus, cette dernière expression est donc la qualification acceptée pour eux, de même que « fragments », « œuvre fragmentaire », « œuvre brisée », ou encore, avec plus d’insistance car il s’agit d’une notion à définir dans cette acception de bel avenir dans la pensée de Barthes, « incidents[29] ». On apprend aussi que ces textes sont marqués d’une « incertitude de la conscience narrative, qui ne dit jamais franchement il ou je[30] » ; qu’« en eux règne […] l’indicatif[31] » ; que l’auteur n’y « déroule pas les précieuses épithètes[32] ». La forme de ces textes est « paradoxale » car elle surmonte les contraires : elle est fragmentaire et brisée[33], mais « les textes de F.B. […] ne sont pas “brefs”, retournés et renversés sur eux-mêmes[34] » car ils présentent, « (paradoxe de l’écriture) une essence de continuité[35] ». Fragmentaire, elle n’est jamais aphoristique ni gnomique, ce qui surprend pour des textes courts[36]. Ces textes ne sont pas des romans, et pourtant c’en sont : « on les “dévore” » comme des « éclats de roman »[37] ; « chaque texte est un simulacre de roman » et « toute cette familiarité du roman se met à bouger ailleurs[38] ». Le mérite de la notion d’incident est de résorber les contraires par la magie d’une métaphore : ces textes ont le « continu discontinu du flocon de neige[39] ».
Le contenu des « textes de F.B. », quant à lui, n’est dévoilé que progressivement. Les observations d’ensemble sont rares : « il y a des objets, des personnages, une situation, un narrateur, bref une instance réaliste[40] ». En revanche, « on ne trouvera dans ces textes rien qui ait un rapport avec une personne formée, c’est-à-dire avec une histoire, une vie, un caractère ; mais on n’y trouvera non plus aucun miroir d’humanité[41]. » « C’est donc le temps du jugement, le temps psychologique, qui est éludé ici[42] ». Un seul cadre est récurrent, qu’on peut tenir pour cher à l’écriture de F.B. : « la mer dont elle parle souvent[43] ». Pour le reste, des exemples spécifiques sont pris : « dans l’un de ses plus beaux textes, F.B. décrit un jeune garçon qui marche dans les rues de Rome ; on ne sait, on ne saura jamais d’où vient, où va, à quoi sert ce jeune garçon, il n’est rattaché à aucune logique narrative », mais « le garçon est décrit »[44]. Ou encore : « un personnage arrive dans une gare ; la gare est décrite, puis tout à coup elle est le lieu, ou mieux encore le triomphe du désir »[45]. Ou enfin :
Un autre texte commence à la façon d’un roman d’aventures : un homme pénètre dans un hangar d’avions et y assomme le pilote qui s’y est endormi ; très vite, une description “trop” amoureuse du jeune pilote (tout est dans ce “trop”) dépayse ce départ classique ; le fantasme “prend”, et, sans quitter le cadre du récit traditionnel, la scène d’évasion change d’être et se retrouve scène érotique[46].
C’est à cette occasion que la distinction est faite entre « érotique » et érotisme », et qu’il est établi que « les textes de F.B. ne sont donc pas dans la tradition érotique (au sens courant du terme) », qu’ils ne proposent pas « un gestuaire érotique ». Ces différents exemples ne montrent que des personnages masculins, jeunes et solitaires. L’on se dit que F. B. a pu voir, et rêver sur, certains films sortis peu avant qu’il n’écrive : par exemple, L’Évadé du camp 1 (The One That Got Away, 1957) de Roy Ward Baker, pour l’histoire du pilote assommé dans un hangar d’avions, et surtout Accattone (1961) où Pasolini fixe, après l’avoir déjà fait par écrit dans Ragazzi di vita (1955, traduit en français en 1958[47]), la figure du jeune homme marchant dans les rues de Rome. On se plaît à penser que F. B. aura porté sur cette œuvre (roman ou film) le même œil que le critique Gianfranco Contini sur Ragazzi di vita : « ce n’est pas un roman ? En effet, c’est une imperturbable déclaration d’amour, procédant par fragments narratifs, à l’intérieur desquels on trouve d’ailleurs des séquences qui s’inscrivent dans la tradition narrative la plus autorisée, autant dire celle du xixe siècle[48]. »
Qu’elle porte sur la forme ou sur le fond, la description des « textes de F.B. » est assortie d’un discours d’éloge appuyé, et même hyperbolique : c’est dans cet excès qu’il est possible de trouver à « F.B. », avec François Wahl, « un ton et une adresse clairement ludiques[49] ». Les premiers mots qui viennent et se bousculent, pour parler des « textes de F.B. », sont : « accomplissement », « écriture », « essence d’écriture »[50]. Les derniers mots, quand l’article se termine, posent des constats sans réplique : « la fonction même de cette écriture est de dire ce que nous ne pourrons jamais dire d’elle » ; « ces phrases, ce tout de phrases flotte dans la tête comme une mémoire future, prédéterminant la parole de la dernière modernité »[51]. Entre les deux, il aura été établi que « les textes de F.B. » marquent un tournant dans l’histoire de la littérature. Ils proclament l’avènement du désir et, à ce titre, s’imposent à jamais comme un jalon : avant leur apparition, « la littérature servait à comprendre le désir, au nom d’un ensemble plus vaste ; toute littérature tendait ainsi à la morale, c’est-à-dire à une économie du bien et du mal, de l’obscur et du lumineux : Éros raconté veut dire autre chose qu’Éros[52] ». Arrivent « les brefs romans simulés de F.B. » : avec eux, « tout s’arrête au désir, tout le glorifie […] ; le roman s’efface comme un rideau qui s’ouvre afin de montrer le désir dans sa “gloire” »[53]. Le dispositif du rideau recouvrant l’Éros, susceptible d’être écarté, rappelle celui qui a longtemps dissimulé L’Origine du monde de Courbet chez ses différents propriétaires, dont Lacan. Ici, c’est le pendant masculin de « l’origine du monde » qui est dévoilé.
Le discours produit à l’occasion des « textes de F.B. » énonce un absolu de la littérature, confondu avec l’idée d’écriture. Un avant et un après sont distingués, en des termes qui annoncent ceux par lesquels, quelques années plus tard au début de S/Z, le « scriptible » sera promu en vis-à-vis du « lisible ». « Le texte scriptible », sera-t-il dit, « est un présent perpétuel », « c’est nous en train d’écrire » en dehors de tout « système »[54]. Le discours d’éloge hyperbolique suscité par les « textes de F.B. » est tout entier indexé sur le mot de désir, sans cesse répété, et auquel il importe maintenant de faire rendre sens un peu plus.
« Désir raconté » et fantaisie homosexuelle
« Fantaisie » est pris ici au sens musical et romantique, schumannien, pour désigner une pièce de forme libre, convoquant des airs déjà connus pour construire librement autour d’eux. Ce mot permet de redire « essai » d’une autre manière, en accentuant la part de liberté et de fiction qui peut sourdre de la réflexion. Trois aspects de « F.B. » méritent de retenir dans cette perspective : ce qui est dit du désir ; ce qui est dit de l’homosexualité ; ce qui est dit du particulier dans son rapport avec général.
Le désir est partout salué dans « les textes de F.B », au point que ceux-ci finissent par se confondre avec lui et par devenir leur autre nom. « Certes le désir rôde dans toute littérature », mais il cesse avec F.B. de servir une histoire racontée selon un ordre logique et causal, comme « élément d’une algèbre morale, psychologique, théologique[55] ». Désormais, chez F.B., c’est lui directement qui est « raconté[56] », il « devient ratio, logos[57] », il est partout et tout puissant, « il n’y a rien ici qui ne relève de lui[58] » : « la gêne, la tristesse, la lucidité, le sommeil, la ville, la mer, deviennent les noms du désir[59] ». Les phrases exaltant le désir, autrement dit « les textes de F.B. », s’enchaînent et s’additionnent sous la plume de Barthes :
une littérature du désir est la chose la plus difficile[60] ;
F.B. substitue ainsi à la grammaire de l’anecdote une nouvelle intelligibilité : celle du désir. Le désir lui-même devient histoire et intelligence[61] ;
le désir n’est pas ici l’attribut d’une création qui lui préexisterait, il est tout de suite une substance ; autrement dit, encore, l’auteur ne découvre pas (sous l’action d’une subjectivité privilégiée) que le monde est désirable, il le détermine désirable[62] ;
dans les textes de F.B., il n’y a jamais aucun objet in-désirable. L’auteur crée ainsi une vaste métonymie du désir : écriture contagieuse qui reverse sur son lecteur le désir même dont elle a formé les choses[63].
On retiendra de ces citations qu’au moment même où, en 1964, Barthes engage sa réflexion dans la voie du structuralisme, il rêve, dans un texte à usage privé, d’une littérature où « la grammaire de l’anecdote » serait supplantée par le désir, d’une littérature qui s’imposerait comme une « vaste métonymie du désir ». Le « plaisir du texte » est déjà là. Logique et moralité, qui en sont les antonymes, voient leur règne s’achèver au moment où F.B. prend la plume : avec lui, « la narration est comme une rampe de vol ; mais ce qui se passe au bout n’est plus de l’ordre de la successibilité des événements, autrement dit du suspense, mais de l’ordre des essences[64] ». Cet énoncé, comme beaucoup d’autres dans cet essai de Barthes, fait peut-être entendre un sous-texte érotique, et ludique : l’exaltation désirante devant « les textes de F.B. » a, métonymie aidant, transformé ceux-ci en F.B. lui-même.
Convoqué sans relâche, le désir finit par être plus précisément et résolument désigné : « l’amour des garçons », « le désir des garçons »[65]. Il y a lieu de dire, alors, que l’homosexualité est posée comme la question homosexuelle : elle a en effet pour rôle d’interroger l’ordre du monde et, partant, la littérature. À l’écart de la logique et de la moralité, qui sont « peut-être la même chose[66] », elle fait advenir une écriture dont les « descriptions sont des subversions » et dont le sens est « autre ; une altérité pure, qui est la définition suffisante de l’étrange[67] ». Éros est « le seul dieu de l’œuvre », c’est « un principe souverain d’écriture[68] ». Osons le dire, puisque c’est la leçon que Barthes retient de la « vaste métonymie » qu’il appelle « les textes de F.B. » : désir, amour des garçons et écriture sont à peu près synonymes ; « l’amour des garçons forme un cercle pur en dehors duquel il n’y a plus rien[69] ». On entend bien sonner l’hypallage : il est question d’amour pur.
Après avoir nommé « l’amour des garçons » dans le paragraphe intitulé « Éros », la réflexion – qu’on pourrait aussi bien dire la dérive désirante –, se poursuit dans le suivant, « Général, individuel, particulier », en trouvant un nouveau terme à exalter, le particulier. On y lit que « F.B. ne prend du langage, catégorie du général, que l’extrême bord particulier » car il parvient à « trouver un particulier ultime en dépit de l’instrument général et moral qui lui est donné[70] », à savoir le langage. Ce dernier « étant général (et donc moral), la littérature est condamnée à l’universel ; tout ce qui arrive en littérature est originellement culturel : les pulsions n’y naissent qu’habillées d’un langage antérieur[71] ». Or « F.B. forme une écriture particulière, sans tradition et sans provocation ; ni drapée, ni cependant “naturelle”, cette écriture élude tous les modèles sans revêtir à aucun moment la lourde signalétique de l’originalité. De là peut-être son amitié nue, coupée de tout humanisme[72] ». « Amitié » et « écriture particulière » : le rapprochement de ces termes fait entendre « amitiés particulières », périphrase d’époque – depuis le succès du roman de Roger Peyrefitte de 1943 – pour dire ce que l’on appelait aussi l’« amour des garçons ». On peut faire l’hypothèse que, dans ces pages, « le particulier » est l’autre nom de l’homosexualité. Cela entre en résonance avec ce que Barthes note dans une fiche en 1979 : il refuse de faire de l’homosexualité « un objet avant tout social », « un “problème de société” (objet d’émissions TV, de films, de livres sur etc.) » et ajoute qu’il ne peut accepter d’en parler « qu’à titre non seulement personnel (sans généralisation, sans méta-H), mais aussi individuel : le pur individu que je suis, la marge absolue, irréductible à toute “science” ou para-science (ces formes d’“art” qui se veulent des sciences, des raisons, des messages de généralité)[73]. » En vis-à-vis de ce particulier, se tiennent le général, mais aussi le logique et le causal, constitués comme autant d’atours de l’hétérosexualité. Toutes les oppositions déclarées à travers lesquelles progresse le propos, dans « F.B. », semblent pouvoir être ramenées in fine à la dichotomie entre « amour des garçons » et « autres amours ». Il est frappant que Barthes écrive cela – même si finalement sans l’adresser au public – dans la période de sa carrière où il se montre le plus attaché à identifier, dans la littérature, des schèmes constants, de la logique, un régime ordonné. C’est la littérature d’avant qui est passible d’une telle approche, ou encore – si l’on veut bien se permettre une distinction depuis longtemps usée –, la littérature telle qu’elle est, figée. Or, « les textes de F.B. » sont la littérature telle qu’elle devrait être, ce que Barthes appelle l’écriture : il en parle comme à soi-même et à F.B.
Ce discours alternatif n’attendra cependant pas 1984 pour être mis au jour : la leçon de « F.B. » affleure régulièrement ensuite dans l’œuvre publiée de Barthes, elle y fait même entendre de puissants échos : ainsi dans S/Z, en 1970, avec la distinction entre le « lisible » et le « scriptible » déjà rappelée. La préface de Tricks de Renaud Camus, en 1979, reprend ce qui avait été dit quinze ans plus tôt pour « les textes de F.B. », n’était que le mot « désir » y cède la place à « homosexualité » : « les Tricks de Renaud Camus sont simples. Cela veut dire qu’ils parlent l’homosexualité, mais ne parlent jamais d’elle », ne laissant pas « venir au langage les Noms, source de disputes, d’arrogances et de morales[74] ». On y entend l’écho d’un passage très beau de « F.B », où la même idée est honorée avec le terme de « naturel » plutôt que de « simple » : « le désir des garçons n’est jamais, ici, culturalisé, il a le naturel de ce qui est sans cause et sans effet, il est à la fois sans liberté et sans fatalité. Ce naturel a de grandes conséquences sur l’écriture (à moins plutôt qu’il n’en sorte) : ce qui est écrit n’appelle pas autre chose[75] ».
Il revient à un autre texte de présenter l’exemple le plus frappant du bénéfice ultérieur, dans la pensée de Barthes, de ce qui a été mis au point à l’occasion de « F.B. ». Il s’agit de la préface rédigée en 1971 pour Aziyadé de Pierre Loti, reprise l’année suivante dans les Nouveaux essais critiques. Les échos qui relient les deux textes sont si puissants qu’ils autorisent à tenir « F.B. » comme un avant-texte de « Pierre Loti : Aziyadé ». Barthes relève que passe, entre deux personnages masculins du roman de Loti, « quelque chose d’inouï et de ténébreux[76] » : cette périphrase est citée parmi d’autres expressions pour dire ce qui arrive au héros dans ses errances nocturnes à Salonique (d’« étranges choses », « quelque aventure imprudente », le spectacle d’« une prostitution étrange »[77]). Avant d’être repris dans Aziyadé, puis par Barthes, ces mots et expressions figuraient, avec d’autres plus explicites – « baiser », « étreinte », « péché de Sodome » – dans le journal personnel de Loti, repris par l’écrivain comme matière première de son roman. L’édition d’Aziyadé établie par Bruno Vercier en 1989 y a donné accès sous la forme d’extraits inédits livrés en annexe[78] : Barthes ne connaissait pas ces pages, ainsi que l’assure Bruno Vercier qui était un de ses amis[79]. Dans son journal tenu à Salonique en 1876, Loti avait pris note de l’échange suivant avec le prénommé Daniel, qui deviendra Samuel dans le roman :
Il était toujours étendu, immobile, mais son regard avait une animation étrange, et son corps tremblait :
– Che volete, dit-il d’une voix sombre et troublée, che volete mi ? (Que voulez-vous de moi ?)…
Et puis il me prit dans ses bras, et en me serrant sur sa poitrine il appuya ardemment ses lèvres sur les miennes… Le but était atteint cette fois, et même terriblement dépassé ; j’aurais pu prévoir cette solution, je fus navré de l’avoir si étourdiment amenée. Et je me dégageai de son étreinte sans colère : “Non, lui dis-je, ce n’est pas là ce que je veux de vous, mon pauvre Daniel, vous vous êtes trompé ; dans mon pays ce genre d’amour est réprouvé et interdit. Ne recommencez-plus […]. Alors il se couvrit la figure de son bras et resta immobile et tremblant[80].
Ce développement est éludé dans Aziyadé, remplacé par la superbe périphrase déjà citée :
Sa main tremblait dans la mienne et la serrait plus qu’il n’eût été nécessaire.
– Che volete, dit-il d’une voix sombre et troublée, che volete mi (Que voulez-vous de moi ?)…
Quelque chose d’inouï et de ténébreux avait un moment passé dans la tête du pauvre Samuel ; – dans le vieil Orient tout est possible ! – et puis il s’était couvert la figure de ses bras, et restait là, terrifié de lui-même, immobile et tremblant[81]…
La périphrase, toujours soulignée par Barthes quand il la cite, devient pour lui la clé d’un mystère. Elle relie homosexualité et littérature comme les deux faces d’un même enjeu : la tension vers l’indicible, vers l’innommable. « Aziyadé est le nom nécessaire de l’Interdit[82] », écrit Barthes. C’est à ce titre que le « roman démodé » peut être sauvé, réhabilité par une lecture qui permet de « remonter à l’idée d’un texte : fragment du langage infini qui ne raconte rien[83] ».
D’autres éléments encouragent l’hypothèse de lire « F.B. » comme un avant-texte de la préface d’Aziyadé. La notion d’incident est ainsi mise en valeur dans des développements présents dans les deux textes, et définie par le recours à la même image météorologique de ce qui tombe sous l’effet des saisons (les flocons de neige d’un côté, les feuilles de l’autre)[84]. Convoquée pour restituer la magie de F.B. et de ses protagonistes solitaires, la formule du « puer senilis » est reprise à propos du personnage « Loti » dans Aziyadé :
La grâce et la sagesse : c’est cette impossibilité que les Anciens donnaient pour la perfection, la représentant dans le mythe si beau du puer senilis, de l’adolescent maître de tous les âges[85].
Le lieutenant Loti […] devient l’être paradoxal qui ne peut être classé : […] le sujet contradictoire, l’homme jeune et très savant, que l’ancienne rhétorique exaltait – véritable impossibilité de la nature – sous le nom de puer senilis : ayant les caractères de tous les âges, hors des temps parce que les ayant tous à la fois[86].
D’un texte à l’autre, les mêmes mots sont repris avec plus ample développement. Ils le seront plus encore, et approfondis davantage, dans « Le discours amoureux », cours au Collège de France de novembre 1978 dont les Œuvres complètes restituent, sous le titre « Puer senilis, senex puerilis », trois pages qui font entendre une véritable insurrection contre l’âge : « pas de plus grande subversion que de vivre ou de penser contre la division des âges[87] ».
« La dérive du lieutenant Loti », écrit Barthes, « est donc la figure exacte de son désir », et « le désir est une force en dérive »[88]. La boucle que forment ces propositions est comme « un cercle pur en dehors duquel il n’y a plus rien », ainsi qu’il est dit dans « F.B » à propos de « l’amour des garçons[89] ». Le commentaire amoureux des « textes de F.B. » a la force d’une révélation. Avec « F.B. », Barthes pose par devers lui, dans un texte qu’il ne publie pas, la question homosexuelle. À qui la pose-t-il, ou à quoi ? À la littérature et à lui-même, pour trouver et dire l’indicible qui relie les deux. La réponse qu’il donne constitue la leçon de « F.B. » et elle est, dans son œuvre, de grande portée et de longue durée. Cette leçon peut s’exprimer sous la forme d’une équation : homosexualité = désir = littérature. Ou, pour le dire avec d’autres mots : amour des garçons = désir = écriture. En posant la question homosexuelle, Barthes a renouvelé son discours sur la littérature en la comprenant autrement : il découvre qu’elle devient « écriture » quand elle implique son propre désir.
Notes
- Roland Barthes, « F.B. », Œuvres complètes, éd. Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, 5 vol., vol. II (Livres, textes, entretiens. 1962-1967), vol. II, p. 601-609 [Le Bruissement de la langue, 1984]. Référence désormais abrégée en OC II [« F.B. », 1964]. ↑
- Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Seuil, « Fiction & Cie. Biographie », 2015, p. 384-385. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 601. ↑
- Renaud Camus, Tricks, Paris, Éditions Mazarine, 1979, p. 313. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 601. ↑
- Idem. ↑
- Outre les rapides commentaires déjà évoqués (de François Wahl dans l’édition du Bruissement de la langue en 1984 et de Tiphaine Samoyault dans la biographie de Barthes en 2015), on peut signaler ceux, rapides également, de Philippe Vercaemer dans « Roland Barthes : le roman du fragment » (dans « Écritures discontinues », dir. Yves Vadé, Modernités, n° 4, 1993, p. 159-193) et de Michael Sheringham dans un article qui sera mentionné plus loin. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 607. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Ibid., p. 609. ↑
- OC I [« Le monde où l’on catche », Mythologies, 1957], p. 679. ↑
- OC II [Sur Racine, 1963], p. 59. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 601. ↑
- Ibid., p. 602. ↑
- Idem. ↑
- Ibid., p. 602-603. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Idem. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- OC I [« Le monde où l’on catche », Mythologies, 1957], p. 679. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 606. ↑
- Ibid., p. 607-608. ↑
- Ibid., p. 601. ↑
- Ibid., p. 602. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 607. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Ibid., p. 601. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 602. ↑
- Ibid., p. 602-603. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Ibid., p. 601. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 602. ↑
- Idem. ↑
- Idem. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Ibid., p. 607. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Ibid., p. 602. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Idem. ↑
- Pier Paolo Pasolini, Les Ragazzi [Ragazzi di vita, 1955], trad. de l’italien par Claude Henry, Paris Buchet-Chastel, 1958. ↑
- Nous traduisons. Le propos est oral, tenu à la radio le 8 août 1955 : « Non è un romanzo ? Difatti è un’imperterrita dichiarazione d’amore, procedente per “frammenti narrativi”: all’interno dei quali, peraltro, sono sequenze intonatissime alla più autorevole tradizione narrativa, quanto dire l’ottocentesca. » Cité par Nico Naldini dans la chronologie qu’il établit dans Romanzi e Racconti. 1946-1961, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, Milano, Mondadori, « I Meridiani », 1998, vol. I, p. clxxxi. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 601. ↑
- Idem. ↑
- Ibid., p. 609. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- Idem. ↑
- OC III [S/Z, 1970], p. 122-123. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 605. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- Ibid., p. 603. ↑
- Ibid., p. 607-608. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Ibid., p. 604-605. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- Ibid., p. 604. ↑
- Idem. ↑
- Ibid., p. 606. ↑
- Ibid., p. 605. ↑
- Ibid., p. 607. ↑
- Ibid., p. 606. ↑
- Ibid., p. 608. ↑
- Roland Barthes, « Grand Fichier », BNF, NAF 28630, fiche 898, 19 novembre 1979, inédite, citée par Mathieu Messager dans le présent dossier et aimablement transmise par lui. ↑
- OC V [« Préface à Tricks de Renaud Camus », 1979], p. 685. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 605. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 107, p. 111. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 113. ↑
- Pierre Loti, Aziyadé, éd. Bruno Vercier, GF-Flammarion, 1989, p. 248-251. Le journal de Loti a été publié depuis en plusieurs volumes. L’année 1876 est incluse dans le premier volume : Pierre Loti, Journal I (1868-1878), éd. Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, Paris, Les Indes savantes, 2006. ↑
- Bruno Vercier explique oralement, lors du colloque Roland Barthes & la question homosexuelle en octobre 2022, avoir exhumé ce journal dans les années 1980 seulement, et n’avoir donc pas eu l’occasion d’en parler à Barthes. ↑
- Pierre Loti, Aziyadé, éd. Bruno Vercier, GF-Flammarion, 1989, p. 249. ↑
- Pierre Loti, Aziyadé, op. cit., p. 52-53. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 112. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 107. ↑
- La chose a déjà été observée par Michael Sheringham dans son article « “Ce qui tombe comme une feuille sur le tapis de la vie” : Barthes et le quotidien » (dans Barthes, au lieu du roman, dir. Alexandre Gefen et Marielle Macé, Paris, Desjonquères/Nota Bene, 2002, p. 135-158, p. 156). Michael Sheringham a proposé une version remaniée de cet article comme chapitre 4 de son ouvrage Traversées du quotidien. Des surréalistes aux postmodernes (Paris, PUF, « Lignes d’art », 2013). ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 606. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 117. ↑
- OC V [« Puer senilis, senex puerilis », 1978], p. 481-483, p. 481. ↑
- OC IV [« Pierre Loti : Aziyadé », Nouveaux essais critiques, 1972], p. 118. ↑
- OC II [« F.B. », 1964], p. 605. ↑