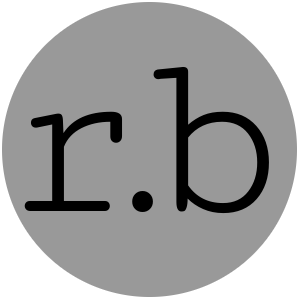Frustré de ne pouvoir intégrer un conservatoire de musique, Lucien Clergue délaissa son violon et trouva dans un petit appareil photographique (en réalité un jouet offert par sa mère en cadeau de Noël) un nouveau moyen d’interprétation et de partage de sa lecture du monde. Une décision qui allait lui ouvrir les portes de l’Académie des Beaux-Arts non sans avoir œuvré toute sa vie au rayonnement de la photographie en France. Cet engagement lui vaudra notamment de devoir confronter son savoir à l’analyse avisée de Roland Barthes.
La mère en commun
Née dans une famille éloignée du monde de l’art, la maman de Lucien Clergue, Jeanne Grangeon, n’en a pas moins souhaité un destin d’artiste à son enfant chéri, seul moyen à son idée, de lui permettre de sortir de la misère. Un romantisme sans doute lié à ses lectures, à sa fréquentation régulière des salles de cinéma, et aux émissions radiophoniques qu’elle suivait assidument. Les seuls objets d’art présents dans la maison familiale auxquels Lucien Clergue faisait référence, étaient une statuette d’inspiration religieuse et un grand tableau représentant une Vierge à l’enfant issus d’un héritage, en provenance du Château de Montauban à Fontvieille. Rien donc qui puisse laisser présager que son fils deviendrait l’un des acteurs majeurs de l’expression artistique de la deuxième moitié du XXème siècle. La vision idyllique du violoniste en ce qu’il représentait, pour la mère, l’absolu romantique amena Jeanne Grangeon à faire donner une éducation musicale à son fils. Lucien Clergue devint un bon interprète, s’essayant à quelques improvisations mais ne put accéder au conservatoire faute d’argent. C’est dans l’écriture qu’il commit ses premiers actes de créateur. La lecture des poètes et écrivains français lui donna des éléments pour traduire ses premières émotions dans les vers de nombreux poèmes lesquels reflétaient déjà son mal-être d’adolescent. Ils exprimaient souvent des souffrances parfois en lien avec une mère malade dont la possessivité et l’assistance permanente qu’il devait lui apporter étaient terriblement pesantes. Mais le dernier souvenir que Lucien Clergue garda de sa maman fût lié à la musique. Alors que cette dernière agonisait dans une chambre d’hôpital, il dut partir à Marseille pour un enregistrement radiophonique. Il demanda à l’infirmière qu’un petit récepteur radio soit placé à côté d’elle à l’heure de la diffusion. Lorsqu’il revint, le soir sa maman était dans le coma mais l’infirmière lui assura qu’elle l’avait entendu jouer. Piètre réconfort et semblant de délivrance.
Lucien Clergue garda un très fort attachement à sa maman dont une petite photographie était posée sur une des étagères de son atelier et qu’il pouvait voir lorsqu’il était assis à son bureau. La veille de son décès, il me demanda, parmi ses dernières volontés de passer la voir de temps en temps au cimetière d’Arles, puisqu’il ne la rejoindrait pas dans le caveau préférant être dispersé près du phare de Faraman, en Camargue, sur ce sable qui figure dans de nombreux musées et collections et thème de prédilection qui l’amena à frapper à la porte de Roland Barthes.
La mère, la mort de la mère. L’image. Le signe. La photographie. Autant de points de convergence entre les deux hommes auxquels le destin ne donnera que peu d’occasions de confronter leurs idées et de développer, peut-être, de nouvelles approches discursives.
La relation entre les deux hommes sera éphémère du fait du décès du sémiologue mais n’en sera pas moins déterminante pour l’avenir de l’enseignement de la photographie en France car c’est dans ce cadre et sur ce que l’on pourrait appeler un malentendu que la rencontre va avoir lieu.
De la subjectivité au langage
Lucien Clergue s’était fait remarqué chez Douglas Cooper le 25 juillet 1956 par le critique d’art et conservateur du musée de Bâle Georg Schmidt[1]. Ce dernier et Michel Braive revenant du symposium aixois consacré à Cézanne avaient découvert dans un salon du Château de Castille[2], le maître des lieux et Pablo Picasso, largement entourés, admirant un ensemble de photographies de charognes, pour la plupart, déposées sur un fond de limon ou littéralement fondues dans le sable. Sans en avoir conscience, Lucien Clergue dépassait déjà la simple reproduction d’un instant du réel par un moyen mécanique. Le seul noir et blanc de sa technique, modifiait la réalité et tendait vers la subjectivité qu’Otto Steinert entrevoyait alors comme vecteur de la personnalité créatrice du photographe. Lucien Clergue photographe improvisait avec son appareil photo comme il aurait pu le faire sur les cordes de son violon. La longueur d’onde avait changé : ce n’était plus du son, mais de la lumière. Les années passant, les photographies d’animaux morts ont fait place aux corps de femmes. Points communs : une architecture mélodique, et un sable qui n’était encore une fois que support du sujet photographié.
Passionné de cinéma, Lucien Clergue aurait voulu « faire du cinématographe » [3] et c’est à nouveau faute d’argent qu’il utilisa la photographie qu’il qualifiait de « cinéma du pauvre » [4]. Après avoir acquis une notoriété respectable, il put enfin trouver les moyens financiers de réaliser quelques courts et moyens métrages grâce à Pierre Braunberger. En 1969 il tourna un film intitulé « Sables »[5]. Ce court métrage de 6 mn faisait suite à un travail photographique sur les plages du Rhône et des Saintes-Maries-de-la-Mer qui, si on y regarde bien n’était qu’une étude de subtiles sculptures crées de toutes pièces par la nature, mais que son œil subjectif définissait par un cadre comme nul autre pareil. Une démarche largement inspirée par les photographies de roches anthropomorphes faites par Edward Weston à Point Lobos à partir de 1929.
Le principe de l’image unique, figée qui est le caractère fondamental de la photographie ne satisfaisait pas pleinement Lucien Clergue. Dès 1954, lorsqu’il présente ses photographies à Jean Renoir il le fait sous forme d’un album devant être lu comme une suite de dessins, chaque image ayant sa propre vie, comme dans un chemin de croix où chaque station a sa propre unité tout en faisant parti d’un ensemble. Le recueil était conçu de manière à plonger le lecteur dans l’ambiance voulue par le metteur en scène. Ce concept de présentation de son travail tendait, m’avait-il dit, à éviter que des photographies sorties d’une boite soit éparpillées, mélangées et perçues comme de simples reproductions. Cela cachait en réalité un manque de confiance quant à la capacité du lecteur à discerner le discours intrinsèque de chacune de ses photographies. Le principe de l’album n’est autre que l’équivalent du montage cinématographique en ce qu’il organise les séquences d’un discours filmique.
Langage des Sables
Au mois de février 1975, Lucien Clergue entreprend la sélection de 60 photographies sur lesquelles le sable est une constante. Formes sculptées par le vent, traces laissées par des animaux, fragments de végétaux, puis passage de l’homme et ses déchets. Il veut « répondre au vœu [6] » de Ponthus Hultén[7] à qui il envoie des tirages grand format[8] avec une lettre explicative : « Cet ensemble d’images a la prétention de raconter une histoire, celle de l’homme ! et de retrouver parmi quelques grains de sable une manière d’histoire de notre planète »[9]. L’ensemble qui ne porte pas encore de titre est acheté par le FNAC. En réalité c’est l’ombre de Pablo Picasso qu’il faut encore voir dans cette « demande« , puisque Lucien Clergue avait rencontré Ponthus Hultén en 1969 lorsqu’il dirigeait le Moderna Museet à Stockholm. Il était allé y photographier un ensemble de sculptures réinterprétant Le déjeuner sur l’herbe[10] de Manet.
Quelques mois plus tard, une sélection légèrement différente est mise sous coffrets numérotés[11] avec pour titre Langage des sables. Un prélude et un post-scriptum complète ce corpus. Lucien Clergue ajoute une note[12] pour la mise en place de l’exposition dans laquelle il donne avec précision les espaces à respecter entre les groupes de photographies et le positionnement de chaque tirage en regard des autres. Lucien Clergue organise méticuleusement son travail pour une lecture structurée et efficace, reprenant stricto sensu le principe d’album de ses débuts.
En 20 ans de photographie, Lucien Clergue a acquis une notoriété planétaire. La création des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles[13] l’a positionné comme chef de file de la promotion de la photographie en France. C’est à la fin des années 70 qu’il est coopté pour donner des cours à l’Institut Saint Charles dépendant de l’Université de Marseille. Mais rapidement remonte le fait qu’il n’a pas les diplômes requis et Alain Mongeon, alors à la tête des études à Aix impose qu’il soutienne une thèse pour obtenir le doctorat requis. N’ayant pas d’autre choix étant donné qu’il veut continuer d’enseigner, Lucien Clergue se plie à cette exigence mais refuse le passe-droit d’une thèse sur dossier qui aurait pu lui être accordé en regard de ses publications et sa carrière.
L’aventure doctorale
En 1979, Lucien Clergue a reçu nombre de distinctions honorifiques, mais il n’a pas le baccalauréat. S’il maitrise très bien sa langue natale, c’est avec la lumière qu’il écrit le mieux. Afin de répondre aux exigences universitaires, il propose d’utiliser le langage photographique, mais reçoit une objection totale du corps enseignant de l’université de Marseille. Sûr de lui, Lucien Clergue insiste et demande à ce qu’un avis extérieur (mais surtout supérieur) soit obtenu. Il suggère alors de consulter le Collège de France et particulièrement Roland Barthes, élu depuis 1977 à la chaire de sémiologie littéraire, et que l’on pourrait qualifier aujourd’hui « d’influenceur ».
Le sable, en tant que tel, n’est pas d’un intérêt majeur pour le sémiologue. Par contre il a souvent fait allusion ou commenté le médium photographique et particulièrement son sens intrinsèque et signifiant. On trouve également dans ses écrits de multiples allusions à l’image. Dès 1953, dans Le degré zéro de l’écriture[14], il octroie à l’image le privilège de n’obliger à aucun sens de lecture ; plus tard en 1966, il annonce : « Innombrables sont les récits du monde… le récit peut être supporté par le langage articulé, oral ou écrit, par l’image, fixe ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes ces substances… » [15]. Une préoccupation récurrente qui l’amènera finalement à synthétiser ses notes sur la photographie entre le 15 avril et le 3 juin 1979, précisément dans la même période durant laquelle il est en relation avec le photographe arlésien.
Lucien Clergue n’avait peur de personne, ni de Pablo Picasso chez qui il osa se rendre à l’improviste en 1955, ni de Jean Cocteau en 1956 et neuf ans plus tard de Saint-John Perse avec qui cependant il avait pris rendez-vous. Aucun ne lui a résisté : Picasso illustra la couverture de Corps Mémorable et se démena avec Jean Cocteau en multipliant les démarches pour le faire connaître. Quant à Saint-John Perse, il finit par céder en acceptant que sa poésie[16] soit entrecoupée de représentations graphiques, chose qu’il avait notamment refusée à André Marchand pour l’édition d’Amers en 1962. Clergue donnera ses premiers cours devant des élèves chimistes et nullement devant des étudiants en sciences ou histoire de l’art et encore moins dans une discipline intitulée « Photographie » cette dernière ne relevant encore que de problématiques techniques au sein des universités françaises[17]. Il s’appuie sur ce constat pour obtenir un rendez-vous avec Roland Barthes qui reprendra d’ailleurs l’argument dans La Chambre claire : « On dit souvent que ce sont les peintres qui ont inventé la photographie (…) Je dis : non, ce sont les chimistes(…) la photo est littéralement une émanation du référent.[18] » .
Lors de leur entretien, Lucien Clergue défend la photographie, soutenant ses qualités créatives permettant une expression artistique au même titre que tout autre art. Puis il expose sa propre démarche, en quoi ses photographies ne sont pas que de simples reproductions d’instants éphémères passés (de « ça a été » sur lesquels Barthes s’appuiera ultérieurement dans La chambre claire) et comment, il ne montre pas ses photographies « en vrac » en leur laissant une simple valeur individuelle, mais selon un ordre bien défini tendant à raconter une histoire les mettant en relation, les unes avec les autres.
En 1954, les tirages réalisés d’après les négatifs du spectacle de Jean Renoir ont été rassemblés dans un ordre cohérent puis collés sur des feuillets de papier Canson de fort grammage afin de constituer un véritable livre (bien que les feuillets ne soient pas reliés) pour lequel il a demandé au peintre Richard Gall de concevoir une couverture. Enfin, il a écrit un colophon à la plume afin de citer les personnes ayant « contribués à la réalisation de cet album » [19]. Une démarche qu’il va poursuivre pratiquement toute sa vie et qu’il a appliqué au corpus qu’il montre à Roland Barthes puisqu’il lui fait sa démonstration à l’aide de l’un des coffrets intitulés « Langage des Sables« . Lucien Clergue ne se contentait donc pas d’un égrainement d’images, il établissait des sélections précises, et minutieusement pensées. En l’occurrence il donnait la parole au sable, ultime fragment de la roche, de la montagne, de la Terre elle-même et entendait livrer une histoire universelle qui est autre que celle de l’homme.
Si les photographies à elles seules n’auraient peut-être pas suffi à convaincre, la démarche, elle, amène Roland Barthes à faire référence à Claude Lévi-Strauss : « tout classement est supérieur au chaos ; et même un classement au niveau des propriétés sensibles est une étape vers un ordre rationnel » [20]. Il reconnait que le moyen photographique permet à Lucien Clergue d’élaborer un véritable discours, de mettre en image les mots que langage et écriture ne lui permettent pas. Certaines photographies donnent une structure, d’autres une nuance et toutes expriment visuellement une capacité à rebondir, une renaissance après le chaos d’une enfance désenchantée confrontée très tôt à la mort, particulièrement à celle de sa mère[21].
Sans sombrer dans une esthétique et un discours facile, Lucien Clergue avait fait le constat dans ses images de nus féminins que ce qu’il photographiait n’était autre qu’un ensemble de forces qui résistaient à la mort, ce que Bichat déterminait comme étant l’essence même de la vie. Rien d’étonnant alors dans le fait que soudain, aux masses informes de ses charognes ayant depuis longtemps perdu tout espoir d’éternité, se soit substitué sous des vagues de dentelière, le corps nu d’Aphrodite. « Le ventre maternel n’enfante-t-il pas vie et mort à la fois ? » [22] avait-il écrit à Jean Cocteau qui s’était empressé de déclarer :
« Clergue**. Cet arlésien n’est pas un esthète, il ne lâche une nature morte qu’après l’avoir mitraillée de toutes parts, lui avoir administré le coup de grâce et s’être assuré qu’elle avait parlé, avoué, avant de mourir. ** Lucien Clergue fût sans doute le seul témoin de la naissance d’Aphrodite, qu’on se le dise » [23].
Tout en décrivant une méthode de travail le poète de la jeunesse avait établi l’acte de décès de la phobie morbide du jeune photographe. C’est dès lors vers cet autre côté du miroir, si cher à Cocteau, qu’il s’était consacré, photographiant les vastes et lumineuses étendus de Camargue.
Roland Barthes émet des réserves quant à la possibilité d’admettre un tel travail comme thèse car le jury ne pourrait pas répondre dans le langage de son rédacteur, Lucien Clergue s’exprimant avec la lumière. Il reconnait cependant le principe novateur qui lui a été soumis et il recommande finalement que celui-ci soit accepté par l’université de Marseille pour la soutenance d’une thèse de doctorat. Il ajoute, en outre, qu’il souhaite être convoqué pour intégrer le jury, ce qui évidemment comble Lucien Clergue.
Suivant les commentaires entendus lors de son entretien, Lucien Clergue remanie la sélection du Langage des sables établie en 1975 et présente une thèse constituée de ses seules photographies le 5 décembre 1979 devant un jury présidé par Roland Barthes.
Les photographies sont exposées sur une paroi et l’intervention ne dure qu’une vingtaine de minutes dont moins de la moitié est consacrée au sujet véritable de la thèse, Lucien Clergue ne prononçant que 301 mots exactement, sans aucun élément d’analyse, mais prononçant de simples annonces en montrant les tirages tout en utilisant un vocabulaire musical tel que « prélude » ou encore « mouvement » que l’on pourrait qualifier de titres, le but étant de focaliser l’attention du jury sur les seules images constituant cette « suite de Langage des sables » [24].
Dans la démonstration du photographe, Roland Barthes retrouve une part de sa quête lorsqu’il disait : « Je tente de découvrir comment les hommes donnent un sens à ce qui les entoure et, sur un plan supérieur, à la littérature » [25]. En outre il explique que lorsqu’il était jury de thèse littéraire, il cherchait à dégager « en quoi, par chance, elle [la thèse soutenue] pouvait déborder le savoir » [26] et en quoi avec celle de Lucien Clergue, il devrait faire le contraire. Roland Barthes va rechercher le pouvoir intellectif d’images dont la beauté ou la valeur esthétique et poétique sont universellement et internationalement reconnues et prétendre devoir évaluer « l’esthétisme » [27] pour reprendre le mot « modeste » qu’il emploie. Autrement dit, en quoi le corpus de photographies présenté est rigoureusement une thèse en dépit de l’absence apparente de tout discours écrit, au même titre que celle d’un étudiant de troisième cycle s’exprimant dans son langage naturel. Roland Barthes fait ressortir deux raisons qui, selon lui, permettait d’affirmer qu’il y a thèse.
La première raison invoquée en quelques phrases est la notion de classement. Lucien Clergue assume de classer ses photographies. Roland Barthes se range résolument derrière les travaux de Claude Levi-Strauss en synthétisant que « tout classement est discours« . « Sans un mot, en classant vos images vous avez tenu un discours » [28] affirme-t-il en premier lieu lors de son intervention.
La seconde raison plus longuement étayée est que « s’il y a reproduction d’un référent, il y a fatalement acte de connaissance« . Ce à quoi Roland Barthes ajoute : « On ne peut pas reproduire sans solliciter la connaissance. C’est là le problème ontologique de la photographie. On ne peut pas reproduire même si cela induit de la littéralité sans puiser dans le savoir » [29]. Lucien Clergue conduit Roland Barthes à placer son ensemble de photographies sur le rapport entre le savoir et le sens, puis à analyser en quoi le changement de perception que peut induire une représentation photographique est une notion capitale tendant à relativiser le savoir.
Le jury ayant délibéré favorablement, une publication est envisagée, mais Lucien Clergue entend rester dans le principe édicté par Boris Pasternak lorsque qu’il écrivait « L’homme est muet, c’est l’image qui parle » [30] et ne souhaite pas intervenir plus que par une reprise un rien plus poétique de la lettre adressée à Ponthus Hultén en 1975. Par contre, il demande à Roland Barthes, qui accepte immédiatement, d’écrire un texte.
La première ébauche arrive à Arles dans les premiers jours du mois de février 1980. L’intervention post soutenance est reprise de manière littéraire, s’accordant tout à fait aux allégories poétiques des photographies. « Lorsqu’une œuvre déborde le sens qu’elle semble d’abord poser, c’est qu’il y a en elle du Poétique : le Poétique, c’est, d’une manière ou d’une autre, le supplément du sens. » [31]
Lucien Clergue m’a confié avoir été ému de découvrir tout ce qu’il n’avait pas retenu, voire entendu lors de sa soutenance tant il était pris par l’ambiance. Il voulait s’entretenir avec Roland Barthes de certains points dont il espérait une analyse plus détaillée. Il souhaitait en outre que soit mentionnée et évaluée la forme de sa thèse : un coffret de photographie. Si l’on se replace dans le contexte de cette année-là, c’est la correspondance écrite qui était encore le moyen d’échange privilégié, à plus forme raison dans le cadre d’une analyse scientifique. Lucien Clergue découvrait La chambre claire qui venait tout juste de paraître et préparait sa réponse lorsqu’il apprit l’accident du 25 février.
Il n’y aura hélas plus d’échanges entre les deux auteurs et les questions de l’un resteront sans les réponses tant espérées de l’autre. Quelques temps après le décès de Roland Barthes, Lucien Clergue obtient l’autorisation de Michel Salzedo pour la publication in extenso du texte reçu, ainsi que la possibilité d’ajouter le titre : Note sur un album de photographies de Lucien Clergue. Un titre établi sur la base du terme « Note » qui renvoie à l’univers barthésien et que l’on trouve associé spécifiquement à la photographie dans La chambre claire. On peut également retrouver l’utilisation récurrente de mot dans le vocabulaire qu’utilisait Lucien Clergue en tête de nombreux manuscrits des années 50 : « Notes de travail sur le meurtre de Jules César » [32], « Notes. Entretiens avec Picasso » [33], « Carrières des Baux, Notes photos » [34], « Notes sur un voyage en Suisse, où l’art français est unanimement prisé » [35] ou encore « Note pour la mise en place de l’exposition » [36] ; une liste qui est loin d’être exhaustive.
Enfin, ultime point commun qui tient à la fois du hasard et de l’anecdote : la Rue des Ecoles, dans le cinquième arrondissement de Paris qui était régulièrement fréquentée par les deux hommes. L’accident qui couta la vie à Roland Barthes le 25 février 1980 eut lieu, on le sait, en face de l’entrée du Collège de France. A cette époque, Lucien Clergue logeait ponctuellement au numéro 30, chez son ami de toujours, l’écrivain Jean-Marie Magnan. Un homme qui a assisté à la mutation du violoniste vers la photographie et dont l’érudition l’avait amené à se positionner à la manière d’un critique littéraire influent au point de faire dire à Lucien Clergue qu’il était « sa conscience » . Un lien profond s’était établi entre les deux hommes qui allait bien au-delà de l’amitié car elle avait trait … au Savoir, cette même notion clé pivot de la controverse post soutenance. A partir de 1988 l’appartement sous les toits du 30 Rue des Ecoles deviendra le pied-à-terre parisien permanent du photographe.
La relation entre Roland Barthes et Lucien Clergue n’a certes durée que le temps d’une année, mais elle a permis au sémiologue de se pencher sur le langage d’un écrivain de lumière et à celui-ci de donner à la photographie la reconnaissance universitaire ultime : être enseignée. Bien qu’ayant reçu son diplôme, Lucien Clergue ne sera plus jamais sollicité pour donner des cours dans une université française, mais il est à l’origine, avec Maryse Cordesse et Alain Desvergnes de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie qui est l’unique école d’art française au sein de laquelle l’enseignement est consacré exclusivement à la photographie. La chambre claire reste un des ouvrages de référence pour tout étudiant dans ce domaine.
Notes
[1] Schmidt Georg. Lucien Clergue – poésie photographique in Revue Quantum, Vol.3. 1957, P.125
[2] Douglas Cooper, historien d’art, avait acquis cette propriété sise sur la commune d’Argilliers dans le Gard en 1950 et il y avait déposé sa collection d’art contemporain.
[3] Clergue Lucien. Soutenance de la thèse Langage des sables. 1979. Cassette audio, Coll. Succession L. Clergue.
[4] Ibidem, 3.
[5] Lucien Clergue. Sables. Les Films de la Pléiade, 1969.
[6] Tel qu’inscrit au colophon d’un coffret présent dans les fonds du Musée Réattu à Arles. inv. 80.6.6.2.
[7] Ponthus Hultén était à ce moment-là en charge de la direction artistique du futur Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, à Paris.
[8] Format 40 x 50 cm à l’exception des n° 30 et 32 (format 30 x 40 cm) sur papier Ilfobrom blanc brillant glacé. Lucien Clergue cherchait, par l’utilisation de papier de grande taille à se rapprocher du format des gravures qu’il voyait dans les ateliers d’artistes et à donner à ses photographies une qualité artistique plus évidente. Dans le même but, il numérotait les tirages en édition limitée à vingt exemplaires.
[9] Clergue Lucien, « Cet ensemble d’images … ». Arles : Tapuscrit, 02/1975. Coll. privée.
[10] Picasso Pablo, Le déjeuner sur l’herbe. 1966. Moderna Museet.
[11] L’édition est limitée à vingt-cinq exemplaires dont cinq hors commerce.
[12] Clergue Lucien, Note pour la mise en place de l’exposition. Arles : tapuscrit, 02/1975. Coll. privée.
[13] Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, devenues Rencontres d’Arles, ont été initiées autour du Festival d’Arles en juillet 1969 et ont connues leur première édition en 1970.
[14] Barthes Roland, Le degré zéro de l’écriture, Editions du Seuil, 1953.
[15] Barthes Roland, « Introduction à l’analyse structurale des récits ». In: Communications, 8, 1966. Recherches sémiologiques : l’analyse structurale du récit. p. 1.)
[16] Perse Saint John, Amers. Paris, Gallimard, 1957.
[17] Il est à noter que la recherche du terme « photographie » dans les formations proposées au sein de l’Université d’Aix-Marseille ne propose plus le moindre résultat à ce jour.
[18] Barthes Roland, La chambre claire: Note sur la photographie Paris : Gallimard Seuil Cahiers du cinéma, pp. 126-127.
[19] Clergue Lucien, Jules César. Manuscrit, 1954. Coll. Succession L. Clergue.
[20] Levi-Strauss Claude, La pensée sauvage. Plon, 1962.
[21] Jeanne Grangeon est décédée à l’âge de 53 ans le 30 décembre 1952. Elle repose au cimetière d’Arles dans le caveau de la famille Deguilhem.
[22] Lettre manuscrite de Lucien Clergue à Jean Cocteau datée du 11 octobre 1956. Coll. Succession L. Clergue.
[23] Cocteau Jean. « Les photographies de Clergue… » . Poème manuscrit. Novembre 1956.
[24] Ibid 3
[25] Zavriew André, « Roland Barthes ou l’Empire des Sens » . Revue des Deux Mondes, 11-2016.
[26] Ibid 3.
[27] Ibid 3.
[28] Ibid 3.
[29] Ibid 3.
[30] Pasternak Boris, Haute Maladie.
[31] Barthes Roland, Clergue Lucien, Langage des Sables. Marseille : Ed. AGEP, 1980.
[32] Clergue Lucien, Manuscrit daté du 14/03/1955.
[33] Clergue Lucien, Manuscrit daté du 16/12/1956.
[34] Clergue Lucien, Manuscrit daté du 30/04/1956.
[35] Clergue Lucien, Manuscrit daté du 16/10/1957 en vue d’une publication dans « Le Provençal ».
[36] Ibid 12.