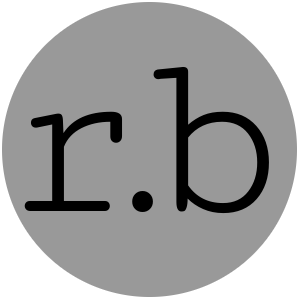Roland Barthes en était tout à fait conscient à la publication de La Chambre claire : « ce livre va décevoir les photographes »[1]. Il le justifiait par l’approche particulière qu’il avait choisie : « une phénoménologie de la photographie », l’étonnement devant « un phénomène iconique entièrement, anthropologiquement nouveau »[2]. Il dit : « je me remets dans la situation d’un homme naïf, non-culturel, un peu sauvage qui ne cesserait de s’étonner devant la photographie » : « cet étonnement m’oblige à ne tenir aucun compte du monde évolué photographiquement dans lequel [les photographes] vivent. »[3]
Barthes « non-culturel » ?
Pour un sémiologue spécialiste depuis les Mythologies de l’art de débusquer le fait culturel jusque dans l’image de l’abbé Pierre ou le discours amoureux, pour un linguiste malade de voir le langage[4], la création pour l’occasion d’un narrateur « naïf, non-culturel, un peu sauvage » affirme de manière inédite la fiction ; les temps du récit employés dans La Chambre claire et dès l’introduction la formulette liminaire du conte « Un jour, il y a bien longtemps » font également signes du roman à la première personne[5]. Le fantasme historique d’un retour au XIXe siècle (« je me remets dans la situation ») se construit de manière extrêmement étonnante pour un auteur qui a su si bien dévoiler le mythe de la Nature partout, les discours de l’origine pourvoyeurs de normes et l’idéologie de « ce qui va de soi »[6]. Retour à la nature de la photographie pour chercher son essence ? Barthes en effet, on ne s’y est pas trompé, construit un mythe[7].
Cette posture liminaire originale engage un système de références volontairement abstrait des discours contemporains (on y reviendra) : devant les appareils en bois et les changements de plaques, ce « quelqu’un de très ancien »[8] qui s’exprime sur la photographie ne peut culturellement qu’en interroger la merveille technique : « on dit souvent que ce sont les peintres qui ont inventé la photographie […]. Je dis non : ce sont les chimistes »[9]. Cette Physis de la photo engage un discours sur la découverte d’un phénomène naturel, celui dont François Brunet, dans La naissance de l’idée de photographie[10], a mis en évidence l’idée en relisant les textes du XIXe siècle : on retrouve ainsi la même sorte de langage qui fait de l’invention de la photographie une découverte, chez le narrateur barthésien comme chez les authentiques auteurs du XIXe. La naturalité de la photographie exclut les photographes et leurs intentions du sujet : strict Operator, manipulateur savant d’objectif et de plaque, le photographe ne fait pas les images, il les obtient. Au Spectator de contempler ces phénomènes objectifs, tout naturels.
On peut revenir rapidement sur la désignation des trois personnes concernées par la photo : après l’Operator-laborantin, le Spectrum affirme aussi son identité dans le registre de la physique : il prend le nom en optique du faisceau de rayons qu’il a réfractés. Ainsi est-ce bien le Spectator l’intrus dans cette nomenclature que seule l’unité de langue latine semble fédérer : pourquoi pas l’Observator ? En venant remplacer le scientifique attendu pour l’observation du phénomène, le Spectator ouvre un pont entre l’amateur, désengagé de tout savoir préalable (il autorise la posture phénoménologique) et le spectateur – de théâtre évidemment (ce qui distord franchement la naturalité du spectacle, sauf à considérer, comme un Talbot par exemple – pour rester dans l’époque – le spectacle même de la nature, celle-ci se faisant l’artiste[11]… On sait que Barthes glisse entre ces postures opposées, tantôt parlant côté théâtre des masques dans le portrait, tantôt ne considérant plus du tout, côté nature, le dispositif dans l’image, n’observant en elle que ce qu’elle présente). La liberté absolue de ce personnage inédit devant les images permet, dans l’atmosphère scientifique qui l’entoure, de jouer dans un premier temps le savant qui étudie et pointe certains fonctionnements sémiologiques connus qui construisent un discours sur le réel (les antithèses des soldats et des bonnes sœurs, ou l’émir faisant du ski), et dans un deuxième temps de retourner l’observation sur elle-même, dans sa dimension spéculaire et cette fois affective : comme au théâtre, le Spectator s’ennuie souvent poliment et parfois, plus rarement – ponctuellement – , il est bouleversé.
Le studium et le punctum font partie de ce registre pseudo-scientifique que prétend garantir le latin : figures d’une intentionnalité toute relative, le premier dresse son objet comme objet d’études (physique), le second comme accident. La première forme de punctum, locale, avant la seconde forme, généralisée (par la preuve que toute image a été prise dans le passé…), se voit ainsi tributaire de la naturalité de la photo dans le conte naturaliste du narrateur de Barthes. Le punctum n’est pas le fait de l’Operator (qui ne fait qu’enregistrer), et c’est précisément parce que le punctum est un fait du réel (et pas un effet) qu’il frappe si fort. Accidents de la nature, enregistrés sur plaque, la poupée au doigt de l’enfant d’Arbus, les mauvaises dents du garçon de Klein, le collier ou les souliers à bride de la femme dans le portrait de famille : ces détails du réel ne concernent (n’affectent, n’ébranlent) que le Spectator pour des raisons qui lui sont propres, réservées, laissées à sa discrétion. C’est ainsi au nom de la naturalité de la photographie que Barthes parvient à isoler et à formuler le punctum.
Pourtant, tous les photographes le disent : s’ils découvrent en deuxième sélection sur la planche contact tel ou tel détail qu’ils n’avaient pas perçu à la prise de vue, ce détail même – ni centré, ni dans un premier temps conscient – peut légitimer le tirage, partant l’existence-même de la photo. En écartant le photographe de sa réflexion, et notamment en le privant du regard sur ses propres images (ce qui est un comble !), le narrateur barthésien s’arroge à lui seul la responsabilité du punctum : puisqu’il n’y a que le Spectator qui observe les images dans la triade humaine autour du phénomène photographique, c’est forcément lui qui en est l’auteur.
Il faut y insister, la photo-sans-le-photographe, ce phénomène d’image naturelle, est la condition sine qua non du plus important aspect, sans doute, que révèle Barthes sur une spécificité de la photographie par rapport aux autres arts de l’image, car il est inédit, de fait possible, que l’auteur de la photo ne l’ait pas remarqué. Aussi ne peut-il jamais y avoir de punctum dans les arts du dessin ou de la peinture, dans lesquels tout détail poignant qui s’y trouverait est nécessairement le fait de l’artiste, et non pas du réel. C’est cette possibilité d’un fait de réel qui n’est pas un effet (pensé, construit – ne serait-ce que par une norme) qui détermine l’essence de la photo selon Barthes, et que légitime cet étrange vocabulaire latin de pseudo-naturaliste qui ne s’intéresse pas à la culture des peintres et s’interroge sur l’image naturelle.
L’insistance sur les chimistes par rapport aux peintres dans l’invention de la photographie n’avait pour vocation que de retirer la culture de la photographie, et en la naturalisant ainsi, sortir de la question de l’art.
« Le monde évolué photographiquement dans lequel vivent [les photographes] »
Quel est ce monde à la fin des années 1970 ? La chambre claire en conserve, malgré l’effort d’intemporalité, des traces très significatives. Les images reproduites, à l’exception du polaroïd de Boudinet sur lequel nous reviendrons, proviennent toutes de revues et de journaux, spécialisés ou non, c’est-à-dire de la presse qui emploie ou diffuse les images photographiques. Rien de la reproductibilité technique de l’œuvre d’art en masse n’est mentionné ici (si ce n’est l’aura du visage dans le portrait qui fait justement exception dans la réflexion de Benjamin[12]), et La Chambre claire recueille pêle-mêle les images imprimées du photojournalisme, quelques photos de famille et les reproductions d’œuvres d’art photographique : Stieglitz, Kertész, Sander, Nadar, William Klein sont, parmi d’autres exemples, les grands photographes reconnus que Barthes publie.
Des pionniers aux contemporains, ils sont d’indiscutables auteurs dans un marché de la photographie certes naissant en France, mais justement alors en pleine expansion : les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles commencent au début des années 1970, la galerie Agathe Gaillard, spécialisée en photo, a ouvert à Paris en 1975[13], année de la création des éditions Contrejour ; les rubriques de critique photo dans les quotidiens nationaux naissent aussi dans cette grande décennie de l’institutionnalisation de la photographie en France[14]. Aussi lorsque Barthes évoque « un monde évolué photographiquement », il s’agit de fait de la période la plus faste de la culture photographique en France ! Tout près de l’auteur, Denis Roche, le complice des éditions du Seuil, le poète et photographe, a déjà publié Notre antéfixe en 1978, et poursuivra une vaste œuvre photolittéraire ; il crée avec Gilles Mora, Bernard Plossu et Claude Nori les Cahiers de la photographie en 1981 ; le critique photo et romancier Hervé Guibert fait paraître son livre sensible à la première personne, L’Image fantôme, aux éditions de Minuit en 1981 ; le grand colloque Pour la photographie, du GERMS à Paris VIII sera organisé début 1982 (trois épais volumes d’actes publiés dans la Revue d’esthétique), même année pour la création par Michel Frizot de la collection Photo poche ; le manifeste photobiographique de Mora et Nori paraîtra en 1983, Jean-Claude Lemagny et André Rouillé publieront leur histoire de la photographie chez Bordas en 1986…
Roland Barthes n’ignore évidemment rien des questions qui intéressent alors les professionnels (qui commencent à exposer et à vendre) et les intellectuels autour de la photographie. Mais ces discours naissants (critiques, esthétiques, théoriques), des auteurs et des analystes interviennent aussi dans un contexte social où la photo est d’abord massivement présente dans le discours publicitaire, bien loin des maisons d’édition et des galeries d’art. Ce discours, omniprésent dans la presse, dans la rue avec les affiches et à la télévision, vante l’instantané couleur et vend des appareils et des pellicules toujours plus performants. Barthes prend acte de ce discours dans son petit texte sur une série d’Avedon : « De combien de photos dit-on assez bêtement qu’elles sont « vivantes », « animées », etc., toutes valeurs mythiques mobilisées par la publicité des matériels photographiques ! »[15].
L’auteur réfère ici à une Doxa de la photo qui ne s’intéresse pas du tout à l’art, et promeut ce qui paraît précisément tout l’inverse : l’enregistrement toujours plus fidèle de la vie avec Kodak ou Fuji. Dans La Chambre claire, il écrira que « faire vivant », c’est voir mort[16], mais déjà en 1977, pour faire l’éloge d’Avedon, le contrepoint de la Doxa est inévitable, et c’est justement ce discours, plutôt que celui des photographes et des intellectuels qui, parce qu’il poursuit le mythe de la Naturalité, sera au fondement de La chambre claire.
Le « grand art » de Richard Avedon et « les photographies » des autres
Il n’y a qu’un seul texte dans cette fin de la décennie 70, dans lequel Barthes consent à parler d’art photographique, au sujet d’Avedon : il y affirme avec une insistance apologétique exceptionnelle la valeur d’un art : ‘Regardez une photographie d’Avedon : vous y verrez en action le paradoxe de tout grand art, de tout art de grande race : l’extrême fini de l’image ouvre à l’extrême infini de la contemplation, de la sidération.’[17]
Un « art de grande race » : l’expression peut surprendre et réfère sans doute à la diversité des sujets (pas exclusivement des Blancs) dans les portraits du photographe états-unien, et parmi les corps divers et parfois déshabillés – comme ceux de la Factory le sont dans une des images qui illustrent le court texte – des différences revendiquées au naturel, par exemple l’acteur trans Candy Darling. L’art photographique de grande race serait ainsi celui qui affirme, expose, présente la diversité de la nature comme culture. Le texte poursuit sur l’engagement dans la critique sociale d’Avedon, ainsi que la réflexion de Barthes sur la photo (encore) comme Texte – dont il faut rappeler qu’il est pour lui le lieu de circulation des sens, indépendamment de la forme, visuelle ou verbale, de ses signifiants[18]. Mais si le critique énumère quelques-uns – sept – de ces sens, en affirmant l’impossible exhaustivité de leur repérage, s’il dit que la théorie de la photographie souffre de l’engouement théorique rival pour le cinéma, et même pour la bande dessinée, s’il affirme encore rapidement que la photo n’a d’enjeu théorique que hors « la photographie d’art […] qui dénie précisément la photographie comme art », ou la photo de reportage « qui ne tire son prestige que de la capture de l’objet », les « textes » d’Avedon, eux, donnent matière à penser avec « ces cadavres aux yeux vivants, qui nous regardent, et qui pensent : cet art réaliste est aussi un art fantastique. »[19]
C’est à titre exceptionnel que Barthes reconnaît chez Avedon un « grand art » photographique : les autres photographes, y compris ceux qu’il aime, ne seront pas si bien traités. Pour Lucien Clergue, il se débarrasse de la question de l’art dès l’introduction : « Les photographies de Lucien Clergue sont belles et leur beauté est reconnue. Mon rôle, me semble-t-il, n’est donc pas d’en parler au plan de l’esthétique, mais de chercher et de dire ce qu’il y a en elles d’intellectif. »[20] Chez Bernard Faucon[21], il analysera l’artifice du « tableau vivant au second degré », loin de l’art photographique qui n’est, pas plus que l’amour des enfants, écrit-il, « le motif (la question) de son entreprise ». Et même, écrit-il, avec les photographies de Bernard Faucon, « nous doutons (enfin) que dans la photographie, grande inconnue du monde moderne, il y ait d’un côté un sujet et de l’autre une manière ; bref, nous doutons que la Photographie ne soit rien de plus (idée cependant usuelle) que la conjonction d’un argument et d’un art. »[22] En commençant systématiquement par évacuer la question de l’art de ses réflexions sur l’œuvre d’artistes-photographes, Barthes combat comme souvent un préjugé afin de mettre en évidence un paradoxe qui isole une singularité plus intéressante, mais ce préjugé-là est tout récent, instable, à peine installé…
Certes la signature même de Barthes est un processus de légitimation des œuvres des photographes – qu’il reconnaisse un très grand art ou qu’il refuse d’en parler, le déport général hors de la question de l’esthétique photographique vers autre chose (autre plan – linguistique pour Clergue – ou autre forme d’art – tableau vivant pour Bernard Faucon –) ne sert pas vraiment l’institutionnalisation en cours. Et dire que la photo, quand il y a grand art, est un « texte », à lire, n’est guère au service de l’assomption d’un art nouveau…
Et dans La Chambre claire, il fera pire encore à l’égard des photographes contemporains en naturalisant, comme on l’a vu, les images. William Klein, généreusement, comprend bien que l’écrivain suit « sa propre obsession, qui fait de lui Barthes. Mais ce qui m’étonne, écrit-il, c’est son refus de s’intéresser à une quelconque intention du photographe. »[23]. Ce refus, de fait explicite, de « la Photo-selon-le photographe »[24] qui est normalement au fondement du discours contemporain de la critique et de la théorie en photographie[25], affirme à nouveau, après la déclaration de la mort de l’auteur en 1968, la réception comme entrée critique à l’égard de l’objet d’études. Mais le contexte est très différent : il ne s’agit pas vraiment de se débarrasser en photographie de l’autorité qui livre la clé de la signification de l’œuvre à l’ancienne critique ; et le narrateur, d’ailleurs, abandonne rapidement dans le livre l’idée d’image à lire : il commence à voir, mais à voir, donc, des images qui n’ont pas été construites par des photographes.
Il reste toutefois des traces minimes d’une émancipation du Spectator affichée mais pas tout à fait accomplie par rapport aux intentions du photographe à l’égard en tout cas de ses contemporains. En effet, pourquoi préciser son entêtement, « ce que je vois avec obstination, ce sont les mauvaises dents du petit garçon »[26], dans la photo de Klein ? Ce complément circonstanciel de manière manifeste sa résistance contre le photographe, la conscience que quelque chose existe contre quoi s’affirme le punctum : obstination à ne pas voir la composition, le grand angle, etc., mais encore la violence constatée dans l’image par William Klein. Le punctum est ainsi un vol revendiqué, conscient, l’appropriation d’un détail dans la photographie soustrait à l’autorité du photographe.
Si les étalons de l’histoire de l’art photographique (mais pourquoi pas Cartier-Bresson ? Guibert le remarquera[27]) sont représentés dans les illustrations de La Chambre claire, le narrateur détourne leur œuvre au profit de son sujet-personnage qui fabrique son roman dont on sait qu’il est aussi un livre du deuil. Par exemple, de Stieglitz, illustre promoteur de l’art moderne en photographie – notamment avec sa propre mise en valeur de son « Steerage » de 1907 – le narrateur barthésien prétendra que « sa photo la plus connue » est « The Terminal » (en changeant qui plus est le titre de la photo, le rendant plus nostalgique : « le terminus de la gare à chevaux »[28]). Or cette image doit encore au pictorialisme dont Stieglitz fut certes un temps adepte (et influent), mais ceci avant de l’abandonner pour fonder Photo-Secession, pour lancer la Straight photography avec Paul Strand, pour faire entrer la photographie dans l’art moderne.
Barthes écrit donc contre l’histoire de la photographie, il réaffirme encore contre la question de l’art, après « Photo-chocs », la composition structurée des images discursives du photojournalisme. Deux autres polémiques tout à fait contemporaines sont rapidement évoquées : la photographie scientifique peut-elle donner lieu à des images d’art ? la photo couleur a-t-elle sa place dans le milieu artistique ? les réponses personnelles du narrateur seront non et non, rapides, sans appel, les sujets évincés. Ni les expérimentations d’Edgerton[29] ni la couleur n’ont pour le narrateur d’intérêt sensible alors même qu’on débat abondamment de la légitimité de leur place dans les galeries.
La couleur, à la fin des années 1970 ?
La couleur, on sait que dans La Chambre claire, il en désapprouvera l’emploi – toujours en tant que narrateur au singulier -, il la place du côté du fard dont on rend tolérable le visage des morts. Mais dans deux textes qui sont presque contemporains de l’écriture du roman, il écrit justement sur des photographes qui travaillent, avec une grande audace pour l’époque et avec persévérance, en photographie couleur : Bernard Faucon et Daniel Boudinet.
Faut-il le rappeler : la photographie couleur est à cette époque reléguée à la basse culture des photos amateur de famille et de tourisme, et côté professionnel, elle est exclusivement affectée à la publicité et à la mode. Ce n’est qu’en 1976 que les œuvres de William Eggleston et de Stephen Shore seront présentées au MoMa, l’exposition faisant date dans l’histoire de la photographie avec l’introduction de la photo d’auteur en couleur dans l’art. Pour cette même époque en France, Christian Caujolle ne cite que quatre coloristes : John Batho, Pierre et Gilles, Bernard Faucon et Daniel Boudinet[30]. Or lorsque Barthes écrit en octobre 1978, dans Zoom, sur la série Les grandes vacances de Bernard Faucon, il accomplit ce qui paraît un véritable exploit à l’égard de l’audace du photographe, qui consiste à ne pas même mentionner la couleur. Pas un mot. Il analyse les mises en scène, les modèles vivants parmi les mannequins, l’artifice généralisé des tableaux vivants, mais alors que pour le narrateur de La Chambre claire elle serait l’un des arguments majeurs de l’artificialité, la couleur des images de Faucon n’est même pas évoquée.
(Pourtant Barthes aime la couleur, en peinture : ses textes de la même période sur Cy Twombly[31] témoignent de la jouissance de la couleur qui passe non par le crayon de couleur, mais par la « couleur crayon », écrit-il – où l’on reconnaît le dessinateur, ou plutôt le traceur de signes sans signification du Roland Barthes de 1975[32].
Quant à Daniel Boudinet, dont une exposition récente[33] a permis de découvrir l’extrême exigence du travail de coloriste que ce proche de Roland Barthes a mené à cette période, notre auteur accepte bien d’écrire sur une série de paysages en noir et blanc (on y retrouve l’idée pour le genre du paysage de la « photographie habitable » que le narrateur a devant « Alhambra » de Clifford) ; des photos qu’il a faites à plusieurs moments au séminaire de Barthes et ses étudiants on peut aisément déduire leur amitié, leur familiarité, mais là encore sur la couleur : rien. Pourtant les Fragments du labyrinthe et d’autres polaroïds nocturnes du photographe sont absolument remarquables de beauté et de maîtrise technique de l’image photographique : les polaroïds de Boudinet, avec leurs couleurs en demi-teintes, les longs temps de pose et les filtres qui permettent aux formes de sortir délicatement de l’obscurité pour apparaître, sont l’exact opposé – voire la contradiction même[34] – de la photographie considérée exclusivement sous l’angle de l’instantané telle que l’envisage le narrateur barthésien. Dans l’œuvre en couleur de Boudinet, la technicité de l’image – je veux dire son absolue différence avec quelque enregistrement prétendument fidèle à ce qu’un œil humain pourrait voir – s’affirme comme production plastique, sans pour autant rendre méconnaissables les choses (meubles, rideaux, fenêtres) du réel, mais c’est leur perceptibilité colorée qui paraît, non leur « reproduction » (pour reprendre le terme que Barthes utilise pour Clergue, par exemple).
Cette sorte d’ostracisme auquel Barthes condamne la couleur, pourtant affirmation ultra contemporaine d’un art nouveau dans lequel se distingue à l’évidence son ami Daniel Boudinet, va même jusqu’au retrait par l’auteur de la mention du nom du photographe dans la dernière version de La Chambre claire. Evoquant la technique du Polaroïd dans une parenthèse, il remplace « (le polaroïd ? amusant mais décevant, sauf quand Daniel Boudinet s’en mêle) » par « sauf quand un grand photographe s’en mêle »[35]. Roland Barthes aime Daniel Boudinet, il le sait être un grand photographe de la couleur, mais il ne dira pas un mot du coloriste dans La Chambre claire (ni ailleurs) …
Comment interpréter cet effacement volontaire, et la reproduction d’une œuvre de Daniel Boudinet sans commentaire à cette place d’honneur au seuil du livre ? Il est évident que La Chambre claire n’a pas pour vocation de servir la cause des photographes et des nouvelles images qui s’effectue ailleurs. Si Barthes ne rechigne pas à soutenir son ami en lui écrivant un texte (sur les paysages en noir et blanc) – alors même qu’il est en deuil et en pleine rédaction du livre[36] –, il semble renoncer à le « lancer » dans son roman, choisissant exclusivement des noms déjà reconnus de l’histoire de la photo, indiscutables[37], pour les illustrations. De fait les questions de la photographie contemporaine ne sont pas le propos du narrateur.
Spectator et regardeur : deux fictions, sans le photographe et avec lui
Le refus délibéré du narrateur barthésien de s’intéresser à l’actualité agitée des questions de photographie des années 1970 le mène de fait à écarter son livre du service de la reconnaissance des auteurs et des travaux les plus novateurs. Toutefois ce livre personnel, ce mythe qu’élabore Barthes au mépris des efforts de ses contemporains pour faire reconnaître une valeur esthétique – qui est aussi une valeur de marché pour les professionnels – , ce livre presque nocif pour la réputation des photographes en ce qu’il reconduit les discours doxiques (sur le hasard au lieu du travail du regard, sur le réel au lieu de la fabrication des images) a cependant la valeur de créer une figure – un « personnage conceptuel » diraient Deleuze et Guattari – qui est à proprement parler une invention esthétique de la photographie au XXe siècle, une figure indispensable à une définition esthétique de la photographie : celle du regardeur.
Celui qui regarde les images, Diderot l’avait introduit en littérature devant les tableaux, un personnage de critique qui raconte librement, à la première personne, « ce qui se passe » devant une nature morte de Chardin, dans les paysages de Vernet ou sur les scènes de Greuze, mais Barthes ne vante pas aux têtes couronnées d’Europe le talent d’un artiste ou d’un autre, « en fait, il ne regarde rien : il retient vers le dedans son amour et sa peur » comme l’enfant pauvre photographié par Kertész en 1928 : « c’est cela, le Regard », écrit Barthes[38]. Une « folie » (« le regard est toujours virtuellement fou »[39]), en tout cas une fiction introspective réservée dans le rapport aux images. Ni discours du savant, du critique, de l’historien, et encore moins du professionnel, le Spectator invente le regard photographique en tant que regard qui se porte sur des photos. Il sera formulé d’une manière proche bien que différente par Hervé Guibert : « Le regard photographique est une espèce de fétichisme de la vue : une seconde fovéa à l’intérieur de la fovéa, un enfant monstrueux, un abîme minuscule, un super concentré (trop riche, trop sucré ou trop aigre) »[40]. L’excès chez Guibert répond à la folie chez Barthes dans le constat identique d’une intensité anormale du regard lorsqu’il s’attache à une photo : selon les deux auteurs, la Photo requiert chez le regardeur une activité singulière, insolite… spécifique.
Cette posture devant les images n’a de fait à voir ni avec l’art ni avec quoi que ce soit d’autre de connu dans le discours sur l’art, mais ce pourrait être une esthétique :
(soit dit en passant, l’esthétique, comme discipline, pourrait être cette science qui étudie, non l’œuvre en soi, mais l’œuvre telle que le spectateur, ou le lecteur, la fait parler en lui-même : une typologie des discours, en quelque sorte). [41]
Telle que le Spectator barthésien la fait parler en lui-même, dans cette fiction, la Photographie révèle quelque chose de spécifique, qui traverse indifféremment toutes les sortes d’images, chefs d’œuvres comme clichés de famille : la Photo peut toucher pour des raisons incessibles, retenir le regard en contemplation ou sidération sans que rien ne puisse objectivement le justifier (si, pour telle image, cela peut s’expliquer par le talent d’un auteur, ce sera ailleurs très différemment la tendresse que le Spectator a pour tel sujet, etc.). Cette variabilité essentielle de l’intérêt que peut susciter la Photographie, Barthes la rassemble dans cette fiction théorique, sous le regard de son narrateur.
Il était nécessaire, pour apporter ce personnage conceptuel à la théorie de la photographie, de se débarrasser de tous les autres discours bloqués par la diversité des images de l’art, du photojournalisme, du documentaire, des pratiques amateur. Le Spectator indifférent à la culture des sujets, des intentions, des discours, des normes, autorise (au sens le plus fort du terme) la fédération de toutes ces singularités que la photographie recouvre, et qui faisaient son aporie.
Si cela n’apporte certes pas grand-chose aux photographes[42], il n’en reste pas moins que naît avec le Spectator une figure structurale de la photographie, essentielle en ce que par comparaison, ni l’amateur de peinture ni le spectateur de cinéma ni le lecteur de bandes dessinées ne peut entretenir un rapport si affranchi des gestes ou des intentions des auteurs (s’interrogeant sur son désir, il cherchera du côté du faire : des acteurs, du mouvement de caméra, de la couleur ou du tracé). Lorsque Barthes écrit sur Twombly, peu avant, on l’a dit, qu’il rédige La Chambre claire, c’est le corps du peintre qu’il imagine, en train de produire les traces qui feront l’œuvre. Mais la photo est toujours pour le narrateur sans corps de photographe. Jamais la scène de la photographie n’est évoquée, qui pourtant de façon aussi certaine que la réaction chimique a rassemblé le sujet de la photo et l’Operator[43] : comment dans les portraits, ces incontestables échanges entre individus, n’envisage-t-il jamais cela ?
Il n’y a qu’une seule exception – bien sûr, toujours la même – pour laquelle le narrateur fait apparaître le photographe dans la scène de la prise de vue (qu’il appelle, lui, la pose) : « l’obscur photographe de Chennevières-sur-Marne » parle à la mère enfant : « […] on sentait que le photographe lui avait dit : « Avance un peu, qu’on te voie » ; elle avait joint ses mains, l’une tenant l’autre par un doigt, comme font souvent les enfants, d’un geste maladroit. »[44]
Le photographe de la Photographie du jardin d’hiver est ainsi le seul photographe à qui la parole est donnée dans La Chambre claire, au discours direct, dans un tout petit récit enchâssé au plus-que-parfait, le seul à avoir un corps, une intention, une voix : une existence devant le sujet qui ne soit pas celle du Spectator. Cette micro-fiction exceptionnelle déplace le narrateur, qui n’est en fait plus le Spectator (celui de la naturalité de la photo) mais le regardeur qui envisage, en plus de sa propre position devant l’image, celle du photographe sur la scène de la photographie, devant la personne ou la scène qui a lieu et aura disparu. Cette distance est cette fois-ci spatiale et non plus seulement temporelle (qui fait comme on sait le sujet obsédant de La Chambre claire – à cette unique exception près) ; elle constitue le déchirement de « l’image juste » : l’épreuve de cet irrattrapable ratage que Barthes observait en peinture mais jamais en photo, lorsqu’il s’adressait directement à Cy Twombly : « mon corps ne sera jamais le tien ». Sans doute est-ce le deuil qui justifie qu’exceptionnellement le narrateur barthésien envisage un corps différent du sien devant la photo, sur la scène même de la photo : un photographe et non plus un Operator ; il ne s’envisage plus lui-même en Spectator mais en regardeur, c’est-à-dire à la fois devant la photo faite et à faire, deux fictions incompossibles.
Conclusion
C’est certes encore le rapport au réel à l’état passé qui amène Barthes à se figurer exceptionnellement le personnage du photographe, à envisager celui qui a été face à la mère enfant pour lui parler, à qui déjà elle offrait cet « air » que le narrateur aimait. La singularité absolue de la Photographie du jardin d’hiver dans le livre se distingue encore ici d’autre manière, en ce que le narrateur constate que si « la voyance du photographe ne consiste pas à ”voir” mais à se trouver là »[45], cette co-présence à l’état passé résonne cependant dans le deuil de façon singulière, elle fait écho à cette autre fatalité qu’est la singularité des corps : le corps du regardeur ne sera jamais celui du Photographe ; le Spectator prend la parole seul, de son côté. Le discours à part et solitaire qu’il tient sur la Photo-sans-le-photographe défait de fait les liens actuels, de regard et de sociabilité qui fondent la photographie, au profit d’une Nature dépourvue même d’imaginaire, hors celui que le Spectator voudra bien projeter, c’est-à-dire le prétendu réel. Le « Ça a été » de la deuxième partie est le versant positif d’un « Je n’étais pas là » irrécupérable, constat clinique de la dépression (« Pourquoi est-ce que je vis ici et maintenant ? »[46]) et gauchissement temporel au sujet de la photographie d’une définition générale de l’image qui de toute façon était déjà à distance et sans auteur : « l’image, c’est ce dont je suis exclu »[47].
La Photo-sans-le-photographe est ainsi un tour de force de Barthes pour écrire son deuil, solitude redoublée de l’irrécupérable du Temps. Loin des questions contemporaines de photographie, d’art, de reconnaissance des auteurs, le roman n’en dessine pas moins, on l’a vu, une figure esthétique de la photographie, une forme d’usage qu’on n’avait pas encore théorisée (qui n’existait pas avant elle et la diversité de ses images) : celui qui regarde des photos, indépendamment du souci de leur origine.
Le regard photographique s’apparente de fait à la lecture, autre pratique que Barthes a décrite en littérature, aux côtés de la critique et de la science[48] : comme le lecteur, le Spectator seul « aime l’œuvre, entretient avec elle un rapport de désir. Lire [ou regarder une photo], c’est désirer l’œuvre, c’est vouloir être l’œuvre »[49] – hors toute pertinence de l’idée de sa production. Dans ce paradigme où la littérature voyait son prestige social s’abolir pour devenir l’écriture, la Photo prise hors la question de l’art et des auteurs, peut devenir le nom des objets variés du désir de celui qui les regarde.
Il demeure intéressant que Barthes, pour la photographie, ait eu recours au mythe de la Naturalité des images (il ne pouvait guère en faire de même avec l’écriture et ses symboles) : avec ses signes naturels, ses faits de réel, la Photo-sans-le-photographe continue le discours de la doxa, mais l’auteur y découvre la singularité quelconque du regard sensible qui se porte sur les photos.
NOTES
[1] Roland Barthes, « Sur la photographie », entretien avec Angelo Schwartz, (Le photographe, février 1980), Roland Barthes et la photo. Le Pire des signes, Contrejour, 1990, p.77.
[2] Ibid.
[3] Ibid
[4] « j’ai une maladie : je vois le langage », Roland Barthes par lui-même, Seuil, coll. « Ecrivains de toujours », 1975, p.141.
[5] Je me permets de renvoyer ici à mon étude « Le roman du regardeur en 1980 (Barthes, Guibert) », in L. Louvel, D. Méaux, J.-P. Montier, Ph. Ortel (dir.) Littérature et photographie, PUR, 2008.
[6] Mythologies, Seuil, 1964.
[7] Voir Magali Nachtergael, Mythologies individuelles. Récit de soi et photographie au 20e siècle, Rodopi, coll. Faux titre », 2012.
[8] « […] en moi quelqu’un de très ancien entend encore dans l’appareil photographique le bruit vivant du bois. », La Chambre claire, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980, p.33
[9] Ibid., p.126.
[10] François Brunet, La naissance e l’idée de photographie, PUF, 2009. Voir en particulier le chapitre intitulé « L’image a-technique ».
[11] William Henry Fox Talbot publie ainsi le premier livre illustré de calotypes sous le titre The Pencil of nature (1844).
[12] Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique (1939), trad. F. Joly, Payot, 2013.
[13] Voir Agathe Gaillard, Mémoires d’une galerie, Gallimard, coll. « Témoins de l’art », 2013.
[14] Voir Robert Pujade, Art et photographie. La critique et la crise, L’Harmattan, 2005 ; Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux, Histoire de la critique photographique, Scala, 2017.
[15] « Tels », Photo, janvier 1977, Œuvres Complètes tome 3 (éd. E. Marty), 2002, p.691.
[16] « […] cette rage de « faire vivant » ne peut être que la dénégation mythique d’un malaise de mort », La Chambre claire, op. cit., p. 56.
[17] « Tels », art. cit., p.691.
[18] Voir Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV, Seuil, 1984.
[19] « Tels », art. cit., p.691-692.
[20] « Note sur un album de photographies de Lucien Clergue », Sud (Marseille), février 1980, repris in Roland Barthes, Œuvres, tome 3, p.1203.
[21] « Bernard Faucon, Zoom, octobre 1978, repris dans Roland Barthes, Œuvres 3, p.837-839.
[22] « Bernard Faucon, art. cit., p.837.
[23] William Klein, « Sur deux photos de William Klein, Roland Barthes et la photo. Le pire des signes, Contrejour, 1990, p.30.
[24] La Chambre claire, op.cit., p.5.
[25] De fait l’invention d’un art, avec histoire et théorie, passe par l’invention de ses noms d’artistes. Voir par exemple Histoire de l’agence Magnum. L’art d’être photographe, par Clara Bouveresse (Flammario, 2017) qui montre comment se construit la figure d’un auteur.
[26] La Chambre claire, op. cit., p.74.
[27] Hervé Guibert suppose que Barthes a été intimidé comme tous les autres critiques (comme lui) : « Il est significatif que des gens comme Susan Sontag ou Roland Barthes, qui écrivent sur la photographie n’aient pas eu envie d’écrire une ligne sur Cartier-Bresson, ou plutôt se soient esquivés, comme intimidés. », « Un livre et une exposition d’Henri Cartier-Bresson. La conscience et l’émotion », Le Monde, 5 mars 1980, repris dans La Photo, inéluctablement, Gallimard, Nrf, 1999, pp.195-197. Cet article suit celui sur la parution de La Chambre claire, publié la semaine précédente (« Roland Barthes et la photographie : la sincérité du sujet », Le Monde, 28 février 1980, repris dans La Photo, inéluctablement, op.cit., p.193-195.) On peut supposer aussi que citer une photo de l’étalon-mètre de la photographie à cette période ne pouvait pas s’imaginer sans au moins une remarque sur la composition de l’image, ce qui est précisément le type de discours qu’évite Barthes dans le livre.
[28] Le choix de cette photo de 1893 semble aussi faire écho à la mort de Nietzsche qu’il évoque à la fin du livre, p.179, donnant à voir à peu près à la même époque, les chevaux en ville dans la neige, comme le décor de l’événement : « lorsque le 3 janvier 1889, [Nietzsche] se jeta en pleurant au cou d’un cheval martyrisé – devenu fou pour cause de Pitié. ».
[29] « […] la prouesse : ”Depuis un demi-siècle, Harold D. Edgerton photographie la chute d’une goutte de lait au millionième de seconde” (à peine besoin d’avouer que ce type de photo ne me touche ni même ne m’intéresse : trop phénoménologue pour aimer autre chose qu’une apparence à ma mesure) » Ibid, pp.58-59.
La galeriste Agathe Gaillard le décrit la même époque : « Harold Edgerton était un scientifique, inventeur du stroboscope et du flash électronique. Il faisait des photos pour montrer ce qu’on pouvait faire avec ses appareils, et comme il avait beaucoup de fantaisie et de talent, ses photos étaient formidables mais elles n’étaient considérées que comme des expériences scientifiques. Alors j’ai fait cette exposition Edgerton, polémique parce que si certains trouvaient que c’était magnifique, d’autres trouvaient que c’était scientifique et qu’Edgerton n’était pas un artiste. », « Agathe Gaillard – 1975, rue du pont Louis-Philippe », entretien du 12 octobre 2017 avec AC Guilbard, transcrit par Héloïse Morel, L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, 9 juin 2020, en ligne : https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/agathe-gaillard/
[30] Christian Caujolle, « Le temps de la couleur », in M. Falguière et Ch. Caujolle, Daniel Boudinet. Le temps de la couleur, ed. du Jeu de paume/Charenton le pont, 2018, p.19-24.
[31] Roland Barthes, Cy Twombly, Seuil, coll. Fiction et compagnie, 2016 (Les textes datent respectivement de 1976 et 1978).
[32] Voir Richard Leeman, « Roland Barthes et Cy Twombly : ”le champ allusif de l’écriture” », Roland Barthes après Roland Barthes (dir. F. Gaillard et F. Noudelmann), Rue Descartes n°34, 2001/4, pp. 61-70. Accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2001-4-page-61.htm#
[33] Au Château de Tours, organisée par Mathilde Falguière et Christian Caujolle en 2018. Voir le catalogue édité par les mêmes : Daniel Boudinet. Le temps de la couleur, ed. du Jeu de paume/Charenton le pont, 2018.
[34] J’ai montré ailleurs que l’œuvre de Daniel Boudinet était en contradiction avec la thèse développée par Roland Barthes : ce dernier ouvre en effet son livre sur la photographie par l’illustration d’un paradigme (le temps, la couleur, l’image) qui ne sera jamais le sien. Cf. « Occupation des chambres photographiques », à paraître dans La Chambre, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, (dir. P. Hyppolite) coll. « Architecture, littérature, espace ».
[35] Mathilde Falguière, « Daniel Bodinet et Roland Barthes : des œuvres en résonnance », Daniel Boudinet. Le Temps de la couleur, op. cit., p.32-36.
[36] Tiphaine Samoyault écrit : « Le seul texte qu’il écrit à cette période est celui qui accompagne les photos de Daniel Boudinet et ses paysages déchirants à force d’être paisibles. […] ”Les photographies de D. B. sont très musicales. Elles ont un effet d’apaisement, opèrent une sorte de catharsis subtile, jamais violente : le corps respire mieux.” », Roland Barthes, Seuil, coll. « Fiction & compagnie », 2015.
[37] Les plus récents, contemporains, sont William Klein et Robert Mapplethorpe.
[38] La Chambre claire, op. cit. p.175.
[39] Ibid.
[40] Hervé Guibert, L’Image fantôme, Les Editions de Minuit, 1981, p.110.
[41] « Sagesse de l’art » (sur Cy Twombly, 1979), Œuvres III, Seuil, p.1030. Repris dans Roland Barthes, Cy Twombly, op.cit.
[42] Hervé Guibert, dans le compte-rendu qu’il publie dans Le Monde à la sortie du livre, constate que « les photographes n’apprendront pas grand-chose. », « Roland Barthes et la photographie : La sincérité du sujet », art.cit., p.195.
[43] Ainsi, parmi les plus intelligents inventeurs de la critique photo française, au Monde à partir de 1977, Hervé Guibert joue parfois de fictions qui mettent en scène le photographe sur la scène de la photographie. Par exemple, à propos de Jacques-Henri Lartigue : « […] l’homme s’est levé pour prendre la photo. Il a eu le sentiment de l’exception de cet instant, il sait bien qu’au bout du compte, la vie n’est faite que de ces instants-là […] », « Lartigue le sidérant », Le Monde, 5-6 octobre 1980, repris dans Hervé Guibert, La Photo, inéluctablement, Gallimard, Nrf, p.245.
[44] La Chambre claire, op. cit., p.106.
[45]Ibid., p.80.
[46] Ibid., p.131.
[47] « Les images », Fragments d’un discours amoureux, Seuil, 1977.
[48] Voir la fin de Critique et vérité, Seuil, 1966.
[49] Ibid., dernière page.