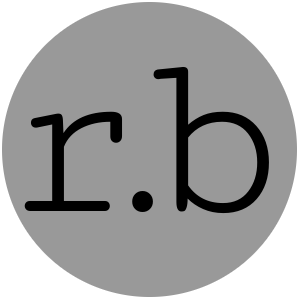« Ce que j’aime au fond, c’est le rapport de l’image et de l’écriture,
qui est un rapport difficile, mais par là même qui donne de véritables
joies créatrices, comme autrefois les poètes aimaient travailler à des
problèmes difficiles de versification.
Aujourd’hui, l’équivalent, c’est de trouver un rapport entre un texte
et des images. »
Roland Barthes[1]
I Introduction : « double saisie » photographique
A part le travail de collaboration au Canada sur des images cinématographiques de la Lutte[2], je ne connais pas de véritable intervention directe de la part de Roland Barthes dans le travail avec des images, ni dans le cinéma ni surtout avec des photographes avec qui il aura néanmoins collaboré. De Pic à Boudinet, Martin à Roche, Bouvier à Bouvard, Faucon à Clergue, il y a clairement une ligne « artistique » au-delà de laquelle le Barthes « du regard » ne voulait pas aller ; et cette observation n’oublie évidemment pas les photographes plus éloignés (Avedon, Klein). Concernant ou photographie de circonstance, ou photographie d’auteur, le photo-textualisme barthésien n’a jamais eu de prétentions de collaboration directe avec l’operator de l’appareil. Cet article va donc traiter un exemple de ces deux catégories : d’abord, l’iconographie photographique du théâtre, anonyme ; et ensuite la collaboration « propre » avec Roger Pic sur le théâtre de Bertolt Brecht. Cette « double saisie » – expression d’abord attachée par Barthes en 1954 à l’historiographie du « magistrat » Jules Michelet[3] – est à appliquer à Barthes à son tour, afin de suggérer que sa non-intervention dans l’acte photographique de ses collaborateurs est équilibrée par son intervention langagière, aussi lapidaire qu’acerbe, ce qu’est la légende située à côté, physiquement, du cliché photographique.
C’est une étude de légende, donc, que nous entreprenons, dans sa dynamique avec l’image photographique juxtaposée, analyse fine qui doit fouiller dans les versions originales de l’œuvre de Barthes[4]. A ce propos, c’est peut-être un espoir pieux, vain, de vouloir voir incluse dans une nouvelle version éventuelle des Œuvres complètes de Roland Barthes toute l’iconographie – surtout photographique – qui accompagnait des articles variés et éparpillés dans des journaux, des revues et des magazines. Ce désir est d’autant plus fondé par rapport à un théoricien de la critique comme Barthes, pour qui la culture de masse d’après-guerre serait définie même par l’arrivée des images. Dans une « petite mythologie du mois » en février 1955, il opina :
Je ne sais si l’on a déjà analysé le pouvoir idéologique des représentations standardisées ; indépendamment des mythes transportés, il y a de toute évidence une morale de la photographie qui devrait intéresser les sociologues. […] [L]a technique n’accède à l’Histoire que du jour où elle est prise en charge par le commerce, et en quelque sorte aliénée par un usage collectif. […] Le fait historique correspondant, c’est la naissance du magazine illustré, sa diffusion massive, la promotion du visuel comme véhicule de mythes – alors que les masses n’avaient connu pendant des siècles que la forme orale de leurs songes[5].
Le rôle de l’image, en général, et la photographie en particulier, est donc à souligner chez le jeune Barthes des années 1950. Cette opinion est importante non seulement pour compléter, sinon justifier, les points de vue du jeune militant du théâtre populaire, premier théoricien en France du « système brechtien » ; mais aussi pour comprendre les conditions dans lesquelles Barthes aura commencé sa carrière de photo-textualiste. Roger Pic, né en 1920 et photographe célèbre du Théâtre National Populaire (TNP), avait milité dans « Travail et Culture » – tout comme l’éminence grise de Théâtre Populaire, Robert Voisin – et c’est le premier photographe avec lequel aura travaillé Barthes. Avant d’y passer, toutefois, il convient d’abord de considérer dans son œuvre le premier exemple d’une interaction texte-image photographique.
II Légende et costume
La lacune des illustrations photographiques dans les reproductions de l’œuvre de Roland Barthes se présente le plus autour de la photographie par rapport au théâtre. La version originale dans la revue Théâtre Populaire de son essai de 1955, « Les maladies du costume de théâtre », à la différence de la version recueillie dans Essais critiques en 1964[6], déploie des images photographiques, complétées par ses légendes critiques, pour illustrer ses commentaires sur le mauvais – et, à moindre degré, le bon – costume de théâtre. C’est très probablement le premier « photo-texte » de Barthes, du moins le premier à lier commentaire (ici, critique) à des images photographiques.
N’empêche que le mois avant ce texte pionnier sur le costume dans le numéro de printemps 1955 de Théâtre Populaire, comme on a vu dans la citation ci-dessus prise dans sa « petite mythologie du mois », Barthes venait de commenter les représentations photographiques des enfants dans la presse[7]. Mais ces essais mythologiques ne sont pas illustrés (et on pourrait dire la même chose pour le jeune Africain en train de saluer qui est la base de sa critique de la couverture de Paris-Match, dans « Le mythe, aujourd’hui » qui clôt Mythologies en 1957, photographie qui, elle, n’est pas reproduite non plus) : heureusement, nous pouvons nous référer à l’extraordinaire et fastidieux travail de Jacqueline Guittard qui a complété l’iconographie derrière Mythologies dont nous avions grand besoin[8].
Mais c’est la première version de son article pionnier sur le costume qui est frappant par l’accompagnement photographique, illustrateur, doublé par des légendes aussi lapidaires qu’humoristiques[9]. Il s’agit d’une douzaine de portraits d’acteurs variés dans des costumes de théâtre. Dans ses légendes laconiques mais souvent humoristiques, Barthes « nomme » ou la faute ou bien l’habileté du costume figuré dans chaque image photographique. Le nom de chaque photographe n’est jamais donné, tandis qu’acteur et dessinateur de costume sont souvent signalés. Dans une série de double-pages, figurant une iconographie photographique soigneusement mise en page dans Théâtre Populaire, Barthes commence ainsi un travail de légender très particulier, ses oppositions sérieuses (costumes sains contre les malades, pour ainsi dire) doublées par un humour lancinant. Contre l’acteur en tenue complète de hibou (Chantecler, de 1910, Le Grand-duc dont le costume est dessiné par M. Dorival) – est résumé de façon lapidaire et spirituelle par : « L’absurde vériste : l’acteur assassiné par le costume ». Barthes y oppose le portrait de Gérard Philipe dans Lorenzaccio paré dans le costume de Léon Gischia avec la légende suivante : « Le bon costume est un fait visuel global »[10]. C’est une critique du vérisme qui reviendra en 1959 et 1960 comme un des arguments principaux en faveur des images de Roger Pic qui révèlent de façon claire le « réalisme » dans le théâtre et la « bonne » mise en scène de Brecht, contre le vérisme « romantique ». Et, en 1955 déjà, c’est la dramaturgie et la scénographie brechtiennes par rapport au costume qui l’inspire.
Barthes présente deux costumes qui, pour lui, ne sont pas « malades » : celui de Mère Courage qui traîne la carriole dans la version du Berliner Ensemble de 1954, dont le costume est dessiné par Heinrich Kilger. « Le costume, écrit-il en dessous de la photographie, doit convaincre avant de séduire, dans la guerre interminable »[11]. Cette image est suivie de « Le costume-substance : laine et féodalité », sa description laconique du costume de Mario Prassinos pour Jean Vilar dans Macbeth[12]. Ces deux succès dans les costumes sont à contraster ensuite avec deux exemples de costumes « malades ». Pour le Cinna à la Comédie-Française, les costumes des deux personnages principaux figurés dans la photographie (dont le pauvre dessinateur n’est pas nommé) sont excoriés par la légende de Barthes de la façon suivante : « La maladie esthétique : le drapé grand couturier ». Également pour la légende pour l’acteur dans la version du Crépuscule des Dieux montée au théâtre du Château-d’Eau en 1902 : « Le ‘Musée Dupuytren’ du costume de théâtre : le Baroque 1900[13] ». C’est la maladie – plutôt que la bonne santé – du costume qui commence à gagner dans les choix des exemples qui sont de plus en plus ridiculisés dans les légendes de Barthes.
Ainsi, pour l’actrice en costume de fruits dans Les Barbares (tragédie lyrique de 1901), l’humour lapidaire de Barthes est acerbe : « la littéralité ; raisins – bacchantes ». Avec un même humour critique, il revient à la mise en scène du Crépuscule des Dieux, pour regretter que le costume de l’actrice figure « l’indigence : la chemise de nuit wagnérienne » ; et à celle de Chantecler de 1910 avec le costume porté par Mme Simone dans le rôle de la Faisane : « la surindication : des tonnes de plumes » ; finalement, pour terminer les légendes de cette page de Théâtre Populaire qui est un montage de photographies d’acteurs, la reine Elisabeth et son consort dans Marie Stuart (aux Folies Bergère), voici la légende de Barthes lancinante : « le déséquilibre : clarté des formes, maniérisme des substances ».
Heureusement, après cette raz-de marée des costumes de théâtre « malades », Barthes termine l’iconographie par « Le Cid déifié et le Cid déguisé », celui de Gérard Philipe au TNP et celui d’André Falcon à la Comédie-Française. Cependant, c’est la toute dernière – de Gérard Philipe encore dans Lorenzaccio au TNP – qui frappe, car l’image, gros plan, du Lothario Philipe, en tenue de Lorenzaccio, impulse cette légende courte de Barthes : « L’accord du visage et du costume »[14]. Pour l’amateur des visages des acteurs[15], ce portrait photographique (anonyme, paraît-il) montre le lien entre figure et costume, sinon un intérêt pour la jeunesse dans la photographie des années 1950[16].
III Brecht et un théâtre politique
« [Le] contenu et [la] photogénie des images, [le] discours
qui les justifie, vise[nt] à supprimer le poids déterminant
de l’Histoire : nous sommes retenus à la surface d’une identité,
empêchés par la sentimentalité même de pénétrer dans cette zone
ultérieure des conduites humaines, là où l’aliénation historique
introduit de ces ‘différences’ que nous appellerons tout simplement
ici des ‘injustices’. »
Barthes, « La grande famille des hommes[17] »
Les origines, au moins explicites (si on peut dire cela pour des images qui sont montrées à côté de ses écrits), de la sensibilité barthésienne à la photographie, se retrouvent dans le théâtre[18], et surtout, chose peu surprenante, par rapport au théâtre de Brecht. Le premier exemple que j’ai pu trouver de ce lien Brecht-photographie, c’est la critique courte mais élogieuse que Barthes signe en mai 1956, dans l’hebdomadaire de gauche France-Observateur, de la mise en scène de Grand’Peur et Misères du IIIe Reich de Brecht, montée par Roger Planchon à Lyon[19].
Ce qui frappe dans cet article, en plus de l’engagement envers Brecht et le théâtre de Planchon – Barthes le trouvait difficile de voir la pièce « sans penser à l’Algérie, à la France de Poujade » – c’est l’illustration photographique qui trône l’article[20]. C’est une image de deux détenus en costume « pyjama rayé » typique des camps de concentration, qui sont en fait de deux boulangers déportés en train de faire le travail physique dur ; l’image frappante est accompagnée par une citation de la pièce, un échange entre ces deux victimes des Nazis :
- Pourquoi as-tu été déporté ?
- Je mettais du son dans ma farine. Et toi ?
- Je ne mettais pas de son dans ma farine…
Avec cette légende-citation, aussi lapidaire que dynamique, aussi économique que parlante, Barthes aura capturé le sens profond, y compris l’humour noir de la pièce antifasciste de Brecht, « un théâtre qui prend la politique au sérieux, […] dans un rapport politique profond avec une situation historique concrète […] ; enfin un théâtre critique, qui oblige le spectateur à se retourner sur sa propre situation [.][21] » ; et le tout écrit neuf jours avant le « tournant » dans la guerre coloniale en Algérie du 19 mai 1956. Il est souvent suggéré que le théâtre français fut très lent à réagir à cette guerre sanglante – les pièces de Genet, Sartre, Vinaver n’arrivent que très tard – voilà un petit morceau de Barthes au bon moment qui, de façon calme mais poignante, s’engage contre le conflit.
Cependant, c’est la collaboration deux ans plus tard avec le photographe de théâtre Roger Pic qui souligne son engagement contre la guerre, pour le théâtre de Brecht. Pic travaillait pour le TNP depuis ses débuts en 1951, produisant des records photographiques des mises en scènes y compris de la mise en scène de la pièce de Brecht Maître Puntila et son valet Matti[22]. Mais il s’agit, en 1959, de la seconde représentation à Paris par le Berliner Ensemble en 1957 (au Théâtre des Nations, 8 et 9 avril 1957) de Mère Courage, représentation qui, selon Bernard Dort, contrastait fort avec l’autre spectacle de Brecht qui l’accompagnait en 1957, La vie de Galilée[23]. La scénographie de Mère Courage en 1957 qui a tant impressionné Dort tenait à sa nudité, à sa neutralité et à ses lumières blanches et fortes – « un photographe dirait : surexposée » a opiné Dort[24]. Cette opinion est renforcée par le fait que Pic est, selon Chantal Meyer-Plantureux, « instigateur d’une nouvelle photographie de théâtre qui abandonne pose et flash pour restituer la mise en scène dans toutes ses composantes – le jeu des acteurs, les objets, le décor – avec les lumières du spectacle », favorisant ainsi « le regard critique du photographe qui recense avec méthode les éléments du spectacle pendant son déroulement »[25]. Les deux essais que Barthes « s’est plu à donner de ces très belles photos » indiquent à Dort leur statut de « [v]éritable Janus, multipliant les modes de représentation […] [en regardant] à la fois vers le passé (le théâtre, Brecht) et l’avenir (la photographie en général) »[26].
Les deux textes de Barthes qui accompagnent le travail photographique de Pic sur cette deuxième mise en scène à Paris par le Berliner Ensemble de Mère Courage – « Sept photos modèles de Mère Courage » publié dans Théâtre Populaire en 1959 et « Commentaire : Préface à Brecht, Mère Courage et ses enfants (avec des photographies de Pic) », volume publié par L’Arche en 1960 – sont clairement ancrés sur le record photographique pris par Pic, déployant tous les deux sept images pour illustrer ses propos sur le jeu et la scénographie du théâtre épique[27]. Dans le premier essai en 1959, ses commentaires sur le gestus brechtien portent uniquement sur sept images qui sont toutes « prises dans l’action du premier tableau »[28] ; dans le deuxième, encore sur seulement sept images de Pic, celles « qui ne sont nullement apprêtées[29] » et prises ici et là dans la représentation. Mais, même si les propos varient en quelque sorte et les images ne se répètent que légèrement entre les deux textes, l’approche barthésienne à l’iconographie photographique de Pic est toute une ; son essayisme, avec de rares légendes, recouvrent les images montrées en les mobilisant dans un argument autour du jeu brechtien de distancement, de gestus et de « sa fonction mercantile ». C’est une approche qui, selon Georges Didi-Huberman, exclut le pathétique, en sacrifiant la solidarité pour le détail, le formalisme pour l’affectivité ; dans une espèce de « mime théorique » du distancement brechtien, Barthes « va mettre en œuvre le déplacement de son propre regard[30] » ; si ceci est « le but légitime de diviser l’évidence de la représentation », le problème n’est pas là pour Didi-Huberman ; c’est plutôt le fait que Barthes ne dit rien du cri de Mère Courage lorsque, devant le corps de son fils, elle « éclate », que Barthes décrit « cruellement » son émotion comme « insignifiante » ; pour Didi-Huberman, une « socialité théorique » c’est le prix à payer si on privilégie une « visualité saturée d’intelligence » au détriment de la « ‘sur-signification’ pathétique[31] ». Nous reviendrons à ce détachement perçu, à « l’intelligence » des images de Pic, dans notre conclusion.
Cette approche (mettons) « détachée » dans les deux articles de Barthes sur Pic est à contraster, toutefois, avec celle prise dans une troisième version, « l’édition illustrée » – jamais mentionnée d’après mes recherches –, qui montre comment Barthes intervient directement dans le récit photographique que Pic avait fait de Mère Courage. C’est une intervention qui va nuancer de beaucoup la critique de « l’intelligence ».
IV Pic et Barthes, « édition illustrée »
Sous Robert Voisin, compagnon de route du Parti Communiste Français, les éditions de l’Arche est l’éditeur français de l’œuvre de Brecht, ainsi que l’employeur de Barthes entre 1954 et 1956 pour son rôle dans la préparation des numéros de Théâtre Populaire. En plus des pièces de Brecht en traduction française, l’Arche avait republié en 1954 son Petit organon et, dans la même collection, le petit essai de Geneviève Serreau[32]. Le travail de Geneviève Serreau sur Brecht, surtout avec Benno Besson – ami et collaborateur proche du dramaturge allemand – va jusqu’à une concentration sur les mises en scène du Berliner Ensemble[33]. Leur Mère Courage et ses enfants : chronique de la guerre de trente ans en douze tableaux, publié par l’Arche en 1957, comprend la traduction française de la pièce de Brecht par Serreau et Besson de 1951[34]. C’est la réédition de ce texte en 1960, augmentée de sept photographies de Pic de la représentation de la pièce à Paris en 1957, à laquelle Barthes contribue par sa « préface », cette « préface » étant préfigurée par l’article « Sept photos modèles de Mère Courage » publié dans Théâtre Populaire en automne 1959. Toutefois, perdue peut-être dans le déluge de textes brechtiens à ce moment de la montée en flèche en France du dramaturge allemand, est une troisième intervention de Barthes. A la différence de toutes les versions des textes figurant les images de Pic de la mise en scène de Mère Courage par le Berliner Ensemble en 1957, c’est ce volume en grand format, « l’édition illustrée », somptueuse même, publiée par l’Arche en 1960 et comprenant cent photographies de Pic, qui est le plus important pour notre argument ; car le volume contient une « postface » de Roland Barthes – et non pas « préface » – qui s’appelle elle aussi « Commentaire »[35]. Ce « Commentaire Postface » est identique à celui publié dans « la collection du répertoire », « Commentaire : Préface à Brecht, Mère Courage et ses enfants (avec des photographies de Pic) » mentionné ci-dessus. Si les deux « Commentaires » (version préface et version postface) sont identiques, le « Commentaire Postface » suit les cent images de Pic et qui, elles, sont accompagnées de de nombreuses légendes : c’est notre assertion que ces légendes, inédites, sont de la main de Barthes[36].
Si le « Commentaire Postface » dans « l’édition illustrée » ne diffère nullement du « Commentaire Préface » dans la collection du répertoire – et ne jouit même pas de la belle mise en page avec des sept images – la « Postface » est néanmoins encore plus riche car elle suit et se réfère directement au travail de légende à côté des cent images de Pic qui la précèdent. En effet, Barthes le dit dans « Sept photos modèles » : « nous serons bientôt en possession, écrit-il au début de son article, d’une véritable histoire photographique de Mère Courage […] [grâce à] [c]ette suite de photographies (une centaine environ) »[37]. Ces cent images n’existant pas dans la version de la « Préface » de Barthes – les sept images n’étant que parcimonieusement choisies dans la « petite » version de la pièce de Brecht dans « la collection du répertoire » – c’est la version grand format, « l’édition illustrée », qui les révèle. Et c’est ce qui indique l’intervention directe, la collaboration étroite de Barthes, avec les images de Pic.
Préfigurant le travail que Barthes fera au Québec avec Hubert Aquin en 1961 sur les sports et ses images photographiques et télévisées[38], le commentaire sur les images du Berliner à Paris ne se restreint pas à un essai à part dans le « Commentaire Postface », mais aussi, semble-t-il, la plume de Barthes intervient dans le déroulement même des images photographiques de Pic. Et on peut conjecturer que c’est par la main de Barthes que les légendes sont écrites et organisées, pour plusieurs raisons. D’abord, il suffit de lire la publicité pour « l’édition illustrée de Mère Courage », ce « spectacle dans un livre », que met l’Arche sur la quatrième de couverture du numéro 40 de Théâtre Populaire en 1960 :
Deux chefs-d’œuvre : le texte intégral de la pièce (version française de Geneviève Serreau et Benno Besson), et le spectacle du Berliner Ensemble (mise en scène de Erich Engel et Bertolt Brecht) : 100 photographies de Roger Pic, présentées et commentées par Roland Barthes[39].
Ce beau volume – sous reliure et jaquette, au grand format 15cm x 21cm – comprend (pour citer encore ce mot de Barthes) « [c]ette suite de photographies (une centaine environ) » de Pic, et qui sont non seulement « commentées » mais aussi « présentées » par Barthes. Qui plus est, la légende qu’il attache dans le premier des deux autres commentaires sur les photographies de Pic, « On est dans le commerce » (qui est une citation prise dans la pièce de Brecht) – comparer l’image de Pic du début de la pièce montrant l’arrivée de Mère Courage et de sa famille en carriole qui est presque identique dans les deux textes de 1959 et 1960, « Sept photos modèles de Mère Courage » et « Préface »[40] – se déploie aussi pour l’image similaire dans la « suite » de cent photographies précédant la « Postface » dans « l’édition illustrée »[41]. Ensuite, le numérotage des photographies dans « Préface » suggère une intervention directe mais qui est, ici, minorée par rapport à la nature extensive dans « l’édition illustrée ». Finalement – et c’est peut-être un des points les plus importants pour la future carrière de Barthes dans ses actes « stéréographiques » (pour citer S/Z) – toute écriture (essayiste, commentateur, légendeur ou autre) est une « citation » ; toute écriture – le Barthes des années 1960 va insister de plus en plus là-dessus – est du déjà écrit[42]. C’est l’acte d’attacher des citations de Brecht, à maintes reprises comme on va le voir, aux images photographiques de Pic figurant le moment de ces citations par des personnages de la pièce qui va, sans doute, suggérer à Barthes la primordialité de la citation dans l’acte d’écrire ; c’est ce même acte de collaborer avec la photographie dans le déroulement même de la pièce – en appendant des citations venant de cette même pièce – qui marque l’activité barthésienne de légender les images de Pic en 1959 et 1960.
Ce qui frappe dans cette collaboration extensive, c’est la nature directe de l’activité de Barthes. Dans son analyse fine de « Sept photos modèles », Jim Carmody souligne en 1990 que non seulement Barthes ne montre que sept des cent images de Pic, mais aussi que tout le texte écrit de Barthes semble passer à côté des images de Pic sans les commenter vraiment[43]. Cette opinion va à l’encontre toutefois de ce qui s’était passé dans la collaboration vraie à l’époque ; et c’est peut-être Barthes, dans son toilettage après-coup, qui a encouragé une perception possible de ce détachement de l’essayiste. En effet, le travail de légende pour les cent images de Pic dans « l’édition illustrée », et qui précèdent la « Postface », comprend au moins 14 légendes ; ce qui suggère (si l’on accepte que « présentées par Barthes » prouve que c’est lui qui les a attachées) que Barthes, au contraire, s’est beaucoup investi dans les images de Pic.
Ces 14 légendes sont de deux types. D’une part, des citations des moments clés de la pièce de Brecht : « On est dans le commerce » ; ou bien, l’échange entre Mère Courage et des soldats, « – Il n’y a pas de guerre s’il n’y a pas de soldats / – Ce ne sera pas mes enfants ». Seule la première de ces légendes est retenue dans « Sept photos modèles de Mère Courage » ; et aucune dans « Préface », qui ne dispose d’aucune légende contre ses sept photographies de Pic. D’autre part, et plus intéressantes pour nous, ce sont les « interventions » écrites pour aider l’intrigue de la pièce à continuer dans le déroulement des images. Les légendes-citations – des voix « diégétiques » des personnages – sont augmentées par des légendes « extradiégétiques » qui décrivent brièvement l’action. C’est-à-dire, les deux types de légendes s’insèrent ensemble de façon illustratrice dans le déroulement progressif des photographies, déroulement qui narre, visuellement, l’intrigue de la pièce, leur fonction étant (comme un chœur) celle de susciter le regard critique du lectorat du livre et des images de Pic, imitant ainsi celui de l’audience devant la représentation. Par exemple, à côté de l’image 9 – l’image 5 reproduite dans « Préface » et décrite dans le commentaire par rapport à la natte de Catherine mais non pas légendée[44] – une première légende extradiégétique :
Et pour éloigner les recruteurs, Mère Courage entreprend de prédire l’avenir au Caporal : on plie un papier en deux … (image 9)
Le « et » ici implique une continuité non seulement avec la réplique de Mère Courage au soldat citée en haut, mais aussi avec les deux autres légendes qui la précèdent et qui ouvrent la « narration » par la légende. D’abord, au-dessus de l’image gros plan de la carriole – qui, elle, est accompagnée par une courte légende dans « Sept photos modèles de Mère Courage[45] » – une légende extradiégétique offrant une mise en contexte plus détaillée :
Or la cantinière Anna Fierling, plus connue sous le nom de Mère Courage, rejoint l’armée pour lui rendre ses marchandises. (image 6)
Et en dessous de cette même image, encore une légende extradiégétique qui présente les personnages :
La carriole qui lui sert de magasin, est tirée par les deux fils de Mère Courage, le téméraire Eilif et l’honnête Petit-suisse. Sur la carriole, Mère Courage est heureuse, le voyage est son repos : elle chante, accompagnée à l’harmonica par sa fille, Catherine la muette[46]. (image 7)
Le lectorat de cette « véritable histoire photographique de Mère Courage, fait nouveau, je crois, dans la critique de théâtre, du moins en France[47] » ne pourrait pas souhaiter mieux pour l’aider à comprendre l’intrigue à partir des images de Pic.
D’autres légendes vont suivre. Cette fois, à côté de l’image de Mère Courage (image 4 dans la version « Préface[48] »), la légende est un mélange de commentaire « extradiégétique » et de paroles du personnage éponyme en train de négocier avec le cuisinier :
Elle veut lui vendre un chapon :
-
Trente, pas quarante. J’ai dit trente (image 16)
Cette légende est suivie d’une photographie de Pic dans laquelle la scène est coupée en deux (image non pas retenue ni dans « Sept photos modèles de Mère Courage » ni dans « Préface ») et légendée ainsi :
Pendant que Mère Courage et le cuisinier débattent le prix de la bête, dans la tente voisine, le Capitaine, accompagné de l’aumônier, reçoit Eilif. (image 17)
Ensuite, la deuxième image dans « Préface[49] » – dont aucune des images n’est légendée – est ici, dans la version « Postface », légendée de façon considérable :
Mère Courage s’empresse d’enlaidir sa fille pour la préserver des soldats ennemis.
Trois jours ont passé. C’est le matin, la famille est inquiète : Petitsuisse n’a pas pu rejoindre son régiment, on doit croire qu’il s’est enfui avec la caisse. (image 37)[50]
Pourquoi Barthes, a-t-il donc supprimé la vaste majorité de ce matériau dans son commentaire « Préface » ? Cette réduction est appliquée aux images – une centaine est réduite à sept – mais les légendes sont tout de même utiles ; elles font avancer l’intrigue, commentent aussi les images, de façon chorale, voire dialectique. A la suite de l’image de Mère Courage en train de bloquer le passage à l’aumônier – la première photographie dans « Préface[51] », mais seulement légendée dans « Postface », cette fois par une citation de l’aumônier « Où est la toile ? » (image 55) –, est une image « action » qui n’est pas reproduite dans ni « Sept photos modèles de Mère Courage» ni « Préface », et décrite par une très longue légende :
Catherine est très émue ; elle ne peut supporter de voir souffrir la paysanne : elle insiste auprès de sa mère, et comme sa mère continue à refuser, elle se met en colère et la menace. L’aumônier pénètre de force dans la carriole et y trouve plusieurs chemises qu’il met en lambeaux. Mère Courage crie qu’elle est ruinée. (image 56)
C’est un moment capital, même charnière, dans la pièce : Catherine se tourne contre sa propre mère, qui, elle, se sent maintenant détruite. L’intervention du commentaire, en forme de légende, est aussi capitale que l’image pour la compréhension du lectorat des images de Pic.
Finalement, trois légendes pour deux photos de Pic. La septième et dernière photographie reproduite dans « Préface »[52] est légendée, dans « l’édition illustrée », par une citation de l’aumônier à genoux : « – Si on prenait un tronc pour la déloger de là, il y a des pins abattus dans la forêt » (image 90) ; mais c’est la prochaine image – disposée clairement d’un commentaire extradiégétique – qui est forte. Il s’agit d’une image-action dans laquelle nous voyons Catherine sur le toit, attendue en bas par les soldats qui veulent la déloger :
Alertés par le bruit du tambour, les soldats et le jeune paysan sont revenus. Catherine bat de plus en plus fort. Que faire ? (image 91, en haut de la page)
Ce qui frappe ici, c’est l’intervention du commentaire : le « que faire ? » – même s’il n’est pas pris dans son sens léniniste – représente, pour le lectorat de ces photos, une orientation radicale de l’image de Pic. Une deuxième légende – une citation d’un des soldats – semble clôturer l’intrigue :
-
Descends, suis-nous jusqu’à la ville ; tu nous désigneras ta mère et elle aura la vie sauvée. (image 91, en bas de la page)
C’est la dernière légende. Les légendes – en concert avec les cent images de Pic – ont communiqué les trois valeurs des trois enfants de Mère Courage (vaillance d’Eilif ; honnêteté de Petitsuisse ; solidarité de Catherine), mais valeurs qui ne sont que la cause du déclin de chacun. Mais pour la dernière, c’est ce qui permet à Barthes de lui attribuer le statut de la « vraie » héroïne de la pièce, dans la conclusion extraordinaire de son « Commentaire », et qui dépend du mutisme de Catherine.
Ce mutisme, nous le voyons – sans légende nécessaire – dans la toute dernière image de Pic (image 98) : celle de Mère Courage en train de devoir traîner la carriole toute seule, le dos courbé (image fameuse de la couverture des deux versions de Mère Courage publiée par l’Arche en 1960, « édition illustrée » et « collection du répertoire »). « La main de dieu », c’est la corruption à laquelle Mère Courage fait confiance pour sauver sa famille. Également, la chemise que cherche éperdument l’aumônier, et que Mère Courage veut garder à tout prix, c’est son commerce chéri. Finalement, le leurre tendu à Catherine par les soldats indique la profondeur de son déclin, même si elle a sauvé la ville en la prévenant avec le tambour ; le mot de Mère Courage sidérée mais résignée « je dois résumer le commerce » est implicite dans cette image « muette » (sans légende) extraordinaire. Avec une efficacité marquée – et une parcimonie qui anticipe le « discours troué » que Barthes va attribuer à Proust[53] – la dynamique texte-image aura livré l’intrigue tragique, mais évidemment « distancée », de la pièce de Brecht. Les légendes de Barthes sont non seulement directement ancrées sur chaque image mais s’enchaînent avec son « Commentaire » qui suit.
V Conclusion : Commentaire et chœur
« Édition illustrée » (avec la « Postface ») et « collection du répertoire » (avec sa « Préface ») étant différentes quant au nombre d’images de Pic (100 contre 7), le texte lui-même n’a pas subi des changements (sauf pour indiquer le numéro attaché à chaque image). Dès la première ligne du « Commentaire » de Barthes, ce jeu d’efficacité par rapport à l’intrigue est souligné, sauf que Barthes ne mentionne pas les – ses – légendes y aidantes :
[D]’ordinaire, le photographe [de théâtre] opère d’une façon anthologique : il choisit quelques sommets du spectacle, y ajoutant les facilités du clair-obscur, du gros plan ou de la composition. Ici, rien de tel : ce que Pic veut, c’est rendre intelligible une durée : d’où le nombre, la régularité patiente des documents d’une part ; et d’autre part leur pouvoir de signification[54].
« Fidèles » – mais non « serviles » – ces images, légendées, sont nombreuses ; et précédant de dix ans son commentaire-exergue sur les images dans L’empire des signes en 1970[55], Barthes insiste pour que les images de Pic « n’illustrent pas, elles aident à découvrir l’intention profonde de la création : c’est en cela qu’elles sont véritablement critiques[56] ».
La seule explication pour le nombre parcimonieux choisi parmi les cent images de Pic dans « Préface » tient sans doute à la taille de l’édition : ce petit livre, avec la « Préface » de Barthes, ne montre que les images qu’il commente directement dans son texte. Ce qu’il faut souligner donc c’est l’effet de discontinu que Barthes trouve dans le théâtre de Brecht, la « rupture » soulignée dans le seul texte de Walter Benjamin publié dans Théâtre Populaire et que Barthes signale dans une note en bas de la page[57] ; à souligner aussi, c’est la façon dont Barthes lui-même, avec ses légendes ajoutées aux images de Pic, respecte, amplifie et engage ce même discontinu. Ceci tient, certainement en partie, aux idées engagées du chœur que Barthes avait déjà détaillées dans Théâtre Populaire. Dans la tragédie grecque,
[C]’est le chœur qui donne au spectacle sa dimension tragique, car c’est lui, et lui seul, qui est toute parole humaine, il est le Commentaire par excellence, c’est son verbe qui fait de l’événement autre chose qu’un geste brut, et par le pouvoir de liaison propre à l’homme, tissant la chaîne des mobiles et des causes, constitue la tragédie comme une Nécessité comprise, c’est-à-dire comme une Histoire pensée[58].
Même si Barthes, à partir de 1954, considérait le théâtre épique de Brecht comme un dépassement de la tragédie aristotélicienne, le rôle de la photo-légende ressemble à celui de ce qu’il appelle en 1953 le « peuple-chœur[59] ». Les citations de la pièce et les « commentaires » sont autant d’interventions du « chœur » que de celles d’un metteur en scène manqué.
Dans son essai sur le photo-textualisme fragmentaire dans Roland Barthes par Roland Barthes, Ginette Michaud insiste pour que « le commentaire travaille toujours dans la distance » ; et nous ne pouvons que nous mettre d’accord avec Michaud par rapport aux débuts du photo-textualisme barthésien de vingt ans avant, dans le théâtre des années 1950, lorsqu’elle suggère : « Entre le commentaire et la photo, il ne saurait y avoir coïncidence, correspondance »[60]. Car l’investissement « choral », venu sans doute du Barthes des années 1930 et 1940 impliqué dans le théâtre grec ancien comme acteur et étudiant, serait entré dans l’acte photo-textuel d’attacher une légende, ou ironique, humoristique (pour « les maladies » de costume), ou narratrice, engagée (pour les images de Pic), mais toujours à des fins sérieuses, politiques[61] ; en effet, dans les deux cas, le photographe compte moins que la photo, en série, fragmentée, mais dirigée.
Un éditorial récent a argumenté ce double statut de l’art révolutionnaire :
L’art s’avère être à la fois le lieu d’élaboration des valeurs et des vertus qui se dégagent de la sphère des fins ultimes et l’opérateur dialectique de leur rapport contradictoire avec la dimension historico-politique. Ce pouvoir que l’art détient de présenter des éléments infra-politiques est identifiable dans les œuvres les plus directement associées à l’horizon révolutionnaire[62].
De manière similaire, Roland Barthes avait reconnu le révolutionnaire dans Mère Courage de Bertolt Brecht :
Le personnage central de Mère Courage, ce n’est pas en dernière instance la cantinière, c’est sa fille Catherine (…). Chez Catherine, le mutisme libère le geste, et le geste (…) révèle ce qu’il faut bien appeler, faute d’un mot moins compromis, la sensibilité de Catherine[63].
Catherine, que Brecht « a engagée dans un acte véritable, conscient et efficace » – le sauvetage de la ville assiégée – par lequel elle interrompt le déterminisme de la « triste et sauvage histoire des hommes », incarne :
le travail d’une conscience qui veut comprendre le réel, s’oublie pour mieux se tourner vers lui, et s’associe au monde par une attention qui n’est rien d’autre que la forme la plus haute de l’intelligence[64].
Cette « intelligence » de Catherine est révélée, dans les essais et les légendes de Barthes, et par la scénographie et par la photographie. Le distancement dans ses légendes et ses essais sur Pic n’est pas du tout un signe d’une « socialité théorique » ; « mimer » la Verfremdung de Brecht dans son approche aux images photographiques n’est pas « cruellement » ignorer le pathétique, comme Didi-Huberman le prétend. Barthes n’oublie pas la douleur de Mère Courage, simplement il la compare à la « sensibilité » de Catherine ; elle est implicite dans le texte de Barthes, car explicite dans les images de Pic. Il s’agit donc d’une « double saisie » : Barthes l’a compris dans son travail de légende appliqué à la dramaturgie de Brecht : « [L]’originalité du signe brechtien, écrira-t-il en 1975[65], c’est d’être lu deux fois[.] »
Notes
[1] Interview de Roland Barthes en février 1980, dans Le Photographe, republiée dans Roland Barthes, Œuvres Complètes, Paris, Seuil, 2002 (désormais : OC), t. I, p. 936.
[2] Voir le film documentaire La Lutte de 1961, tourné à Montréal par Michel Brault, Marcel Carrière, Claude Fournier et Claude Jutra, pour laquelle l’opinion de Roland Barthes, sollicitée par les metteurs en scène, était qu’il fallait à tout prix éviter de démystifier les mouvements dans une partie de catch. Ce documentaire québécois de 28 minutes – disponible à https://www.nfb.ca/film/la_lutte/ – a, pour certains, même un aspect anticolonial, car le catch, très populaire au Canada, était associé, à l’époque, à la classe dominante anglophone ; voir http://contents.kocw.net/KOCW/document/2015/sungkyunkwan/antoinecoppola/7.pdf (visité le 17 novembre 2020).
[3] Michelet par lui-même, in OC, I, p. 304.
[4] Le tout premier livre dans lequel Barthes append une légende contre une image c’est Michelet par lui-même de 1954 qui commence par le portrait photographique de l’historien qui, envoyé par Philippe Rebeyrol à Barthes isolé pendant la Guerre dans le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, aura tant intrigué le jeune écrivain ; voir Louis-Jean Calvet, Roland Barthes : 1915-1980 (Paris, Flammarion, 1990), p. 147. Le premier article avec une iconographie photographique, c’est son « Pouvoirs de la tragédie antique », Théâtre Populaire 2 (juillet/août 1953), p.12-22, comprenant trois photographies de « Viollet » (supposons-nous, Hélène Roger-Viollet) du théâtre de Delphes et de deux masques de théâtre (images prises, semble-t-il, en 1952).
[5] « Enfants-vedettes », Les Lettres nouvelles février 1955, p. 314-316 (OC, I, p. 549-550).
[6] « Les maladies du costume de théâtre », Théâtre Populaire 12, mars/avril 1955, p. 64-76 (à contraster avec la version finale dans Essais critiques, OC, II, p. 316-325).
[7] « Enfant-vedettes », art. cit., et, bien sûr, « Jouets » sont complétées par Barthes dans la rubrique « la petite mythologie du mois », dans Les Lettres nouvelles de février 1955, avec « Pour une histoire de l’enfance », p. 313-314, et « Enfants-copies », p. 316-318 (OC, I, p. 549-552) ; toutes, sauf « Jouets », sont malheureusement écartées lors de la préparation du livre Mythologies.
[8] Voir la version illustrée des Mythologies de Roland Barthes dirigée par Jacqueline Guittard (Paris, Seuil, 2010).
[9] Une spécialiste du costume de théâtre a eu la bonne initiative de mettre en ligne la première version de l’article de Barthes, complétées par les photographies de costume avec les légendes de Barthes :
julie-d.levillage.org/roland_barthes.htm (visité le 24 juillet 2020).
[10] « Les maladies du costume de théâtre », art. cit., p. 66. Barthes avait participé à une discussion sur Lorenzaccio avec Gérard Philipe, Henri Lefebvre et Henri Deschamps en décembre 1954, qui ne sera publiée qu’en 1961, voir Théâtre Populaire 41 (1961), p. 137-141.
[11] C’est Barthes qui signe le compte rendu de la mise en scène dans Théâtre Populaire : no. 8 (juillet/août 1954), p. 94-97 (connu plutôt dans la version de 1964 dans Essais critiques sous le titre « Mère Courage aveugle », OC, II, p. 311-313), et no. 11 (janvier-février 1955) p. 89-90 (« La révolution brechtienne » dans Essais critiques, OC, II, p. 314-315).
[12] C’est Barthes qui fait le compte rendu : voir « Macbeth au TNP », Théâtre Populaire 11, janvier/février 1955, p. 89-90 (OC, I, p. 566-567). Il est à signaler aussi que, annoncé dans plusieurs numéros de Théâtre Populaire, est un article de Roland Barthes sur « Jean Vilar, l’acteur », ainsi que « Petit lexique du spectacle », mais qui, ni l’un ni l’autre, n’ont jamais vu le jour ; voir A. Stafford, « Roland Barthes, journaliste de gauche. Les Lettres nouvelles et Théâtre Populaire, 1953-1956 », Revue Roland Barthes 3, « Barthes en revues », ed. M. Nachtergael et J. Guittard, note 25 (visité le 12 juin 2023).
[13] « Les maladies du costume de théâtre », art. cit., p. 70-71. Le Musée Dupuytren, ancienne collection de figures en cire illustrant la pathologie anatomique, localisé dans le Couvent des Cordeliers à Paris et fermé en 2016, est connu pour son côté macabre et terrifiant. C’est aussi où on passe la soutenance de son HDR !
[14] Ibid., p. 76.
[15] Voir « L’acteur d’Harcourt » dans Mythologies, lui-même une version courte – mais toujours sans iconographie – de son article de 1953, « Visages et figures », Esprit, juillet 1953, p. 1-11 (OC, I, p. 268-279).
[16] C’est à noter toutefois que Barthes est rarement impressionné par le jeu de Philipe ; voir par exemple son compte rendu rancunier envers le jeu de Philipe dans Christophe Colomb de Paul Claudel qui était une « dilapidation » du TNP « dressé à l’austère et tendre tragédie » (« ‘L’Arlésienne’ du catholicisme », Les Lettres nouvelles, novembre 1953, p. 1162-1165 ; OC, I, p. 283-286) ; ou bien, son commentaire lancinant envers Philipe dans le rôle de Richard II : « mélodramatique » non pas « tragique », « plus hugolien que shakespearien », typique de son « embourgeoisement » ; « Fin de Richard II », Les Lettres nouvelles mars 1954, p. 425-429 (OC, I, p. 467-470).
[17] Mythologies, Paris, Seuil, 1970, p. 174.
[18] Déjà en 1953, dans « Visages et figures » (OC, I, p. 273), Barthes avait loué les portraits d’acteurs de Thérèse le Prat et le travail pour le TNP d’Agnès Varda, dont les photographies « sont d’avant-garde ».
[19] Barthes, « Bertolt Brecht à Lyon », France-Observateur 10 mai 1956, p. 17 (OC, I, p. 654-655, mais sans l’illustration photographique légendée). Planchon était, à Lyon en 1954, un des premiers metteurs en scène en France à se mettre en contact avec Brecht par rapport à la photographie de théâtre, discutant avec le dramaturge allemand de sa mise en scène de La Bonne âme de Se-Tchouan ; voir https://next.liberation.fr/culture/1995/12/20/une-selection-de-beaux-livres-toute-la-semaine-7roger-pic-tombe-a-pic-pour-bertolt-brechtle-photogra_151851 (visité le 2 novembre 2020) qui confirme que les photographies de cette mise en scène à Lyon – ainsi que de celle du Cercle de craie caucasien à Paris en 1955 (voir le compte rendu de Barthes, OC, I, p. 615-619) – sont de Roger Pic.
[20] La photographie n’est attribuée à personne, mais on peut se demander s’il s’agit encore du travail de Pic.
[21] OC, I, p. 654.
[22] Brecht, Maître Puntila et son valet Matti, Paris, L’Arche, 1956 [1964], trad. de Michel Cadot, collection du répertoire TNP, comprenant 15 photographies de Roger Pic de la première représentation, au Théâtre du Palais de Chaillot, qui n’aura lieu qu’en novembre 1964.
[23] Voir la description contrastée que fait Dort des deux scénographies et qui est citée dans Chantal Meyer-Plantureux, Roger Pic et Benno Besson, Bertolt Brecht et le Berliner Ensemble à Paris, Paris, Marval, 1995, p. 17-18.
[24] Ibid., p. 17.
[25] Ibid., p. 19. Dans Barthes Contemporain (Paris, Max Milo, 2015, p. 52), Magali Nachtergael souligne l’aspect tout contemporain des images de Pic, leur esthétique du moment étant typique de la photographie du nouveau millénium.
[26] Ibid.
[27] Barthes, « Sept photos modèles de Mère Courage », Théâtre Populaire 35, 3e trimestre 1959, p. 17-32 (OC, I, p. 997-1013) ; Barthes, « Commentaire : Préface à Brecht, Mère Courage et ses enfants (avec des photographies de Pic) » (OC, I, p. 1064-1082). Le titre et la notion de « photo-modèle » viennent directement de Brecht et son « Modelbuch » comprenant entre 600 et 800 photographies prises lors des mises en scène du Berliner Ensemble ; et le travail de Pic semble avoir impressionné Brecht ; voir Meyer-Plantureux Roger Pic et Benno Besson, Bertolt Brecht et le Berliner Ensemble à Paris, op. cit., p. 31.
[28] « Sept photos modèles de Mère Courage », OC, I, p. 998.
[29] « Préface », OC, I, p. 1064.
[30] Georges Didi-Huberman, Peuples en larmes, Peuples en armes, Paris, Minuit, 2016, p. 121-123 (p. 122).
[31] Ibid., p. 123. Pour une critique de l’analyse de Didi-Huberman, voir Danièle Carluccio, « Barthes, Didi-Huberman et l’image pathétique », Irish Journal of French Studies no. 20 (2020), p. 173-191.
[32] B. Brecht, Petit organon, traduction de Jean Tailleur, Paris, L’Arche, 1954 ; G. Serreau, Brecht, coll. « Les grands dramaturges » no. 4, Paris, L’Arche, 1955, auquel Barthes fait référence dans « Photo-chocs », voir Les Lettres nouvelles, juillet/août 1955, p. 186 (Mythologies, p. 105) ; le livre de Serreau est très contesté surtout du côté du Parti Communiste Français, voir Daniel Mortier, Celui qui dit oui, celui qui dit non ou la Réception de Brecht en France (1945-56), Paris/Geneva, Champion/Slatkine, 1986, p. 76-91.
[33] Selon Mortier, Celui qui dit oui, celui qui dit non, op. cit., p. 94, p. 102, Besson avait rencontré Geneviève Serreau à Lyon en 1941, partant pour Berlin-Est pour y rejoindre Brecht en 1949 où il devient lui-même metteur en scène formé par le Berliner Ensemble.
[34] Brecht, Mère Courage et ses enfants, trad. de G. Serreau et B. Besson, Paris, L’Arche, collection du répertoire TNP ; 2, 1952 et 1960. Il est à noter que, beaucoup plus tard, Robert Voisin va écarter la traduction de Serreau et de Besson, la considérant « une adaptation pour la scène » et non pas une vraie traduction ; voir Mortier, Celui qui dit oui, celui qui dit non, op. cit., p. 105.
[35] Brecht, Mère Courage Édition illustrée, trad. de G. Serreau et B. Besson, avec 100 photographies de Roger Pic, présentées et commentées par Roland Barthes, Paris, L’Arche, 1960.
[36] Ibid., dans lequel les cent photographies de Pic sont numérotées 1 à 100 et avec les légendes à côté (p. 113-208), le « Commentaire Postface » de Barthes (p. 209-221) tout de suite après.
[37] Barthes, « Sept photos modèles de Mère Courage », art. cit., p. 17 (OC, I, p. 997).
[38] Barthes, Le sport et les hommes, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 2004.
[39] Théâtre Populaire no. 40 (1960), quatrième de couverture.
[40] Voir OC, I, respectivement p. 1004 et p. 1077.
[41] La deuxième image qui est accompagnée par la légende « On est dans le commerce » dans « l’édition illustrée » est exactement celle, numéro six, dans « Préface » (OC, I, p. 1077) dans laquelle Eilif tient l’harmonica dans la main (la seule différence est que cette dernière ne jouit de légende) : à la différence de l’image similaire dans « Sept photos modèles de Mère Courage» (OC, I, p. 1004) où nous voyons l’harmonica à côté de la bouche d’Eilif ; et cette image-ci a la même légende. Dans « Préface », Barthes tire l’attention sur le manque de légendes à côté des images de Pic et sur l’utilité de ce manque : « [s]ans légende […] (c’est ce qui [lui] a permis de les réduire à l’état le plus discret possible) les photographies de Mère Courage ne seraient pas plus obscures, plus diminuées que la légende de Sainte Ursule racontée par Carpaccio » (OC, I, p. 1076).
[42] Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 21, p. 27-28.
[43] J. Carmody, « Reading Scenic Writing: Barthes, Brecht, and Theatre Photography », Journal of Dramatic Theory and Criticism, V:1 1990, p. 25-38.
[44] « Préface », OC, I, p. 1070, p. 1074.
[45] OC, I, p. 1001.
[46] A comparer avec l’information plus lapidaire dans la légende pour cette photographie dans « Sept photo- modèles » : « Une carriole couverte d’une bâche s’approche, traînée par deux jeunes garçons… » (OC, I, p. 1001).
[47] OC, I, p. 997.
[48] OC, I, p. 1073.
[49] OC, I, p. 1071.
[50] A la même page, une autre image non pas retenue dans la version « Préface », celle de Mère Courage avec sa fille, le soldat et le cuisinier (image 38) est légendée avec une citation de la pièce : « – Que voulez-vous, nous sommes dans la main de Dieu. »
[51] OC, I, p. 1065.
[52] OC, I, p. 1080.
[53] Voir « Table ronde sur Proust » avec Gilles Deleuze, Roland Barthes et Gérard Genette, dans Cahiers Marcel Proust no. 37, Paris, Gallimard, 1975, repub. dans G. Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, ed. D. Lapoujade, Paris, Minuit, 2003, p. 29-55.
[54] « Préface », OC, I, p. 1064.
[55] « Le texte ne ‘commente’ pas les images. Les images n’‘illustrent’ pas le texte » (OC, III, p. 349).
[56] « Préface », OC, I, p. 1064.
[57] OC, I, p. 1075 ; W. Benjamin, « Qu’est-ce que le théâtre épique ? », trad. M. Regnaut, Théâtre Populaire no. 26 (septembre 1957), p. 4-11. Il faut signaler une coquille autour du mot « empoisonnement » qui, selon Jean-Loup Rivière (dans « Peut-être le théâtre : variations sur une coquille », in Marianne Alphant et Nathalie Léger eds, R/B. Roland Barthes. Catalogue de l’exposition Centre-Pompidou, Paris, Seuil/Centre Pompidou/IMEC, 2002, p. 72-74), devrait être « empoissement », mot sartrien que Barthes déploie à plusieurs reprises au début des années 1950 pour fustiger le théâtre bourgeois et petit-bourgeois.
[58] « Pouvoirs de la tragédie antique », OC, I, p. 267.
[59] Ibid., OC, I, p. 266.
[60] G. Michaud, Lire le fragment. Transfert et théorie de la lecture chez Roland Barthes, Ville LaSalle (Québec), éditions Hurtubise, 1989, p. 109.
[61] Il est intéressant de noter que le premier texte de Barthes jamais lu par Antoine Compagnon en 1967 (pour son agrégation) était le commentaire sur les images de Pic.
[62] « Éditorial », Cahiers du GRM 5 (2014), mis en ligne le 24 avril 2014 : http://journals.openedition.org/grm/391 (visité le 30 juillet 2020).
[63] OC, I, p. 1081.
[64] OC, I, p. 1082.